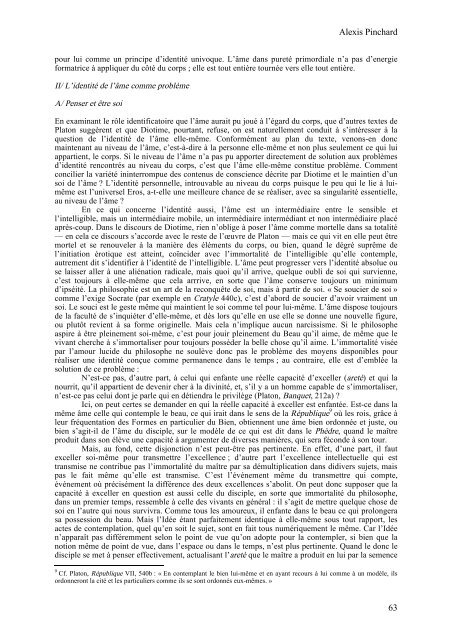You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Alexis Pinchard<br />
pour lui comme un principe d’identité univoque. L’âme dans pureté primordiale n’a pas d’energie<br />
formatrice à appliquer du côté du corps ; elle est tout entière tournée vers elle tout entière.<br />
II/ L’identité de l’âme comme problème<br />
A/ Penser et être soi<br />
En examinant le rôle identificatoire que l’âme aurait pu joué à l’égard du corps, que d’autres textes de<br />
Platon suggèrent et que Diotime, pourtant, refuse, on est naturellement conduit à s’intéresser à la<br />
question de l’identité de l’âme elle-même. Conformément au plan du texte, venons-en donc<br />
maintenant au niveau de l’âme, c’est-à-dire à la personne elle-même et non plus seulement ce qui lui<br />
appartient, le corps. Si le niveau de l’âme n’a pas pu apporter directement de solution aux problèmes<br />
d’identité rencontrés au niveau du corps, c’est que l’âme elle-même constitue problème. Comment<br />
concilier la variété ininterrompue des contenus de conscience décrite par Diotime et le maintien d’un<br />
soi de l’âme ? L’identité personnelle, introuvable au niveau du corps puisque le peu qui le lie à luimême<br />
est l’universel Eros, a-t-elle une meilleure chance de se réaliser, avec sa singularité essentielle,<br />
au niveau de l’âme ?<br />
En ce qui concerne l’identité aussi, l’âme est un intermédiaire entre le sensible et<br />
l’intelligible, mais un intermédiaire mobile, un intermédiaire intermédiant et non intermédiaire placé<br />
après-coup. Dans le discours de Diotime, rien n’oblige à poser l’âme comme mortelle dans sa totalité<br />
— en cela ce discours s’accorde avec le reste de l’œuvre de Platon — mais ce qui vit en elle peut être<br />
mortel et se renouveler à la manière des éléments du corps, ou bien, quand le dégré suprême de<br />
l’initiation érotique est atteint, coïncider avec l’immortalité de l’intelligible qu’elle contemple,<br />
autrement dit s’identifier à l’identité de l’intelligible. L’âme peut progresser vers l’identité absolue ou<br />
se laisser aller à une aliénation radicale, mais quoi qu’il arrive, quelque oubli de soi qui survienne,<br />
c’est toujours à elle-même que cela arrrive, en sorte que l’âme conserve toujours un minimum<br />
d’ipséité. La philosophie est un art de la reconquête de soi, mais à partir de soi. « Se soucier de soi »<br />
comme l’exige Socrate (par exemple en Cratyle 440c), c’est d’abord de soucier d’avoir vraiment un<br />
soi. Le souci est le geste même qui maintient le soi comme tel pour lui-même. L’âme dispose toujours<br />
de la faculté de s’inquiéter d’elle-même, et dès lors qu’elle en use elle se donne une nouvelle figure,<br />
ou plutôt revient à sa forme originelle. Mais cela n’implique aucun narcissisme. Si le philosophe<br />
aspire à être pleinement soi-même, c’est pour jouir pleinement du Beau qu’il aime, de même que le<br />
vivant cherche à s’immortaliser pour toujours posséder la belle chose qu’il aime. L’immortalité visée<br />
par l’amour lucide du philosophe ne soulève donc pas le problème des moyens disponibles pour<br />
réaliser une identité conçue comme permanence dans le temps ; au contraire, elle est d’emblée la<br />
solution de ce problème :<br />
N’est-ce pas, d’autre part, à celui qui enfante une réelle capacité d’exceller (aretè) et qui la<br />
nourrit, qu’il appartient de devenir cher à la divinité, et, s’il y a un homme capable de s’immortaliser,<br />
n’est-ce pas celui dont je parle qui en détiendra le privilège (Platon, Banquet, 212a) ?<br />
Ici, on peut certes se demander en qui la réelle capacité à exceller est enfantée. Est-ce dans la<br />
même âme celle qui contemple le beau, ce qui irait dans le sens de la République 9 où les rois, grâce à<br />
leur fréquentation des Formes en particulier du Bien, obtiennent une âme bien ordonnée et juste, ou<br />
bien s’agit-il de l’âme du disciple, sur le modèle de ce qui est dit dans le Phèdre, quand le maître<br />
produit dans son élève une capacité à argumenter de diverses manières, qui sera féconde à son tour.<br />
Mais, au fond, cette disjonction n’est peut-être pas pertinente. En effet, d’une part, il faut<br />
exceller soi-même pour transmettre l’excellence ; d’autre part l’excellence intellectuelle qui est<br />
transmise ne contribue pas l’immortalité du maître par sa démultiplication dans didivers sujets, mais<br />
pas le fait même qu’elle est transmise. C’est l’événement même du transmettre qui compte,<br />
événement où précisément la différence des deux excellences s’abolit. On peut donc supposer que la<br />
capacité à exceller en question est aussi celle du disciple, en sorte que immortalité du philosophe,<br />
dans un premier temps, ressemble à celle des vivants en général : il s’agit de mettre quelque chose de<br />
soi en l’autre qui nous survivra. Comme tous les amoureux, il enfante dans le beau ce qui prolongera<br />
sa possession du beau. Mais l’Idée étant parfaitement identique à elle-même sous tout rapport, les<br />
actes de contemplation, quel qu’en soit le sujet, sont en fait tous numériquement le même. Car l’Idée<br />
n’apparaît pas différemment selon le point de vue qu’on adopte pour la contempler, si bien que la<br />
notion même de point de vue, dans l’espace ou dans le temps, n’est plus pertinente. Quand le donc le<br />
disciple se met à penser effectivement, actualisant l’aretè que le maître a produit en lui par la semence<br />
9 Cf. Platon, République VII, 540b : « En contemplant le bien lui-même et en ayant recours à lui comme à un modèle, ils<br />
ordonneront la cité et les particuliers comme ils se sont ordonnés eux-mêmes. »<br />
63