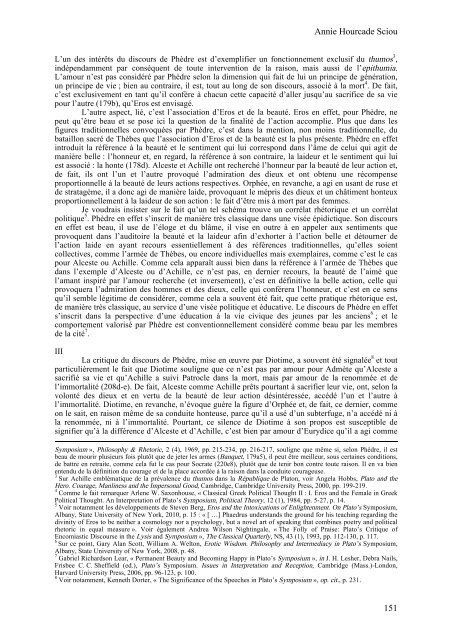You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Annie Hourcade Sciou<br />
L’un des intérêts du discours de Phèdre est d’exemplifier un fonctionnement exclusif du thumos 3 ,<br />
indépendamment par conséquent de toute intervention de la raison, mais aussi de l’epithumia.<br />
L’amour n’est pas considéré par Phèdre selon la dimension qui fait de lui un principe de génération,<br />
un principe de vie ; bien au contraire, il est, tout au long de son discours, associé à la mort 4 . De fait,<br />
c’est exclusivement en tant qu’il confère à chacun cette capacité d’aller jusqu’au sacrifice de sa vie<br />
pour l’autre (179b), qu’Eros est envisagé.<br />
L’autre aspect, lié, c’est l’association d’Eros et de la beauté. Eros en effet, pour Phèdre, ne<br />
peut qu’être beau et se pose ici la question de la finalité de l’action accomplie. Plus que dans les<br />
figures traditionnelles convoquées par Phèdre, c’est dans la mention, non moins traditionnelle, du<br />
bataillon sacré de Thèbes que l’association d’Eros et de la beauté est la plus présente. Phèdre en effet<br />
introduit la référence à la beauté et le sentiment qui lui correspond dans l’âme de celui qui agit de<br />
manière belle : l’honneur et, en regard, la référence à son contraire, la laideur et le sentiment qui lui<br />
est associé : la honte (178d). Alceste et Achille ont recherché l’honneur par la beauté de leur action et,<br />
de fait, ils ont l’un et l’autre provoqué l’admiration des dieux et ont obtenu une récompense<br />
proportionnelle à la beauté de leurs actions respectives. Orphée, en revanche, a agi en usant de ruse et<br />
de stratagème, il a donc agi de manière laide, provoquant le mépris des dieux et un châtiment honteux<br />
proportionnellement à la laideur de son action : le fait d’être mis à mort par des femmes.<br />
Je voudrais insister sur le fait qu’un tel schéma trouve un corrélat rhétorique et un corrélat<br />
politique 5 . Phèdre en effet s’inscrit de manière très classique dans une visée épidictique. Son discours<br />
en effet est beau, il use de l’éloge et du blâme, il vise en outre à en appeler aux sentiments que<br />
provoquent dans l’auditoire la beauté et la laideur afin d’exhorter à l’action belle et détourner de<br />
l’action laide en ayant recours essentiellement à des références traditionnelles, qu’elles soient<br />
collectives, comme l’armée de Thèbes, ou encore individuelles mais exemplaires, comme c’est le cas<br />
pour Alceste ou Achille. Comme cela apparaît aussi bien dans la référence à l’armée de Thèbes que<br />
dans l’exemple d’Alceste ou d’Achille, ce n’est pas, en dernier recours, la beauté de l’aimé que<br />
l’amant inspiré par l’amour recherche (et inversement), c’est en définitive la belle action, celle qui<br />
provoquera l’admiration des hommes et des dieux, celle qui conférera l’honneur, et c’est en ce sens<br />
qu’il semble légitime de considérer, comme cela a souvent été fait, que cette pratique rhétorique est,<br />
de manière très classique, au service d’une visée politique et éducative. Le discours de Phèdre en effet<br />
s’inscrit dans la perspective d’une éducation à la vie civique des jeunes par les anciens 6 ; et le<br />
comportement valorisé par Phèdre est conventionnellement considéré comme beau par les membres<br />
de la cité 7 .<br />
III<br />
La critique du discours de Phèdre, mise en œuvre par Diotime, a souvent été signalée 8 et tout<br />
particulièrement le fait que Diotime souligne que ce n’est pas par amour pour Admète qu’Alceste a<br />
sacrifié sa vie et qu’Achille a suivi Patrocle dans la mort, mais par amour de la renommée et de<br />
l’immortalité (208d-e). De fait, Alceste comme Achille prêts pourtant à sacrifier leur vie, ont, selon la<br />
volonté des dieux et en vertu de la beauté de leur action désintéressée, accédé l’un et l’autre à<br />
l’immortalité. Diotime, en revanche, n’évoque guère la figure d’Orphée et, de fait, ce dernier, comme<br />
on le sait, en raison même de sa conduite honteuse, parce qu’il a usé d’un subterfuge, n’a accédé ni à<br />
la renommée, ni à l’immortalité. Pourtant, ce silence de Diotime à son propos est susceptible de<br />
signifier qu’à la différence d’Alceste et d’Achille, c’est bien par amour d’Eurydice qu’il a agi comme<br />
<strong>Symposium</strong> », Philosophy & Rhetoric, 2 (4), 1969, pp. 215-234, pp. 216-217, souligne que même si, selon Phèdre, il est<br />
beau de mourir plusieurs fois plutôt que de jeter les armes (Banquet, 179a5), il peut être meilleur, sous certaines conditions,<br />
de battre en retraite, comme cela fut le cas pour Socrate (220e8), plutôt que de tenir bon contre toute raison. Il en va bien<br />
entendu de la définition du courage et de la place accordée à la raison dans la conduite courageuse.<br />
3 Sur Achille emblématique de la prévalence du thumos dans la République de Platon, voir Angela Hobbs, Plato and the<br />
Hero. Courage, Manliness and the Impersonal Good, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 199-219.<br />
4 Comme le fait remarquer Arlene W. Saxonhouse, « Classical Greek Political Thought II : I. Eros and the Female in Greek<br />
Political Thought. An Interpretation of Plato’s <strong>Symposium</strong>, Political Theory, 12 (1), 1984, pp. 5-27, p. 14.<br />
5 Voir notamment les développements de Steven Berg, Eros and the Intoxications of Enlightenment. On Plato’s <strong>Symposium</strong>,<br />
Albany, State University of New York, 2010, p. 15 : « [ …] Phaedrus understands the ground for his teaching regarding the<br />
divinity of Eros to be neither a cosmology nor a psychology, but a novel art of speaking that combines poetry and political<br />
rhetoric in equal measure ». Voir également Andrea Wilson Nightingale, « The Folly of Praise: Plato’s Critique of<br />
Encomiastic Discourse in the Lysis and <strong>Symposium</strong> », The Classical Quarterly, NS, 43 (1), 1993, pp. 112-130, p. 117.<br />
6 Sur ce point, Gary Alan Scott, William A. Welton, Erotic Wisdom. Philosophy and Intermediacy in Plato’s <strong>Symposium</strong>,<br />
Albany, State University of New York, 2008, p. 48.<br />
7 Gabriel Richardson Lear, « Permanent Beauty and Becoming Happy in Plato’s <strong>Symposium</strong> », in J. H. Lesher, Debra Nails,<br />
Frisbee C. C. Sheffield (ed.), Plato’s <strong>Symposium</strong>. Issues in Interpretation and Reception, Cambridge (Mass.)-London,<br />
Harvard University Press, 2006, pp. 96-123, p. 100.<br />
8 Voir notamment, Kenneth Dorter, « The Significance of the Speeches in Plato’s <strong>Symposium</strong> », op. cit., p. 231.<br />
151