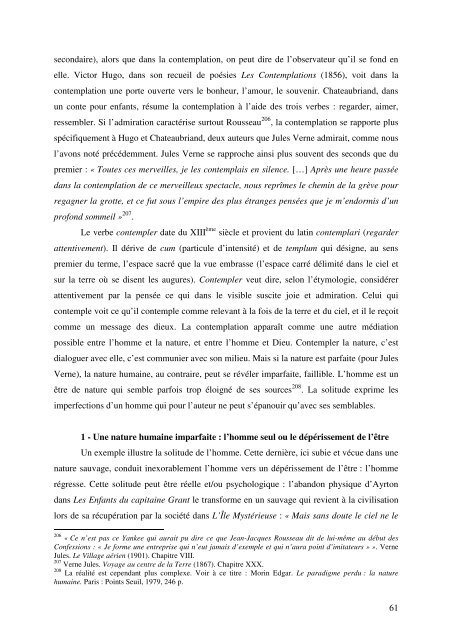Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages ...
Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages ...
Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
secondaire), alors que <strong>dans</strong> la contemplation, on peut dire de l’observateur qu’il se fond en<br />
elle. Victor Hugo, <strong>dans</strong> son recueil de poésies Les Contemplations (1856), voit <strong>dans</strong> la<br />
contemplation une porte ouverte vers le bonheur, l’amour, le souvenir. Chateaubriand, <strong>dans</strong><br />
un conte pour enfants, résume la contemplation à l’aide des trois verbes : regarder, aimer,<br />
ressembler. Si l’admiration caractérise surtout Rousseau 206 , la contemplation se rapporte plus<br />
spécifiquement à Hugo <strong>et</strong> Chateaubriand, deux auteurs que Ju<strong>les</strong> Verne admirait, comme nous<br />
l’avons noté précédemment. Ju<strong>les</strong> Verne se rapproche ainsi plus souvent des seconds que du<br />
premier : « Toutes ces merveil<strong>les</strong>, je <strong>les</strong> contemplais en silence. […] Après une heure passée<br />
<strong>dans</strong> la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour<br />
regagner la grotte, <strong>et</strong> ce fut sous l’empire des plus étranges pensées que je m’endormis d’un<br />
profond sommeil » 207 .<br />
Le verbe contempler date du XIII ème siècle <strong>et</strong> provient du latin contemplari (regarder<br />
attentivement). Il dérive de cum (particule d’intensité) <strong>et</strong> de templum qui désigne, au sens<br />
premier du terme, l’espace sacré que la vue embrasse (l’espace carré délimité <strong>dans</strong> le ciel <strong>et</strong><br />
sur la terre où se disent <strong>les</strong> augures). Contempler veut dire, selon l’étymologie, considérer<br />
attentivement par la pensée ce qui <strong>dans</strong> le visible suscite joie <strong>et</strong> admiration. Celui qui<br />
contemple voit ce qu’il contemple comme relevant à la fois de la terre <strong>et</strong> du ciel, <strong>et</strong> il le reçoit<br />
comme un message des dieux. La contemplation apparaît comme une autre médiation<br />
possible entre l’homme <strong>et</strong> la nature, <strong>et</strong> entre l’homme <strong>et</strong> Dieu. Contempler la nature, c’est<br />
dialoguer avec elle, c’est communier avec son milieu. Mais si la nature est parfaite (pour Ju<strong>les</strong><br />
Verne), la nature humaine, au contraire, peut se révéler imparfaite, faillible. L’homme est un<br />
être de nature qui semble parfois trop éloigné de ses sources 208 . La solitude exprime <strong>les</strong><br />
imperfections d’un homme qui pour l’auteur ne peut s’épanouir qu’avec ses semblab<strong>les</strong>.<br />
1 - Une nature humaine imparfaite : l’homme seul ou le dépérissement de l’être<br />
Un exemple illustre la solitude de l’homme. C<strong>et</strong>te dernière, ici subie <strong>et</strong> vécue <strong>dans</strong> une<br />
nature sauvage, conduit inexorablement l’homme vers un dépérissement de l’être : l’homme<br />
régresse. C<strong>et</strong>te solitude peut être réelle <strong>et</strong>/ou psychologique : l’abandon physique d’Ayrton<br />
<strong>dans</strong> Les Enfants du capitaine Grant le transforme en un sauvage qui revient à la civilisation<br />
lors de sa récupération par la société <strong>dans</strong> L’Île Mystérieuse : « Mais sans doute le ciel ne le<br />
206 « Ce n’est pas ce Yankee qui aurait pu dire ce que Jean-Jacques Rousseau dit de lui-même au début des<br />
Confessions : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple <strong>et</strong> qui n’aura point d’imitateurs » ». Verne<br />
Ju<strong>les</strong>. Le Village aérien (1901). Chapitre VIII.<br />
207 Verne Ju<strong>les</strong>. Voyage au centre de la Terre (1867). Chapitre XXX.<br />
208 La réalité est cependant plus complexe. Voir à ce titre : Morin Edgar. Le paradigme perdu : la nature<br />
humaine. Paris : Points Seuil, 1979, 246 p.<br />
61