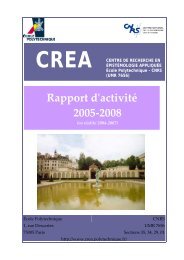- Page 1 and 2:
11 I I. -•,__ * t t- .---. — _-
- Page 3 and 4:
CAHIERS DU CREA Cahier n°1 : Modè
- Page 5 and 6:
AVANT-PROPOS Les textes réunis dan
- Page 7 and 8:
QUASI—OBJET ET ECHANGE SYMBOLIQUE
- Page 9 and 10:
13 L’expérience du vide social,
- Page 11 and 12:
15 un profond désir de n’être p
- Page 13 and 14:
en un maillon réciproque que la ch
- Page 15 and 16:
19 éclairage les deux principales
- Page 17 and 18:
désir. Posséder de l’argent, c
- Page 19 and 20:
- 23 marchandises ordinaires une ma
- Page 21 and 22:
26 C’est dans ce vide social enco
- Page 23 and 24:
- 28 apparences) nous permet de sai
- Page 25 and 26:
ce potentiel est le même. Ils sont
- Page 27 and 28:
36 est un Dieu qui existe en effet
- Page 29 and 30:
signe vers cette transcendance, au
- Page 31 and 32:
seulement sur le code de l’honneu
- Page 33 and 34:
42 l’un et l’autre impossible,
- Page 35 and 36:
44 Deuxième moment : dans son Esqu
- Page 37 and 38:
4.) pied de la lettre, mais il gros
- Page 39 and 40:
z. Z 48 sot p-ri4é-----±±—exi
- Page 41 and 42:
même suit sa loi illégale” ; et
- Page 43 and 44:
. 53 fl;; nous savons que Molière
- Page 45 and 46:
(16) P. Bénichou, Morales du Grand
- Page 47 and 48:
LA MYTHOLOGIE ET SA DECONSTRUCTION
- Page 49 and 50:
59 gie. C’est une mythologie en a
- Page 51 and 52:
61 la Vénus de Rubens ou du Titien
- Page 53 and 54:
- - 63 ser en a assez; fatinué, il
- Page 55 and 56:
- 65 rapport au christianisme. En p
- Page 57 and 58:
67 sible de dire, même aujourd’h
- Page 59 and 60:
ij$’ I encore des filles-fleurs d
- Page 61 and 62:
71 quel poussent les pommes de Frei
- Page 63 and 64:
73 traite le comme il a traité les
- Page 65 and 66:
75 C’est quand même étrange la
- Page 67 and 68:
- 77 Cette dichotomie du désir, ce
- Page 69 and 70:
79 de seconde zone, une espèce de
- Page 71 and 72:
81 Siegfried et GUnther, avant d’
- Page 73 and 74:
83 comprendre le lien jamais vraime
- Page 75 and 76:
85 luit dans leurs yeux”. Il est
- Page 77 and 78:
87 dont on découvre vite uuelie es
- Page 79 and 80:
89 Wotan. Il n’y a pas encore de
- Page 81 and 82:
fait le rapport avec la foule. 91 V
- Page 83 and 84:
93 dans I’(’rdu Rhin, c’est c
- Page 85 and 86:
Q. Si on suit votre thèse jusqu’
- Page 87 and 88:
—---—-- 97 Wotan et BrUnhilde.
- Page 89 and 90:
‘ç 99 “Dès qu’on voit appar
- Page 91 and 92:
101 ANNEXE EXTRAIT DE L’ARTICLE R
- Page 93 and 94:
Argument APROPOSDE F1JRY (FritzLang
- Page 95 and 96:
1051 d’excitation est vite attein
- Page 97 and 98:
fixe qu’elle s’imagine extérie
- Page 99 and 100:
109 de représentations, comme la f
- Page 101 and 102:
111 demande alors, et obtient, la p
- Page 103 and 104:
• • •• ‘ •asa —e—
- Page 105 and 106:
116 La vengeance enfin n’a d’au
- Page 107 and 108:
118 Dans l’espace social intermé
- Page 109 and 110:
120 La dette à verser, c’est l
- Page 111 and 112:
Essai pour interroger la pensée de
- Page 113 and 114:
ç 125 Le gnos a sa ori’tp i’.
- Page 115 and 116:
127 On voit que dans ce système (q
- Page 117 and 118:
que cet effilochement progressif de
- Page 119 and 120:
En quoi, maintenant, la dikè est
- Page 121 and 122:
133 desquels la violence meurtrièr
- Page 123 and 124:
que même si la pratique du bouc é
- Page 125 and 126:
oÎ la remise de la composition s
- Page 127 and 128:
On voit à quel point les symétrie
- Page 129 and 130:
141 autres par la violence, et qu
- Page 131 and 132:
NOTES 143 (1) Dans L’Accusation,
- Page 133 and 134:
146 Il serait non seulement diploma
- Page 135 and 136:
148 institutionnalisée est plus da
- Page 137 and 138:
150 Nous partirons d’un texte com
- Page 139 and 140:
152 mimétique. Soit deux personnag
- Page 141 and 142:
154 vérité objective de Lévi—S
- Page 143 and 144:
156 a identifiées dans l’échang
- Page 145 and 146:
158 s’exposer au risque d’être
- Page 147 and 148:
160 norme, le dénouement n’est p
- Page 149 and 150:
162 que dans sa pratique l’échan
- Page 151 and 152:
164 réciprocité que ces croyances
- Page 153 and 154:
16t, C’est donc la réversibilit
- Page 155 and 156:
sacré et p im profane brâhi’ien
- Page 157 and 158:
170 formulation de Mauss à la lett
- Page 159 and 160:
172 ternaire qui le distingue de la
- Page 161 and 162:
174 Nous allons terminer avec une d
- Page 163 and 164:
176 (19) Jean Baechler, Les Suicide
- Page 165 and 166:
SCIENCES COGNITIVES : FIL D’ARIAN
- Page 167 and 168:
tivime implique l’indéfinie vari
- Page 169 and 170:
183 Manuel d’anthropologie c’lt
- Page 171 and 172: et je reprends les termes mêmes de
- Page 173 and 174: 187 les institutions, qu’il s’a
- Page 175 and 176: 189 de touche d’une “anthropolo
- Page 177 and 178: :“ ‘191 que l’anthropologie a
- Page 179 and 180: 193 réclame de Needham, parvient
- Page 181 and 182: 195 Nuer pour usage interprétatif
- Page 183 and 184: 197 sensu. Si un terme est discutab
- Page 185 and 186: i99 D’où je coràidre que tout s
- Page 187 and 188: 2O1 J’ajoUte qu’à aLa connaiss
- Page 189 and 190: 203 ds Chaldé•ns à Sinstein, c
- Page 191 and 192: sQre de la science, elle ne fera qu
- Page 193 and 194: 2Ô7 11.1. Je commencerai donc par
- Page 195 and 196: ? f209 critique (50). Je note égal
- Page 197 and 198: .211 à immoler rituellement, tel l
- Page 199 and 200: 213 Neuf est ainsi l’homologue de
- Page 201 and 202: 215 dotées d’une forte prégnanc
- Page 203 and 204: 217 de surgir quand on confond une
- Page 205 and 206: 219 L’argument de Sperber est le
- Page 207 and 208: ment symbolique à une activité de
- Page 209 and 210: 223 Ici encore, il faut reconnaîtr
- Page 211 and 212: s’accoupler avec une bête mais i
- Page 213 and 214: 227 Seconde objection de Sperber :
- Page 215 and 216: par Leroi—Gour’han (80), et qui
- Page 217 and 218: 231 rangon de tous les mélanges et
- Page 219 and 220: 233 un examen plus attentif des cho
- Page 221: — bâti 235 km2 pour une populati
- Page 225 and 226: vie sociale en termes de communicat
- Page 227 and 228: estrictive. L’idée de base — q
- Page 229 and 230: 243 complémentaires (56:10—Il).
- Page 231 and 232: 245 en général commence per une c
- Page 233 and 234: 247e Sur ce point, Sperber ast en p
- Page 235 and 236: 24. fois de plus, Sperber ne parle
- Page 237 and 238: 251 la premièr’e étant à l’h
- Page 239 and 240: 253 Il est vrai qu’en s’employa
- Page 241 and 242: 255W pas: en exprime—t—die —
- Page 243 and 244: vanière . au 257 j bien, it c’es
- Page 245 and 246: 259 pour assurer le bonheur de son
- Page 247 and 248: 26 (SG:95) quand il suggère qu’o
- Page 249 and 250: 263 et tout à fait essentielle. fl
- Page 251 and 252: 265:1 limite pas à décrire ces co
- Page 253 and 254: 267 NOTES 1 — Les références au
- Page 255 and 256: 269 janvier—mars 1981, qui est un
- Page 257 and 258: 37 — Cf. 271 ficielle” dont nou
- Page 259 and 260: 273 116 — “Il faut bien admettr
- Page 261 and 262: 275 Piqué par la curiosité, j’a
- Page 263 and 264: 277. 67 — Girard a recours à cet
- Page 265 and 266: 279 9-1---- Pai’cetta oppos-it Io
- Page 267 and 268: 281 “Si l’échange s’effectua
- Page 269 and 270: 283 symbolique des couleurs (“La
- Page 271 and 272: 28 n’est astreint ni au tour cér
- Page 273 and 274:
287 qui sont d’ordre géométriqu
- Page 275 and 276:
11Ième PARTIE
- Page 277 and 278:
292 Dans les heures eLles jours de
- Page 279 and 280:
294 J.C. part en vacances. Et c’e
- Page 281 and 282:
296 H.G.: Mais, môme ici, nous les
- Page 283 and 284:
298 ta pire des solutions pour1utè
- Page 285 and 286:
300 1802 CHAPTAL, Ministre de l’I
- Page 287 and 288:
302 Mais la folie peut-elle encore
- Page 289 and 290:
304 Mais pouvons-nous encore mettre
- Page 291 and 292:
306 rencontrent plus. La société
- Page 293 and 294:
L IMPOSSIBLE REPUBLIQUE CHRETIENNE
- Page 295 and 296:
311 moderne du terme. 7 C’est don
- Page 297 and 298:
313 eut pu régner sur tous les aut
- Page 299 and 300:
315 pouvoir pour déterminer les lo
- Page 301 and 302:
317 irrationnelles des sujets est c
- Page 303 and 304:
319 lorsque les prêtres imposent d
- Page 305 and 306:
E] 321 CHAPITRE II Le problème pol
- Page 307 and 308:
323 protection est déjà absolue.
- Page 309 and 310:
P] 325 Examinons maintenant une pre
- Page 311 and 312:
327 rj. puisque le souverain est se
- Page 313 and 314:
329 deux sont les interprètes d’
- Page 315 and 316:
331 Les deux caractéristiques prin
- Page 317 and 318:
333 La seule réponse possible est
- Page 319 and 320:
335 dignes de l’immortalité.”(
- Page 321 and 322:
337 afin de rejeter toute prétenti
- Page 323 and 324:
339 d’interprétation, car Dieu n
- Page 325 and 326:
341 Chapitre IV Le dernier livre du
- Page 327 and 328:
343 selon laquelle 1’Eglise qui s
- Page 329 and 330:
345 guerre civile donne les conditi
- Page 331 and 332:
s 347 dont les transformations reli
- Page 333 and 334:
349 10. En anglais, “0f the Kingd
- Page 335 and 336:
351 17.Contrairement à ce prétend
- Page 337 and 338:
353 32. Voyez le chapître 37 où H
- Page 339:
355 pour chacun l’expression parf