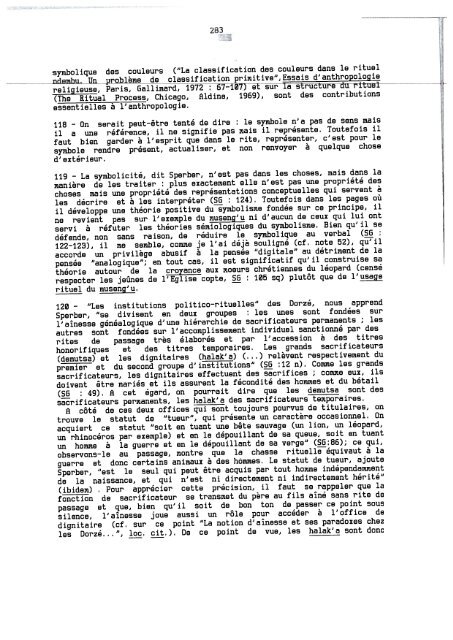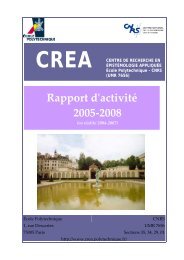i- :1 :4 - - Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée
i- :1 :4 - - Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée
i- :1 :4 - - Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
283<br />
symbolique <strong>de</strong>s couleurs (“La classification <strong>de</strong>s couleurs dans le rituel<br />
n<strong>de</strong>mbuUnproblème <strong>de</strong> classification primitive”, Essais d’ anthropologie<br />
religieuse, Paris, 6allimard, 1972 : 67—lØ7Tét sur1tiÏture drttue1-<br />
(The Ritual Process, Chicago, Aldine, 1969), sont <strong>de</strong>s contributions<br />
ess<strong>en</strong>tielles à l’anthropologie.<br />
118 —<br />
On<br />
serait peut—être t<strong>en</strong>té <strong>de</strong> dire : le symbole n’a pas <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s i’iais<br />
Il a une référ<strong>en</strong>ce, il ne signifie pas mais il représ<strong>en</strong>te. Toutefois Il<br />
faut bi<strong>en</strong> gar<strong>de</strong>r à l’esprit que dans le rite, représ<strong>en</strong>ter, c’est pour le<br />
symbole r<strong>en</strong>dre prés<strong>en</strong>t, actualiser, et non r<strong>en</strong>voyer à quelque chose<br />
d’extérieur.<br />
119 —<br />
La<br />
symbolicité, dit Sperber, n’est pas dans les choses, mais dans la<br />
manière <strong>de</strong> les traiter : plus exactem<strong>en</strong>t elle n’est pas une propriété <strong>de</strong><br />
choses nais une propriété <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tations conceptuelles qui serv<strong>en</strong>t à<br />
les décrire et à les interpréter (Sf3 : 124). Toutefois dans les pages où<br />
il développe une théorie positive du symbolisme fondée sur ce principe, il<br />
ne revi<strong>en</strong>t pas sur l’exemple du nus<strong>en</strong>g’u ni d’aucun <strong>de</strong> ceux qui lui ont<br />
servi à réfuter les théories sémiologiques du symbolisme. Bi<strong>en</strong> qu’ il se<br />
déf<strong>en</strong><strong>de</strong>, non sans raison, <strong>de</strong> réduire le symbolique au verbal (Sf3<br />
122—123), il ie semble, comme je l’ai déjà souligné (cf. note 52), qu’il<br />
accor<strong>de</strong> un privilège abusif à la p<strong>en</strong>sée “digitale” au détrim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />
p<strong>en</strong>sée “analogique” <strong>en</strong> tout cas, il est significatif qu’ il construise sa<br />
théorie autour <strong>de</strong> la croyance aux moeurs chréti<strong>en</strong>nes du léopard (c<strong>en</strong>sé<br />
respecter les jeûnes <strong>de</strong> l’Eglise copte, Sf3 : 105 sq) plutôt que <strong>de</strong> l’usage<br />
rituel du mus<strong>en</strong>g’u.<br />
120 —<br />
“Les<br />
institutions politico—rituelles” <strong>de</strong>s Dorzé, nous appr<strong>en</strong>d<br />
Sperber, “se divis<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux groupes : les unes sont fondées sur<br />
l’aînesse généalogique d’une hiérarchie <strong>de</strong> sacrificateurs perman<strong>en</strong>ts les<br />
autres sont fondées sur l’accomplissem<strong>en</strong>t individuel sanctionné par <strong>de</strong>s<br />
rites <strong>de</strong> passage très élaborés et par l’accession à <strong>de</strong>s titres<br />
honorifiques et <strong>de</strong>s titres temporaires. Les grands sacrificateurs<br />
(<strong>de</strong>mutsa) et les dignitaires (halak’a) (...) relèv<strong>en</strong>t respectivem<strong>en</strong>t du<br />
premier et du second groupe d’institutions” (Sf3 :12 n). Comme les grands<br />
sacrificateurs, les dignitaires effectu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sacrifices comme eux, ils<br />
doiv<strong>en</strong>t être mariés et ils assur<strong>en</strong>t la fécondité <strong>de</strong>s hommes et du bétail<br />
(56 : 49). A cet égard, on pourrait dire que les <strong>de</strong>mutsa sont <strong>de</strong>s<br />
sacrificateurs perman<strong>en</strong>ts, les halak’a <strong>de</strong>s sacrificateurs temporaires,<br />
A côté <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux offices qui sont toujours pourvus <strong>de</strong> titulaires, on<br />
trouve le statut <strong>de</strong> “tueur”, qui prés<strong>en</strong>te un caractère occasionnel. On<br />
acquiert ce statut “soit <strong>en</strong> tuant une bête sauvage (un lion, un léopard,<br />
un rhinocéros par exemple) et <strong>en</strong> le dépouillant <strong>de</strong> sa queue, soit <strong>en</strong> tuant<br />
un homme à la guerre et <strong>en</strong> le dépouillant <strong>de</strong> sa verge” (S6:86). ce qui,<br />
observons—le au passage, montre que la chasse rituelle équivaut à la<br />
guerre et donc certains animaux à <strong>de</strong>s hômmes, Le statut <strong>de</strong> tueur, ajoute<br />
Sperber, “est le seul qui peut être acquis par tout homme indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> la naissance, et qui n’est ni directem<strong>en</strong>t ni indirectem<strong>en</strong>t hérité”<br />
(ibi<strong>de</strong>m) , Pour apprécier cette précision, il faut se rappeler que la<br />
fonction <strong>de</strong> sacrificateur se transmet du père au fils aîné sans rite <strong>de</strong><br />
passage et que, bi<strong>en</strong> qu’ il soit <strong>de</strong> bon ton <strong>de</strong> passer ce point sous<br />
sil<strong>en</strong>ce, l’aînesse joue aussi un rôle pour accé<strong>de</strong>r à l’office <strong>de</strong><br />
dignitaire (cf sur ce point “La notion d’aînesse et ses paradoxes chez<br />
les Dorzé. , .“, loc cit.). De ce point <strong>de</strong> vue, les halak’a sont donc