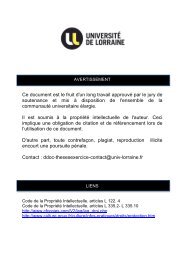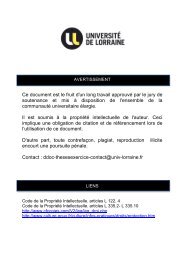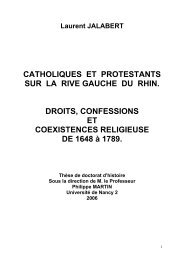- Page 1:
Université Paul Verlaine-Metz U.F.
- Page 4 and 5:
À mes parents et mes frères 3
- Page 6 and 7:
2. Qui sont les djinn ? ...........
- Page 8 and 9:
NOTE SUR LE SYSTÈME DE TRANSLITTÉ
- Page 10 and 11:
étranges. La connaissance du don d
- Page 12 and 13:
pu recueillir au sujet de la posses
- Page 14 and 15:
I MÉTHODOLOGIE 1. Pourquoi un tel
- Page 16 and 17:
Lorsque j’arrivais sur le terrain
- Page 18 and 19:
fait étranger au domaine du sacré
- Page 20 and 21:
cigarettes. Je représentais la Fra
- Page 22 and 23:
Mes informateurs ne parlaient pas
- Page 24 and 25:
je ne suis pas le seul dans ce cas.
- Page 26 and 27:
II BIR EL HAFFEY, SI PROCHE ET SI L
- Page 28 and 29:
quatre familles 2 . La plus importa
- Page 30 and 31:
LA DESCENDANCE DES HAMAMA )toujours
- Page 32 and 33:
ses compagnons de lui expliquer ce
- Page 34 and 35:
végétation, lorsqu’elle n’est
- Page 36 and 37:
sur un système de crédit officieu
- Page 38 and 39:
Bir El Haffey, la tradition veut qu
- Page 40 and 41:
Jean Duvignaud précise, toujours d
- Page 42 and 43:
Généralement les filles aident le
- Page 44 and 45:
La profession de foi (détaillée d
- Page 46 and 47:
voix ou à voix basse selon le cont
- Page 48 and 49:
s’ouvrir les portes du paradis. M
- Page 50 and 51:
Les enfants qui ne sont pas pubère
- Page 52 and 53:
DEUXIÈME PARTIE L’HÉRITAGE EST
- Page 54 and 55:
même de prophète. Lorsque j’app
- Page 56 and 57:
Il nous est arrivé plus d’une fo
- Page 58 and 59:
petit-fils (et non pas le fils comm
- Page 60 and 61:
propreté des lieux laissent à dé
- Page 62 and 63:
ci nous apprit que notre informateu
- Page 64 and 65:
voyous. Il faut supporter leurs par
- Page 66 and 67:
pendant le jour, on écoute le henn
- Page 68 and 69:
arabe de kamūn. Le kamūn est une
- Page 70 and 71:
II LA PREMIÈRE DES QUALITÉS DU MA
- Page 72 and 73:
sur le terrain ne correspondent pas
- Page 74 and 75:
avec ces pratiques. Dès sa naissan
- Page 76 and 77:
L’empreinte laissée sur la porte
- Page 78 and 79:
sortis vomir. Rabah nous dit qu’i
- Page 80 and 81:
apprendre d’avantage : l’alphab
- Page 82 and 83:
Un jour Rabah eut à effectuer l’
- Page 84 and 85:
vie de bohème, une personne margin
- Page 86 and 87:
Un entretien fut fixé avec Mohamed
- Page 88 and 89:
puis dans l’autre )il me dit que
- Page 90 and 91:
nous mêmes nous n’y étions pas
- Page 92 and 93:
convenable. Mais le fait d’avoir
- Page 94 and 95:
Rabah _ Mohamed, il travaille avec
- Page 96 and 97:
Moh _ De la sueur sur ton front ? E
- Page 98 and 99:
grands anges (sing. malik, plur. ma
- Page 100 and 101:
appartiens aux femmes, sors des vê
- Page 102 and 103:
III DE LA POSSESSION… 1. La commu
- Page 104 and 105:
Rabah _ Tu n’es pas amoureux? Eth
- Page 106 and 107:
ce tombeau, des séances de possess
- Page 108 and 109:
marabouts peut être une aide pour
- Page 110 and 111:
Gilbert Rouget précise que : « La
- Page 112 and 113:
de nos informateurs : Rabah disting
- Page 114 and 115:
Bir El Haffey, est jugée dotée de
- Page 116 and 117:
sensibilité exacerbée. Selon Raba
- Page 118 and 119:
Elle prenait un air d’autorité l
- Page 120 and 121:
démoniaques. De fait, il semble bi
- Page 122 and 123:
Après quelques minutes, quand ils
- Page 124 and 125:
affranchi par le prophète Mohamed
- Page 126 and 127:
dans les souks. Le plus utilisé es
- Page 128 and 129:
fourre tout de possession. Peuvent
- Page 130 and 131:
aux yeux de l’ethnologue 1 . Nous
- Page 132 and 133:
attaques. D’où lui vient ce pouv
- Page 134 and 135:
…Bel _ Alors Rabah dit que « J
- Page 136 and 137:
tout ce que vous demandez comme arg
- Page 138 and 139:
Bel _ Il marche à pied pendant de
- Page 140 and 141:
Rabah _ Rūhānī, c’est à dire
- Page 142 and 143:
Le rūh, c’est le lien qui existe
- Page 144 and 145:
dans une autre pièce. Sa lèvre é
- Page 146 and 147:
Et de fait, ce talisman est jugé t
- Page 148 and 149:
Rabah _ Pourquoi ? Ethn _ Parce que
- Page 150 and 151:
REPRODUCTION DU TALISMAN Au nom de
- Page 152 and 153:
Pour évoquer cette faculté, Rabah
- Page 154 and 155:
Ethn _ C’est difficile. Rabah _ M
- Page 156 and 157:
L’équipe de Rabah est, pour nous
- Page 158 and 159:
le contrôle et la surveillance d
- Page 160 and 161:
Selon Gilbert Rouget, « […] le d
- Page 162 and 163:
moment. Je veux connaître ce calcu
- Page 164 and 165:
Prophète ! si ta main me sauve De
- Page 166 and 167:
Dès ce moment, et durant une grand
- Page 168 and 169:
par les démons… » 1 . J’appri
- Page 170 and 171:
Mohamed le Charlatan occupe dans la
- Page 172 and 173:
démarche scientifique (Matter of f
- Page 174 and 175:
Ethn _ Est-ce que toute ta famille
- Page 176 and 177:
ite d’agrégation. Nous étions p
- Page 178 and 179:
par l’œil, « mais il y a bien l
- Page 180 and 181:
Une nouvelle personne vient à notr
- Page 182 and 183:
cet homme ? Il possédait un savoir
- Page 184 and 185:
Et pour nous convaincre d’une pro
- Page 186 and 187:
pas basculer du jour au lendemain.
- Page 188 and 189:
l’épisode de l’œil. Cependant
- Page 190 and 191:
Rabah _ ‘Ayn c’est l’œil, le
- Page 192 and 193:
trouver un lien ? Pourquoi Rabah no
- Page 194 and 195:
Aicha 1 . Il va de soit que ces deu
- Page 196 and 197:
…Bel _ C’est pour une autre mal
- Page 198 and 199:
utilisées par bon nombre d’autre
- Page 200 and 201:
…Bel _ Alors elle dit : « il y a
- Page 202 and 203:
Sur un plan plus symbolique, même
- Page 204 and 205:
on être également caressé du reg
- Page 206 and 207:
Bel _ C’est que lorsque les gens
- Page 208 and 209:
Ethn _ Moi on m’a dit sept jours.
- Page 210 and 211:
objet 1 . Alors que parfois, chez c
- Page 212 and 213:
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS LES ÉLÉM
- Page 214 and 215:
II « L’ESPRIT DE CORPS » 1 (sui
- Page 216 and 217:
l’oasis de Nefta, dont nous avons
- Page 218 and 219:
le praticien quand elle n’est pas
- Page 220 and 221:
seulement. Certes, nous avons dress
- Page 222 and 223:
Ould Cheikh, la présence de la mè
- Page 224 and 225:
Rabah a dit que Toumi, son père, a
- Page 226 and 227:
peu, voire pas du tout. Cependant,
- Page 228 and 229:
en la personne de Rabah, la baraka
- Page 230 and 231:
les cheminements de l’élection
- Page 232 and 233:
N’oublions pas que l’une des gr
- Page 234 and 235:
de cette famille est Sidi Arket, un
- Page 236 and 237:
Ce parfum particulier, cette bonne
- Page 238 and 239:
famille et encore moins de cette ni
- Page 240 and 241:
incapable de leur fournir un ordre
- Page 242 and 243:
Jamila Ali Amor (Akrimi) Avant de d
- Page 244 and 245:
GÉNÉALOGIE DE FATMA ZINA )ses fr
- Page 246 and 247:
notamment un des rôles attribués
- Page 248 and 249:
partie suivante. Cette rupture est
- Page 250 and 251:
notamment les descendants de mon gr
- Page 252 and 253:
contact avec la surnature. Ils desc
- Page 254 and 255:
Sur notre terrain, la famille Akrim
- Page 256 and 257:
Akrimi est plus consommatrice de ba
- Page 258 and 259:
III LES MODALITÉS DE L’INITIATIO
- Page 260 and 261:
Selma _ Avoir un travail, finir nos
- Page 262 and 263:
Pourquoi, alors, l’initiation n
- Page 264 and 265:
Akrimi attachait au marabout, nous
- Page 266 and 267:
de l’élection. C’est à partir
- Page 268 and 269:
combien le fait de maîtriser la su
- Page 270 and 271:
fort. Peut-être que nos thérapeut
- Page 272 and 273:
Hammoudi, le détachement de soi, l
- Page 274 and 275:
permanence dans les deux sens du te
- Page 276 and 277:
commun. Or à l’âge où vraisemb
- Page 278 and 279:
l’individu serait celui du mauvai
- Page 280 and 281:
avons observé Mohsen en train de p
- Page 282 and 283: lui plaire )revêtir les traits fé
- Page 284 and 285: de nos informateurs - que s’en re
- Page 286 and 287: dépossessions en la plus lumineuse
- Page 288 and 289: J’ai appelé les shaikh de Gafsa
- Page 290 and 291: soit l’intention de raconter ses
- Page 292 and 293: n’est pas seulement parce que son
- Page 294 and 295: pour autant. Devant nos initiés, d
- Page 296 and 297: QUATRIÈME PARTIE RÉ ENCHANTER LE
- Page 298 and 299: I L’ÉMERGENCE DES RELIGIOSITÉS
- Page 300 and 301: Pourquoi alors ne s’adresser qu
- Page 302 and 303: désigné comme différent des autr
- Page 304 and 305: de se pencher sur la réalité de l
- Page 306 and 307: Samantha a été mariée et, de ce
- Page 308 and 309: Samantha _ Ah ouais ! Je vais t’e
- Page 310 and 311: un rapprochement avec la tradition
- Page 312 and 313: La deuxième dimension était repr
- Page 314 and 315: virilité de Rabah aurait pu être
- Page 316 and 317: toutes les conventions qui régisse
- Page 318 and 319: En dressant notre schéma sur l’
- Page 320 and 321: II ET DIEU CRÉA AICHA QONDICHA 1.
- Page 322 and 323: d’identité masculine […] » 1
- Page 324 and 325: lieux, la symbolique est la même :
- Page 326 and 327: mesure d’assumer notre rôle. Aic
- Page 328 and 329: Rabah nous le fit comprendre grâce
- Page 330 and 331: femmes et la virilité des hommes,
- Page 334 and 335: sanctuaires de sa famille (celui de
- Page 336 and 337: esoin d’explications farfelues ou
- Page 338 and 339: qui le convoite, de même que le pl
- Page 340 and 341: éagir à celui qui est atteint de
- Page 342 and 343: Philippe Rosbapé précise que l’
- Page 344 and 345: Notre mode d’approche a consisté
- Page 346 and 347: Le moment est venu de redonner la p
- Page 348 and 349: de sacrifier une partie de son temp
- Page 350 and 351: expérience. […] L’observation
- Page 352 and 353: dictaphone. Car le mot, c’est une
- Page 354 and 355: mêmes, avant de côtoyer les anges
- Page 356 and 357: GLOSSAIRE (des termes arabes indisp
- Page 358 and 359: Gatrān : « savon des dromadaires
- Page 360 and 361: Mishayyikh : terme qui désigne l
- Page 362 and 363: BIBLIOGRAPHIE ABEL Olivier (sous la
- Page 364 and 365: LAPLANTINE François (sous la dir.)
- Page 366 and 367: Une semaine après, nous y sommes a
- Page 368 and 369: Ethn _ Et Jédi Ali il avait des li
- Page 370 and 371: Rabah _ J’ai des choses… magnif
- Page 372 and 373: Rabah _ Euh ! mon grand-père ben B
- Page 374 and 375: Rabah _ Du château d’eau, il a m
- Page 376 and 377: Monsieur Toumi, le père de Rabah a
- Page 378 and 379: Bel _ Il insiste. Il insiste. Rabah
- Page 380 and 381: Rabah _ Je ne comprends rien ! Ethn
- Page 382 and 383:
Rabah _ Et il peut prendre un…
- Page 384 and 385:
Rabah _ Non, je suis pas un patron
- Page 386 and 387:
Bel _ Qui peuvent intervenir pour l
- Page 388 and 389:
Rabah _ Quelqu’un qui existe ici
- Page 390 and 391:
Bel _ Mohamed ! Rabah _ Et ça c’
- Page 392:
cours, au début de mon séjour, il
- Page 395 and 396:
nœuds et de la faiblesse sexuelle
- Page 397 and 398:
parce que dieu voulait la sagesse p
- Page 399:
faveur dans les cieux le remercient
- Page 402 and 403:
3 Biographie de l’illustre membre
- Page 404 and 405:
4 Généalogies de Aicha, Zidiya et
- Page 406 and 407:
5 Autres chants enregistrés au zā
- Page 408 and 409:
Il n’y a aucun vivant heureux / T
- Page 410 and 411:
Ouvre ta porte ouvre-là / Ceux qui
- Page 412:
L’objet de cette étude est une c