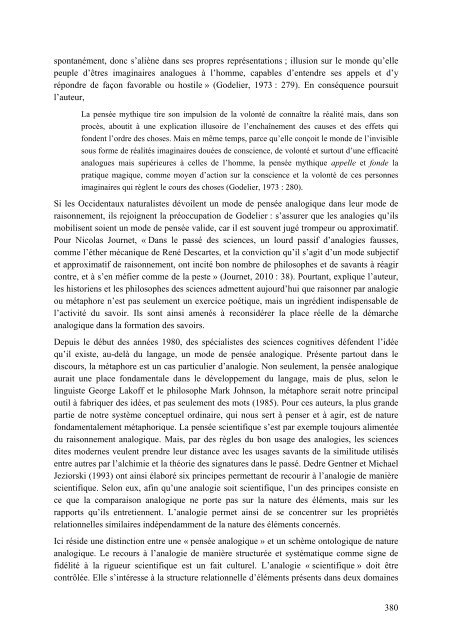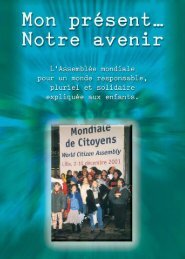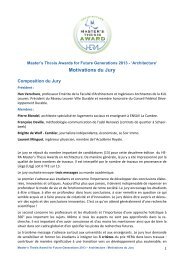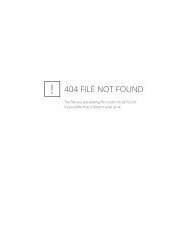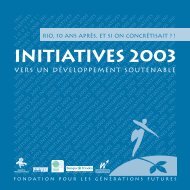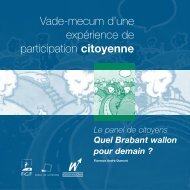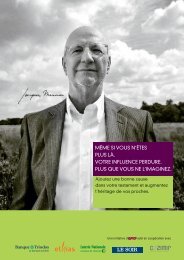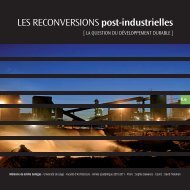- Page 1:
Faculté des sciences économiques,
- Page 5:
Cette thèse n’aurait pu être r
- Page 9:
À Corentin, du celte « Korwentenn
- Page 13 and 14:
Pentecôtisme et demande de rituels
- Page 15 and 16:
INTRODUCTIONStan mais encore Agatha
- Page 17 and 18:
Les eaux et les coulées de boues o
- Page 19 and 20:
m’ont naturellement conduite vers
- Page 21 and 22:
PRELUDE ETHNOGRAPHIQUEET METHODOLOG
- Page 24 and 25:
Légende des photographies de Julie
- Page 26 and 27:
Le soleil progresse vers la vertica
- Page 28 and 29:
Carte 1 : Territoire municipal de S
- Page 30 and 31:
A l’exception des plateaux des Cu
- Page 32 and 33:
population mam, celle-ci a reçu un
- Page 34 and 35:
À San Martín, 85% des habitants d
- Page 36 and 37:
La langue généralement utilisée
- Page 38 and 39:
à tour de rôle (afin de ménager
- Page 40 and 41:
Outre l’identification du corps d
- Page 42 and 43:
Dans un premier temps, j’ai abond
- Page 44 and 45:
démontrent combien, le décentreme
- Page 46 and 47:
facteurs d’hétérogénéité obs
- Page 48 and 49:
comme Carmen, de partager leurs exp
- Page 50 and 51:
concepts. À partir de ce travail d
- Page 52 and 53:
Figure 2: Kitsal “quetzal” ou p
- Page 55:
CHAPITRE I : QUAND LA TEMPÊTE STAN
- Page 59 and 60:
Dans ce chapitre, je m’arrêterai
- Page 61 and 62:
données sont extraites des bases d
- Page 63 and 64:
Disaster Date Number Killed1 Flood
- Page 65 and 66:
annuelles à 60 naissances. Les tin
- Page 67 and 68:
intertropicale, la présence de deu
- Page 69 and 70:
L’alternance et la complémentari
- Page 71 and 72:
Au Guatemala, comme dans toute l’
- Page 73 and 74:
Les précisions climatiques apport
- Page 75 and 76:
appel à la communauté internation
- Page 77 and 78:
phénomène naturel, je dois m’im
- Page 79 and 80:
n’avait eu lieu ici », explique
- Page 81 and 82:
porte et dit : “ Jenny, lève-toi
- Page 83 and 84:
pouvaient plus recevoir nos appels
- Page 85 and 86:
De nombreuses personnes expliquent
- Page 87 and 88:
Afin de ménager les susceptibilit
- Page 89 and 90:
Ainsi, selon le diagnostic de Chojo
- Page 91 and 92:
afin de retrouver la source déplac
- Page 93 and 94:
Le phénomène Stan provoqua des d
- Page 95 and 96:
L’historienne Mercier-Faivre (200
- Page 97:
CHAPITRE II : LA CATASTROPHE COMME
- Page 101 and 102:
De l’événement au processusDepu
- Page 103 and 104:
des arrêts et d’analyser l’év
- Page 105 and 106:
veux dire, c’est que mes grands-p
- Page 107 and 108:
concernant la couverture forestièr
- Page 109 and 110:
Afrique, environ 50% en Asie de l
- Page 111 and 112:
second élément qui amène les tin
- Page 113 and 114:
Autrefois, relatent encore les aîn
- Page 115 and 116:
Au lendemain de Stan, alors que des
- Page 117 and 118:
Dans la municipalité étudiée, le
- Page 119 and 120:
type de propriété de la terre, ce
- Page 121 and 122:
Le contrôle vertical des paliers
- Page 123 and 124:
par exemple que de nombreuses commu
- Page 125 and 126:
villages, la population s’accrois
- Page 127 and 128:
Ils apportaient de l’eau-de-vie.
- Page 129 and 130:
Bot, 1992 : 34). La guerre civile,
- Page 131 and 132:
de 6 % de paysans possède 22 % des
- Page 133 and 134:
3. Transformation du territoire et
- Page 135 and 136:
territoire mexicain et entrer illé
- Page 137 and 138:
L’envoi d’argent gagné en migr
- Page 139 and 140:
La possession des terres est une ch
- Page 141 and 142:
« jeune jeunesse » (juventud jove
- Page 143 and 144:
demeures à étages restent parfois
- Page 145 and 146:
dont essentiellement, la pomme de t
- Page 147 and 148:
cette hypothèse, Carey démontre c
- Page 149 and 150:
qui permet au sol de retrouver sa s
- Page 151 and 152:
guérir et de produire davantage et
- Page 153 and 154:
souffrons d’une lutte économique
- Page 155 and 156:
Conclusion : Inégalités socio-éc
- Page 157 and 158:
Au Guatemala, l’impact de Stan s
- Page 159 and 160:
DEUXIÈME PARTIE :STANOUL’ENVIRON
- Page 162 and 163:
Légende des photographies de Julie
- Page 164 and 165:
Martín. Dans ce chapitre la questi
- Page 166 and 167:
L’Église catholique prend une pl
- Page 168 and 169:
spiritualité maya affirme que la v
- Page 170 and 171:
chamanes k’iche’ et des chamane
- Page 172 and 173:
conduisant vers l’inframonde (Bro
- Page 174 and 175:
Le lieu et les moments de consultat
- Page 176 and 177:
Introduites par le gouvernement lib
- Page 178 and 179:
À San Martín, le pourcentage de c
- Page 180 and 181:
Alors que les phénomènes migratoi
- Page 182 and 183:
à ce jeu » (Corten, 1998 : 8). Au
- Page 184 and 185:
temps forts du calendrier agricole
- Page 186 and 187:
184
- Page 188 and 189:
1. Conception cyclique du temps et
- Page 190 and 191:
Álvaro Méndez, habitant de la mun
- Page 192 and 193:
confort psychologique aux victimes
- Page 194 and 195:
clôture un cycle de 52 ans, mais s
- Page 196 and 197:
2. Origine divine de Stan et signe
- Page 198 and 199:
premier au dernier livre de l’Apo
- Page 200 and 201:
évacués de San Martín, s’empre
- Page 202 and 203:
uniquement vers Dieu ! Car on peut
- Page 204 and 205:
catastrophe. Pour Sylvie Pedron-Col
- Page 206 and 207:
cette période dans l’altiplano :
- Page 208 and 209:
3. Prophéties mayas et changements
- Page 210 and 211:
D’une part, les données de carac
- Page 212 and 213:
façon, ils font référence aux t
- Page 214 and 215:
Pour Pablo également, « le temps
- Page 216 and 217:
echerchée dans les actes destructe
- Page 218 and 219:
Pour les tinecos, la préoccupation
- Page 220 and 221:
(2006), cette prophétie contient d
- Page 222 and 223:
s’accomplissent toutes : les deux
- Page 224 and 225:
quelle est notre unité ? Chacun tr
- Page 226 and 227:
Controverse autour des changements
- Page 228 and 229:
Conclusion : Cycles et prophéties
- Page 230 and 231:
les consciences humaines dans leur
- Page 232 and 233:
230
- Page 234 and 235:
une question qui a été abondammen
- Page 236 and 237:
1. Des relations coutumières avec
- Page 238 and 239:
donnait bien ! Et à chaque fois, v
- Page 240 and 241:
Le copal était l’encens par exce
- Page 242 and 243:
Les évangéliques qualifient égal
- Page 244 and 245:
Mais comme disait mon trisaïeul, i
- Page 246 and 247:
font des pactes avec lui, ils font
- Page 248 and 249:
2. Cartographie des figures de l’
- Page 250 and 251:
toute entité vivante, le tanim inc
- Page 252 and 253:
une bronchite etc. Et tout le monde
- Page 254 and 255:
même s’il ne le sait pas, même
- Page 256 and 257:
aujourd’hui communément appelé
- Page 258 and 259:
Mon maître ne m’a jamais parlé
- Page 260 and 261:
économiques ne peuvent être sépa
- Page 262 and 263:
naissance (ce que García Ruiz nomm
- Page 264 and 265:
Julie: Ça n’a rien à voir avec
- Page 266 and 267:
Plus radical encore, selon les cham
- Page 268 and 269:
est la vie même. Tout comme nous s
- Page 270 and 271:
que la terre veut danser, elle veut
- Page 272 and 273:
profond respect envers les principe
- Page 274 and 275:
Mais si l’on respecte la lagune C
- Page 276 and 277:
Le jeune Humberto, qui se dit évan
- Page 278 and 279:
sacrées. C’est pour cela que ça
- Page 280 and 281:
passé, nous avons fait quatre cér
- Page 282 and 283:
Julie : Mais alors, l’objectif es
- Page 284 and 285:
passage de Stan. Or des oublis de c
- Page 286 and 287:
quotidiennement que la lagune attir
- Page 288 and 289:
membres de l’Église catholique,
- Page 290 and 291:
l’incertitude quant au du bon dé
- Page 292 and 293:
4. Coexistence de représentations
- Page 294 and 295:
Les pentecôtistes ne sont donc pas
- Page 296 and 297:
culture maya, mené par un leadersh
- Page 298 and 299:
la culture ladino, métisse, ou mis
- Page 300 and 301:
théologie locale hybride combinant
- Page 302 and 303:
s’efforcent de rester conformes a
- Page 304 and 305:
Ces énonciations rejoignent les r
- Page 306 and 307:
304
- Page 308:
Figure 5: Xch’ok “zigzag”,mot
- Page 311 and 312:
TROISIÈME PARTIE : STAN OU LA COEX
- Page 313 and 314:
CHAPITRE V : TRANSMISSION DES SAVOI
- Page 315 and 316:
Traditionnellement, le risque est d
- Page 317 and 318:
1. Remise en question de l’autori
- Page 319 and 320:
du singulier mais presque toujours
- Page 321 and 322:
Disparition d’une éducation à l
- Page 323 and 324:
Juana : Je ne sais pas. Ce que je s
- Page 325 and 326:
destinés à l’agriculture, consi
- Page 327 and 328:
2. « Gestion des risques » de men
- Page 329 and 330:
de la thématique de la gestion des
- Page 331 and 332: éduire, de prendre à sa charge et
- Page 333 and 334: également la logique des gestionna
- Page 335 and 336: 3. Tensions entre savoirs coutumier
- Page 337 and 338: que vous ne croyez pas en Dieu, c
- Page 339 and 340: (…) Ici, dit-elle, c’est par p
- Page 341 and 342: savoirs traditionnels. La légitimi
- Page 343 and 344: Conclusion : Principe de participat
- Page 345 and 346: vivantes non humaines, tout comme l
- Page 347 and 348: CHAPITRE VI : MODÉLISER LES RAPPOR
- Page 349 and 350: Le précédent chapitre s’est pen
- Page 351 and 352: individuelle et collective qu’il
- Page 353 and 354: ont été questionnés les système
- Page 355 and 356: 1. La cosmovision mam et l’ontolo
- Page 357 and 358: humains des problèmes qui détruis
- Page 359 and 360: Ces structures constituent pour l
- Page 361 and 362: froid, elle a tendance à ne pas av
- Page 363 and 364: comme je ne voulais pas devenir cha
- Page 365 and 366: l’Occident, et ses ancêtres n’
- Page 367 and 368: « Cette énergie dépend du jour d
- Page 369 and 370: actuellement manipulés avec plus o
- Page 371 and 372: combinée avec la logique segmentai
- Page 373 and 374: montagnes, le maïs… Lors des cé
- Page 375 and 376: don, si l’on veut bien prendre ce
- Page 377 and 378: dominant peuvent également être p
- Page 379 and 380: si seul l’un d’entre eux s’ex
- Page 381: Selon l’auteur, la pensée analog
- Page 385 and 386: Conclusion : D’un universalisme p
- Page 387 and 388: Non pas en les envisageant d’embl
- Page 389 and 390: CONCLUSIONS :REPRÉSENTATIONS, CONS
- Page 391 and 392: CONCLUSIONS : REPRÉSENTATIONS, CON
- Page 393 and 394: Pour Bankoff, la définition des te
- Page 395 and 396: situation d’hétérogénéité de
- Page 397 and 398: pertinence analytique de cette noti
- Page 399 and 400: décentrement que propose la démar
- Page 401 and 402: POSTFACE :IMPLICATION PRATIQUE ET P
- Page 403 and 404: POSTFACE : IMPLICATION PRATIQUE ET
- Page 405 and 406: (Revet, 2009 : 89). Malheureusement
- Page 407 and 408: est souvent absente des débats sur
- Page 409 and 410: BIBLIOGRAPHIEOuvrages et articles c
- Page 411 and 412: CAMPOS GOENAGA M., 2008, « Cuando
- Page 413 and 414: FOSSIER A., 2006, « Par-delà natu
- Page 415 and 416: HAMAYON R., 1995, « Pour en finir
- Page 417 and 418: LAPLANTINE F., 1987, Clefs pour l
- Page 419 and 420: PALMA I., DARDÓN J., 2008, « La e
- Page 421 and 422: SASSAMAN K., OLIVER-SMITH A., 2011
- Page 423 and 424: WEBSTER P. J., HOLLAND G. J., CURRY
- Page 425 and 426: INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, V
- Page 427 and 428: ANNEXESGlossaire des termes vernacu
- Page 429 and 430: wutzxjawLa montagne. Par extension,
- Page 431 and 432: CONREDCREDDAPMAFAOGIECINABINELA RED
- Page 433 and 434:
• Le 4 octobre : à 3h du matin,
- Page 436 and 437:
k’u’lb’il de San Martín Saca
- Page 438 and 439:
OTONIEL GARCÍA aliasOtto34 ansBarr
- Page 440 and 441:
YECENIAMONTERROSO28 F k'iche' SM Ca
- Page 442 and 443:
JENNY MINERADÍAZ32 F ladina SM Cab
- Page 444 and 445:
MARTÍN (DUDAPMA)-25 M mam SM Santa
- Page 446 and 447:
PADRE MIGUEL -40 M k'iche' SM Cabec
- Page 449 and 450:
447