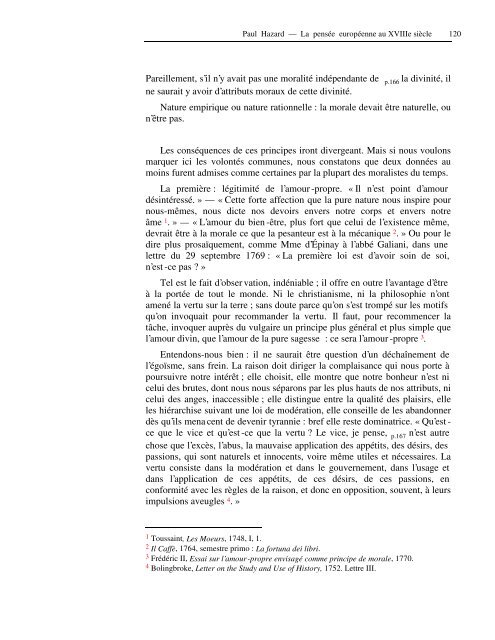La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 120<br />
Pareillement, s’il n’y avait pas une moralité indépendante de p.166 la divinité, il<br />
ne s<strong>au</strong>rait y avoir d’attributs mor<strong>au</strong>x de cette divinité.<br />
Nature empirique ou nature rationnelle : la morale devait être naturelle, ou<br />
n’être pas.<br />
<strong>Les</strong> conséquences de ces principes iront divergeant. Mais si nous voulons<br />
marquer ici les volontés communes, nous constatons que deux données <strong>au</strong><br />
moins furent admises comme certaines par la plupart <strong>des</strong> moralistes du temps.<br />
<strong>La</strong> première : légitimité de l’amour -propre. « Il n’est point d’amour<br />
désintéressé. » — « Cette forte affection que la pure nature nous inspire pour<br />
nous-mêmes, nous dicte nos devoirs envers notre corps et envers notre<br />
âme 1. » — « L’amour du bien -être, plus fort que celui de l’existence même,<br />
devrait être à la morale ce que la pesanteur est à la mécanique 2. » Ou pour le<br />
dire plus prosaïquement, comme Mme d’Épinay à l’abbé Galiani, dans une<br />
lettre du 29 septembre 1769 : « <strong>La</strong> première loi est d’avoir soin de soi,<br />
n’est -ce pas ? »<br />
Tel est le fait d’obser vation, indéniable ; il offre en outre l’avantage d’être<br />
à la portée de tout le monde. Ni le christianisme, ni la philosophie n’ont<br />
amené la vertu sur la terre ; sans doute parce qu’on s’est trompé sur les motifs<br />
qu’on invoquait pour recommander la vertu. Il f<strong>au</strong>t, pour recommencer la<br />
tâche, invoquer <strong>au</strong>près du vulgaire un principe plus général et plus simple que<br />
l’amour divin, que l’amour de la pure sagesse : ce sera l’amour -propre 3 .<br />
Entendons-nous bien : il ne s<strong>au</strong>rait être question d’un déchaînement de<br />
l’égoïsme, sans frein. <strong>La</strong> raison doit diriger la complaisance qui nous porte à<br />
poursuivre notre intérêt ; elle choisit, elle montre que notre bonheur n’est ni<br />
celui <strong>des</strong> brutes, dont nous nous séparons par les plus h<strong>au</strong>ts de nos attributs, ni<br />
celui <strong>des</strong> anges, inaccessible ; elle distingue entre la qualité <strong>des</strong> plaisirs, elle<br />
les hiérarchise suivant une loi de modération, elle conseille de les abandonner<br />
dès qu’ils mena cent de devenir tyrannie : bref elle reste dominatrice. « Qu’est -<br />
ce que le vice et qu’est -ce que la vertu ? Le vice, je pense, p.167 n’est <strong>au</strong>tre<br />
chose que l’excès, l’abus, la m<strong>au</strong>vaise application <strong>des</strong> appétits, <strong>des</strong> désirs, <strong>des</strong><br />
passions, qui sont naturels et innocents, voire même utiles et nécessaires. <strong>La</strong><br />
vertu consiste dans la modération et dans le gouvernement, dans l’usage et<br />
dans l’application de ces appétits, de ces désirs, de ces passions, en<br />
conformité avec les règles de la raison, et donc en opposition, souvent, à leurs<br />
impulsions aveugles 4. »<br />
1 Toussaint, <strong>Les</strong> Moeurs, 1748, I, 1.<br />
2 Il Caffè, 1764, semestre primo : <strong>La</strong> fortuna dei libri.<br />
3 Frédéric II, Essai sur l’amour-propre envisagé comme principe de morale, 1770.<br />
4 Bolingbroke, Letter on the Study and Use of History, 1752. Lettre III.