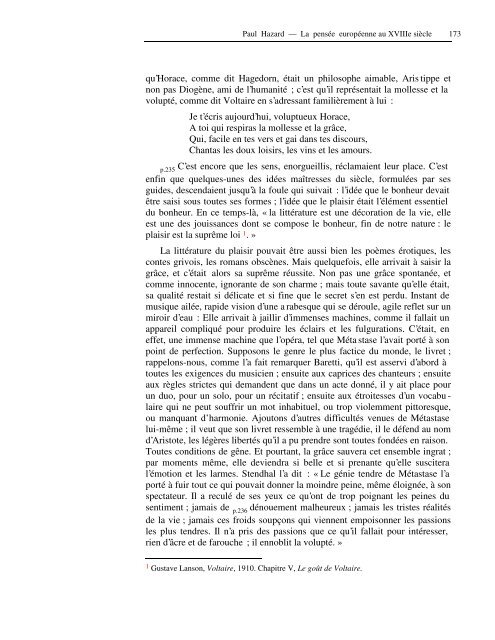La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 173<br />
qu’Horace, comme dit Hagedorn, était un philosophe aimable, Aris tippe et<br />
non pas Diogène, ami de l’humanité ; c’est qu’il représentait la mollesse et la<br />
volupté, comme dit Voltaire en s’adressant familièrement à lui :<br />
Je t’écris <strong>au</strong>jourd’hui, voluptueux Horace,<br />
A toi qui respiras la mollesse et la grâce,<br />
Qui, facile en tes vers et gai dans tes discours,<br />
Chantas les doux loisirs, les vins et les amours.<br />
p.235 C’est encore que les sens, enorgueillis, réclamaient leur place. C’est<br />
enfin que quelques-unes <strong>des</strong> idées maîtresses du <strong>siècle</strong>, formulées par ses<br />
gui<strong>des</strong>, <strong>des</strong>cendaient jusqu’à la foule qui suivait : l’idée que le bonheur devait<br />
être saisi sous toutes ses formes ; l’idée que le plaisir était l’élément essentiel<br />
du bonheur. En ce temps-là, « la littérature est une décoration de la vie, elle<br />
est une <strong>des</strong> jouissances dont se compose le bonheur, fin de notre nature : le<br />
plaisir est la suprême loi 1. »<br />
<strong>La</strong> littérature du plaisir pouvait être <strong>au</strong>ssi bien les poèmes érotiques, les<br />
contes grivois, les romans obscènes. Mais quelquefois, elle arrivait à saisir la<br />
grâce, et c’était alors sa suprême réussite. Non pas une grâce spontanée, et<br />
comme innocente, ignorante de son charme ; mais toute savante qu’elle était,<br />
sa qualité restait si délicate et si fine que le secret s’en est perdu. Instant de<br />
musique ailée, rapide vision d’une a rabesque qui se déroule, agile reflet sur un<br />
miroir d’e<strong>au</strong> : Elle arrivait à jaillir d’immenses machines, comme il fallait un<br />
appareil compliqué pour produire les éclairs et les fulgurations. C’était, en<br />
effet, une immense machine que l’opéra, tel que Méta stase l’avait porté à son<br />
point de perfection. Supposons le genre le plus factice du monde, le livret ;<br />
rappelons-nous, comme l’a fait remarquer Baretti, qu’il est asservi d’abord à<br />
toutes les exigences du musicien ; ensuite <strong>au</strong>x caprices <strong>des</strong> chanteurs ; ensuite<br />
<strong>au</strong>x règles strictes qui demandent que dans un acte donné, il y ait place pour<br />
un duo, pour un solo, pour un récitatif ; ensuite <strong>au</strong>x étroitesses d’un vocabu -<br />
laire qui ne peut souffrir un mot inhabituel, ou trop violemment pittoresque,<br />
ou manquant d’ harmonie. Ajoutons d’<strong>au</strong>tres difficultés venues de Métastase<br />
lui-même ; il veut que son livret ressemble à une tragédie, il le défend <strong>au</strong> nom<br />
d’Aristote, les légères libertés qu’il a pu prendre sont toutes fondées en raison.<br />
Toutes conditions de gêne. Et pourtant, la grâce s<strong>au</strong>vera cet ensemble ingrat ;<br />
par moments même, elle deviendra si belle et si prenante qu’elle suscitera<br />
l’émotion et les larmes. Stendhal l’a dit : « Le génie tendre de Métastase l’a<br />
porté à fuir tout ce qui pouvait donner la moindre peine, même éloignée, à son<br />
spectateur. Il a reculé de ses yeux ce qu’ont de trop poignant les peines du<br />
sentiment ; jamais de p.236 dénouement malheureux ; jamais les tristes réalités<br />
de la vie ; jamais ces froids soupçons qui viennent empoisonner les passions<br />
les plus tendres. Il n’a pris <strong>des</strong> passions que ce qu’il fallait pour intéresser,<br />
rien d’âcre et de farouche ; il ennoblit la volupté. »<br />
1 Gustave <strong>La</strong>nson, Voltaire, 1910. Chapitre V, Le goût de Voltaire.