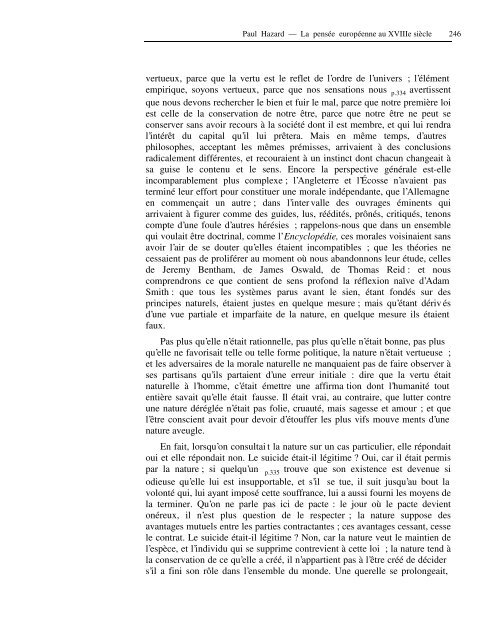La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 246<br />
vertueux, parce que la vertu est le reflet de l’ordre de l’univers ; l’élément<br />
empirique, soyons vertueux, parce que nos sensations nous p.334 avertissent<br />
que nous devons rechercher le bien et fuir le mal, parce que notre première loi<br />
est celle de la conservation de notre être, parce que notre être ne peut se<br />
conserver sans avoir recours à la société dont il est membre, et qui lui rendra<br />
l’intérêt du capital qu’il lui prêtera. Mais en même temps, d’<strong>au</strong>tres<br />
philosophes, acceptant les mêmes prémisses, arrivaient à <strong>des</strong> conclusions<br />
radicalement différentes, et recouraient à un instinct dont chacun changeait à<br />
sa guise le contenu et le sens. Encore la perspective générale est-elle<br />
incomparablement plus complexe ; l’Angleterre et l’Écosse n’avaient pas<br />
terminé leur effort pour constituer une morale indépendante, que l’Allemagne<br />
en commençait un <strong>au</strong>tre ; dans l’inter valle <strong>des</strong> ouvrages éminents qui<br />
arrivaient à figurer comme <strong>des</strong> gui<strong>des</strong>, lus, réédités, prônés, critiqués, tenons<br />
compte d’une foule d’<strong>au</strong>tres hérésies ; rappelons-nous que dans un ensemble<br />
qui voulait être doctrinal, comme l’ Encyclopédie, ces morales voisinaient sans<br />
avoir l’air de se douter qu’elles étaient incompatibles ; que les théories ne<br />
cessaient pas de proliférer <strong>au</strong> moment où nous abandonnons leur étude, celles<br />
de Jeremy Bentham, de James Oswald, de Thomas Reid : et nous<br />
comprendrons ce que contient de sens profond la réflexion naïve d’Adam<br />
Smith : que tous les systèmes parus avant le sien, étant fondés sur <strong>des</strong><br />
principes naturels, étaient justes en quelque mesure ; mais qu’étant dériv és<br />
d’une vue partiale et imparfaite de la nature, en quelque mesure ils étaient<br />
f<strong>au</strong>x.<br />
Pas plus qu’elle n’était rationnelle, pas plus qu’elle n’était bonne, pas plus<br />
qu’elle ne favorisait telle ou telle forme politique, la nature n’était vertueuse ;<br />
et les adversaires de la morale naturelle ne manquaient pas de faire observer à<br />
ses partisans qu’ils partaient d’une erreur initiale : dire que la vertu était<br />
naturelle à l’homme, c’était émettre une affirma tion dont l’humanité tout<br />
entière savait qu’elle était f<strong>au</strong>sse. Il était vrai, <strong>au</strong> contraire, que lutter contre<br />
une nature déréglée n’était pas folie, cru<strong>au</strong>té, mais sagesse et amour ; et que<br />
l’être conscient avait pour devoir d’étouffer les plus vifs mouve ments d’une<br />
nature aveugle.<br />
En fait, lorsqu’on consultai t la nature sur un cas particulier, elle répondait<br />
oui et elle répondait non. Le suicide était-il légitime ? Oui, car il était permis<br />
par la nature ; si quelqu’un p.335 trouve que son existence est devenue si<br />
odieuse qu’elle lui est insupportable, et s’il se tue, il suit jusqu’<strong>au</strong> bout la<br />
volonté qui, lui ayant imposé cette souffrance, lui a <strong>au</strong>ssi fourni les moyens de<br />
la terminer. Qu’on ne parle pas ici de pacte : le jour où le pacte devient<br />
onéreux, il n’est plus question de le respecter ; la nature suppose <strong>des</strong><br />
avantages mutuels entre les parties contractantes ; ces avantages cessant, cesse<br />
le contrat. Le suicide était-il légitime ? Non, car la nature veut le maintien de<br />
l’espèce, et l’individu qui se supprime contrevient à cette loi ; la nature tend à<br />
la conservation de ce qu’elle a créé, il n’appartient pas à l’être créé de décider<br />
s’il a fini son rôle dans l’ensemble du monde. Une querelle se prolongeait,