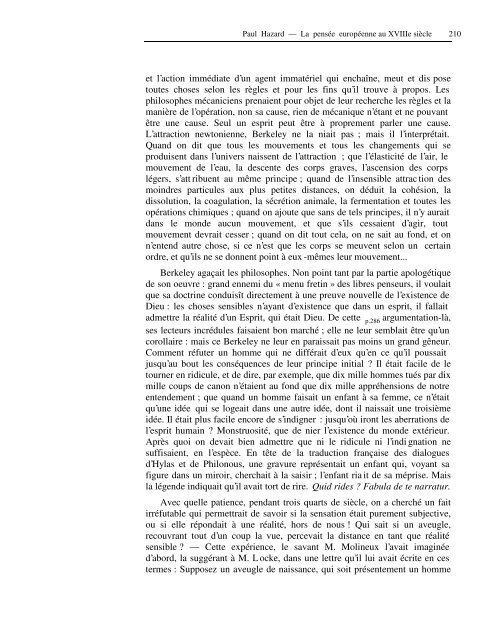La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 210<br />
et l’action immédiate d’un agent immatériel qui enchaîne, meut et dis pose<br />
toutes choses selon les règles et pour les fins qu’il trouve à propos. <strong>Les</strong><br />
philosophes mécaniciens prenaient pour objet de leur recherche les règles et la<br />
manière de l’opération, non sa c<strong>au</strong>se, rien de mécanique n’étant et ne pouvant<br />
être une c<strong>au</strong>se. Seul un esprit peut être à proprement parler une c<strong>au</strong>se.<br />
L’attraction newtonienne, Berkeley ne la niait pas ; mais il l’interprétait.<br />
Quand on dit que tous les mouvements et tous les changements qui se<br />
produisent dans l’univers naissent de l’attraction ; que l’élasticité de l’air, le<br />
mouvement de l’e<strong>au</strong>, la <strong>des</strong>cente <strong>des</strong> corps graves, l’ascension <strong>des</strong> corps<br />
légers, s’att ribuent <strong>au</strong> même principe ; quand de l’insensible attrac tion <strong>des</strong><br />
moindres particules <strong>au</strong>x plus petites distances, on déduit la cohésion, la<br />
dissolution, la coagulation, la sécrétion animale, la fermentation et toutes les<br />
opérations chimiques ; quand on ajoute que sans de tels principes, il n’y <strong>au</strong>rait<br />
dans le monde <strong>au</strong>cun mouvement, et que s’ils cessaient d’agir, tout<br />
mouvement devrait cesser ; quand on dit tout cela, on ne sait <strong>au</strong> fond, et on<br />
n’entend <strong>au</strong>tre chose, si ce n’est que les corps se meuvent selon un certain<br />
ordre, et qu’ils ne se donnent point à eux -mêmes leur mouvement...<br />
Berkeley agaçait les philosophes. Non point tant par la partie apologétique<br />
de son oeuvre : grand ennemi du « menu fretin » <strong>des</strong> libres penseurs, il voulait<br />
que sa doctrine conduisît directement à une preuve nouvelle de l’existence de<br />
Dieu : les choses sensibles n’ayant d’existence que dans un esprit, il fallait<br />
admettre la réalité d’un Esprit, qui était Dieu. De cette p.286 argumentation-là,<br />
ses lecteurs incrédules faisaient bon marché ; elle ne leur semblait être qu’un<br />
corollaire : mais ce Berkeley ne leur en paraissait pas moins un grand gêneur.<br />
Comment réfuter un homme qui ne différait d’eux qu’en ce qu’il poussait<br />
jusqu’<strong>au</strong> bout les conséquences de leur principe initial ? Il était facile de le<br />
tourner en ridicule, et de dire, par exemple, que dix mille hommes tués par dix<br />
mille coups de canon n’étaient <strong>au</strong> fond que dix mille appréhensions de notre<br />
entendement ; que quand un homme faisait un enfant à sa femme, ce n’était<br />
qu’une idée qui se logeait dans une <strong>au</strong>tre idée, dont il naissait une troisième<br />
idée. Il était plus facile encore de s’indigner : jusqu’où iront les aberrations de<br />
l’esprit humain ? Monstruosité, que de nier l’existence du monde extérieur.<br />
Après quoi on devait bien admettre que ni le ridicule ni l’indi gnation ne<br />
suffisaient, en l’espèce. En tête de la traduction française <strong>des</strong> dialogues<br />
d’Hylas et de Philonous, une gravure représentait un enfant qui, voyant sa<br />
figure dans un miroir, cherchait à la saisir ; l’enfant ria it de sa méprise. Mais<br />
la légende indiquait qu’il avait tort de rire. Quid ri<strong>des</strong> ? Fabula de te narratur.<br />
Avec quelle patience, pendant trois quarts de <strong>siècle</strong>, on a cherché un fait<br />
irréfutable qui permettrait de savoir si la sensation était purement subjective,<br />
ou si elle répondait à une réalité, hors de nous ! Qui sait si un aveugle,<br />
recouvrant tout d’un coup la vue, percevait la distance en tant que réalité<br />
sensible ? — Cette expérience, le savant M. Molineux l’avait imaginée<br />
d’abord, la suggérant à M. L ocke, dans une lettre qu’il lui avait écrite en ces<br />
termes : Supposez un aveugle de naissance, qui soit présentement un homme