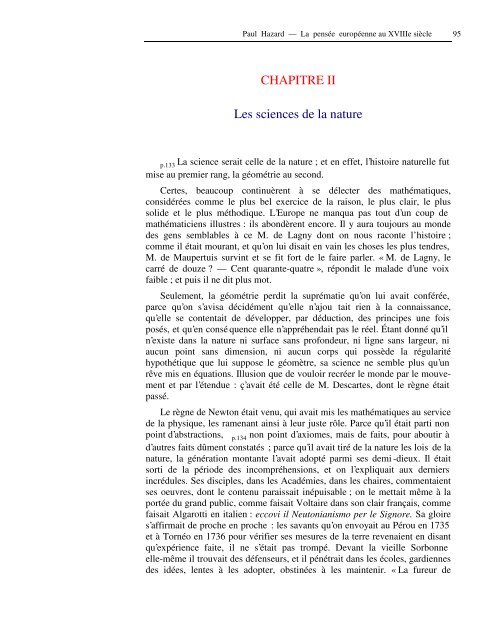La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 95<br />
CHAPITRE II<br />
<strong>Les</strong> sciences de la nature<br />
p.133 <strong>La</strong> science serait celle de la nature ; et en effet, l’histoire naturelle fut<br />
mise <strong>au</strong> premier rang, la géométrie <strong>au</strong> second.<br />
Certes, be<strong>au</strong>coup continuèrent à se délecter <strong>des</strong> mathématiques,<br />
considérées comme le plus bel exercice de la raison, le plus clair, le plus<br />
solide et le plus méthodique. L’Europe ne manqua pas tout d’un coup de<br />
mathématiciens illustres : ils abondèrent encore. Il y <strong>au</strong>ra toujours <strong>au</strong> monde<br />
<strong>des</strong> gens semblables à ce M. de <strong>La</strong>gny dont on nous raconte l’ histoire ;<br />
comme il était mourant, et qu’on lui disait en vain les choses les plus tendres,<br />
M. de M<strong>au</strong>pertuis survint et se fit fort de le faire parler. « M. de <strong>La</strong>gny, le<br />
carré de douze ? — Cent quarante-quatre », répondit le malade d’une voix<br />
faible ; et puis il ne dit plus mot.<br />
Seulement, la géométrie perdit la suprématie qu’on lui avait conférée,<br />
parce qu’on s’avisa décidément qu’elle n’ajou tait rien à la connaissance,<br />
qu’elle se contentait de développer, par déduction, <strong>des</strong> principes une fois<br />
posés, et qu’en consé quence elle n’appréhendait pas le réel. Étant donné qu’il<br />
n’existe dans la nature ni surface sans profondeur, ni ligne sans largeur, ni<br />
<strong>au</strong>cun point sans dimension, ni <strong>au</strong>cun corps qui possède la régularité<br />
hypothétique que lui suppose le géomètre, sa science ne semble plus qu’un<br />
rêve mis en équations. Illusion que de vouloir recréer le monde par le mouvement<br />
et par l’étendue : ç’avait été celle de M. Descartes, dont le règne était<br />
passé.<br />
Le règne de Newton était venu, qui avait mis les mathématiques <strong>au</strong> service<br />
de la physique, les ramenant ainsi à leur juste rôle. Parce qu’il était parti non<br />
point d’abstractions, p.134 non point d’axiomes, mais de faits, pour aboutir à<br />
d’<strong>au</strong>tres faits dûment constatés ; parce qu’il avait tiré de la nature les lois de la<br />
nature, la génération montante l’avait adopté parmi ses demi -dieux. Il était<br />
sorti de la période <strong>des</strong> incompréhensions, et on l’expliquait <strong>au</strong>x derniers<br />
incrédules. Ses disciples, dans les Académies, dans les chaires, commentaient<br />
ses oeuvres, dont le contenu paraissait inépuisable ; on le mettait même à la<br />
portée du grand public, comme faisait Voltaire dans son clair français, comme<br />
faisait Algarotti en italien : eccovi il Neutonianismo per le Signore. Sa gloire<br />
s’affirmait de proche en proche : les savants qu’on envoyait <strong>au</strong> Pérou en 1735<br />
et à Tornéo en 1736 pour vérifier ses mesures de la terre revenaient en disant<br />
qu’expérience faite, il ne s’était pas trompé. Devant la vieille Sorbonne<br />
elle-même il trouvait <strong>des</strong> défenseurs, et il pénétrait dans les écoles, gardiennes<br />
<strong>des</strong> idées, lentes à les adopter, obstinées à les maintenir. « <strong>La</strong> fureur de