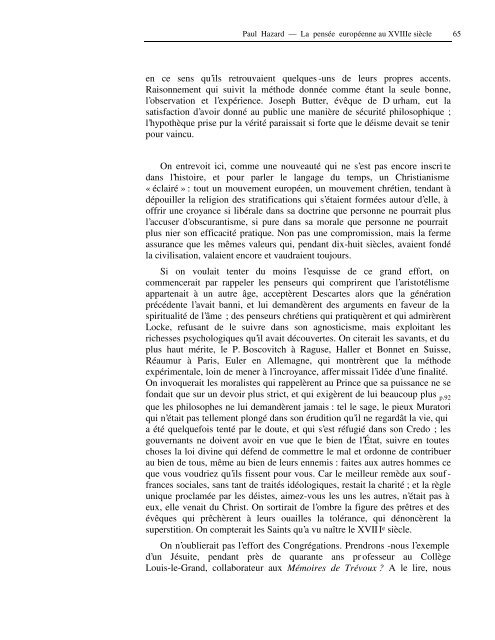La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 65<br />
en ce sens qu’ils retrouvaient quelques -uns de leurs propres accents.<br />
Raisonnement qui suivit la méthode donnée comme étant la seule bonne,<br />
l’observation et l’expérience. Joseph Butter, évêque de D urham, eut la<br />
satisfaction d’avoir donné <strong>au</strong> public une manière de sécurité philosophique ;<br />
l’hypothèque prise pur la vérité paraissait si forte que le déisme devait se tenir<br />
pour vaincu.<br />
On entrevoit ici, comme une nouve<strong>au</strong>té qui ne s’est pas encore inscri te<br />
dans l’histoire, et pour parler le langage du temps, un Christianisme<br />
« éclairé » : tout un mouvement européen, un mouvement chrétien, tendant à<br />
dépouiller la religion <strong>des</strong> stratifications qui s’étaient formées <strong>au</strong>tour d’elle, à<br />
offrir une croyance si libérale dans sa doctrine que personne ne pourrait plus<br />
l’accuser d’obscurantisme, si pure dans sa morale que personne ne pourrait<br />
plus nier son efficacité pratique. Non pas une compromission, mais la ferme<br />
assurance que les mêmes valeurs qui, pendant dix-huit <strong>siècle</strong>s, avaient fondé<br />
la civilisation, valaient encore et v<strong>au</strong>draient toujours.<br />
Si on voulait tenter du moins l’esquisse de ce grand effort, on<br />
commencerait par rappeler les penseurs qui comprirent que l’aristotélisme<br />
appartenait à un <strong>au</strong>tre âge, acceptèrent Descartes alors que la génération<br />
précédente l’avait banni, et lui demandèrent <strong>des</strong> arguments en faveur de la<br />
spiritualité de l’âme ; <strong>des</strong> penseurs chrétiens qui pratiquèrent et qui admirèrent<br />
Locke, refusant de le suivre dans son agnosticisme, mais exploitant les<br />
richesses psychologiques qu’il avait découvertes. On citerait les savants, et du<br />
plus h<strong>au</strong>t mérite, le P. Boscovitch à Raguse, Haller et Bonnet en Suisse,<br />
Ré<strong>au</strong>mur à Paris, Euler en Allemagne, qui montrèrent que la méthode<br />
expérimentale, loin de mener à l’incroyance, affer missait l’idée d’une finalité.<br />
On invoquerait les moralistes qui rappelèrent <strong>au</strong> Prince que sa puissance ne se<br />
fondait que sur un devoir plus strict, et qui exigèrent de lui be<strong>au</strong>coup plus p.92<br />
que les philosophes ne lui demandèrent jamais : tel le sage, le pieux Muratori<br />
qui n’était pas tellement plongé dans son érudition qu’il ne regardât la vie, qui<br />
a été quelquefois tenté par le doute, et qui s’est réfugié dans son Credo ; les<br />
gouvernants ne doivent avoir en vue que le bien de l’État, suivre en toutes<br />
choses la loi divine qui défend de commettre le mal et ordonne de contribuer<br />
<strong>au</strong> bien de tous, même <strong>au</strong> bien de leurs ennemis : faites <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres hommes ce<br />
que vous voudriez qu’ils fissent pour vous. Car le meilleur remède <strong>au</strong>x souf -<br />
frances sociales, sans tant de traités idéologiques, restait la charité ; et la règle<br />
unique proclamée par les déistes, aimez-vous les uns les <strong>au</strong>tres, n’était pas à<br />
eux, elle venait du Christ. On sortirait de l’ombre la figure <strong>des</strong> prêtres et <strong>des</strong><br />
évêques qui prêchèrent à leurs ouailles la tolérance, qui dénoncèrent la<br />
superstition. On compterait les Saints qu’a vu naître le XVII I e <strong>siècle</strong>.<br />
On n’oublierait pas l’effort <strong>des</strong> Congrégations. Prendrons -nous l’exemple<br />
d’un Jésuite, pendant près de quarante ans pr ofesseur <strong>au</strong> Collège<br />
Louis-le-Grand, collaborateur <strong>au</strong>x Mémoires de Trévoux ? A le lire, nous