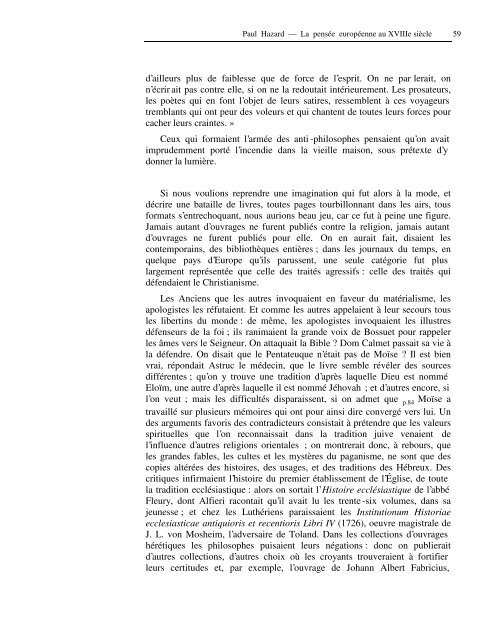La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 59<br />
d’ailleurs plus de faiblesse que de force de l’esprit. On ne par lerait, on<br />
n’écrir ait pas contre elle, si on ne la redoutait intérieurement. <strong>Les</strong> prosateurs,<br />
les poètes qui en font l’objet de leurs satires, ressemblent à ces voyageurs<br />
tremblants qui ont peur <strong>des</strong> voleurs et qui chantent de toutes leurs forces pour<br />
cacher leurs craintes. »<br />
Ceux qui formaient l’armée <strong>des</strong> anti -philosophes pensaient qu’on avait<br />
imprudemment porté l’incendie dans la vieille maison, sous prétexte d’y<br />
donner la lumière.<br />
Si nous voulions reprendre une imagination qui fut alors à la mode, et<br />
décrire une bataille de livres, toutes pages tourbillonnant dans les airs, tous<br />
formats s’entrechoquant, nous <strong>au</strong>rions be<strong>au</strong> jeu, car ce fut à peine une figure.<br />
Jamais <strong>au</strong>tant d’ouvrages ne furent publiés contre la religion, jamais <strong>au</strong>tant<br />
d’ouvrages ne furent publiés pour elle. On en <strong>au</strong>rait fait, disaient les<br />
contemporains, <strong>des</strong> bibliothèques entières ; dans les journ<strong>au</strong>x du temps, en<br />
quelque pays d’Europe qu’ils parussent, une seule catégorie fut plus<br />
largement représentée que celle <strong>des</strong> traités agressifs : celle <strong>des</strong> traités qui<br />
défendaient le Christianisme.<br />
<strong>Les</strong> Anciens que les <strong>au</strong>tres invoquaient en faveur du matérialisme, les<br />
apologistes les réfutaient. Et comme les <strong>au</strong>tres appelaient à leur secours tous<br />
les libertins du monde : de même, les apologistes invoquaient les illustres<br />
défenseurs de la foi ; ils ranimaient la grande voix de Bossuet pour rappeler<br />
les âmes vers le Seigneur. On attaquait la Bible ? Dom Calmet passait sa vie à<br />
la défendre. On disait que le Pentateuque n’était pas de Moïse ? Il est bien<br />
vrai, répondait Astruc le médecin, que le livre semble révéler <strong>des</strong> sources<br />
différentes ; qu’on y trouve une tradition d’après laquelle Dieu est nommé<br />
Eloïm, une <strong>au</strong>tre d’après laquelle il est nommé Jéhovah ; et d’<strong>au</strong>tres encore, si<br />
l’on veut ; mais les difficultés disparaissent, si on admet que p.84 Moïse a<br />
travaillé sur plusieurs mémoires qui ont pour ainsi dire convergé vers lui. Un<br />
<strong>des</strong> arguments favoris <strong>des</strong> contradicteurs consistait à prétendre que les valeurs<br />
spirituelles que l’on reconnaissait dans la tradition juive venaient de<br />
l’influence d’<strong>au</strong>tres religions orientales ; on montrerait donc, à rebours, que<br />
les gran<strong>des</strong> fables, les cultes et les mystères du paganisme, ne sont que <strong>des</strong><br />
copies altérées <strong>des</strong> histoires, <strong>des</strong> usages, et <strong>des</strong> traditions <strong>des</strong> Hébreux. Des<br />
critiques infirmaient l’histoire du premier établissement de l’Église, de toute<br />
la tradition ecclésiastique : alors on sortait l’ Histoire ecclésiastique de l’abbé<br />
Fleury, dont Alfieri racontait qu’il avait lu les trente -six volumes, dans sa<br />
jeunesse ; et chez les Luthériens paraissaient les Institutionum Historiae<br />
ecclesiasticae antiquioris et recentioris Libri IV (1726), oeuvre magistrale de<br />
J. L. von Mosheim, l’adversaire de Toland. Dans les collections d’ouvrages<br />
hérétiques les philosophes puisaient leurs négations : donc on publierait<br />
d’<strong>au</strong>tres collections, d’<strong>au</strong>tres choix où les croyants trouveraient à fortifier<br />
leurs certitu<strong>des</strong> et, par exemple, l’ouvrage de Johann Albert Fabricius,