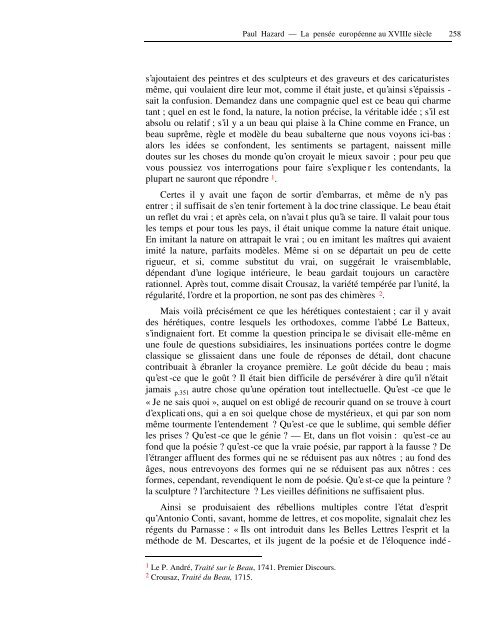La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 258<br />
s’ajoutaient <strong>des</strong> peintres et <strong>des</strong> sculpteurs et <strong>des</strong> graveurs et <strong>des</strong> caricaturistes<br />
même, qui voulaient dire leur mot, comme il était juste, et qu’ainsi s’épaissis -<br />
sait la confusion. Demandez dans une compagnie quel est ce be<strong>au</strong> qui charme<br />
tant ; quel en est le fond, la nature, la notion précise, la véritable idée ; s’il est<br />
absolu ou relatif ; s’il y a un be<strong>au</strong> qui plaise à la Chine comme en France, un<br />
be<strong>au</strong> suprême, règle et modèle du be<strong>au</strong> subalterne que nous voyons ici-bas :<br />
alors les idées se confondent, les sentiments se partagent, naissent mille<br />
doutes sur les choses du monde qu’on croyait le mieux savoir ; pour peu que<br />
vous poussiez vos interrogations pour faire s’explique r les contendants, la<br />
plupart ne s<strong>au</strong>ront que répondre 1.<br />
Certes il y avait une façon de sortir d’embarras, et même de n’y pas<br />
entrer ; il suffisait de s’en tenir fortement à la doc trine classique. Le be<strong>au</strong> était<br />
un reflet du vrai ; et après cela, on n’avai t plus qu’à se taire. Il valait pour tous<br />
les temps et pour tous les pays, il était unique comme la nature était unique.<br />
En imitant la nature on attrapait le vrai ; ou en imitant les maîtres qui avaient<br />
imité la nature, parfaits modèles. Même si on se départait un peu de cette<br />
rigueur, et si, comme substitut du vrai, on suggérait le vraisemblable,<br />
dépendant d’une logique intérieure, le be<strong>au</strong> gardait toujours un caractère<br />
rationnel. Après tout, comme disait Crousaz, la variété tempérée par l’unité, la<br />
régularité, l’ordre et la proportion, ne sont pas <strong>des</strong> chimères 2.<br />
Mais voilà précisément ce que les hérétiques contestaient ; car il y avait<br />
<strong>des</strong> hérétiques, contre lesquels les orthodoxes, comme l’abbé Le Batteux,<br />
s’indignaient fort. Et comme la question principa le se divisait elle-même en<br />
une foule de questions subsidiaires, les insinuations portées contre le dogme<br />
classique se glissaient dans une foule de réponses de détail, dont chacune<br />
contribuait à ébranler la croyance première. Le goût décide du be<strong>au</strong> ; mais<br />
qu’est -ce que le goût ? Il était bien difficile de persévérer à dire qu’il n’était<br />
jamais p.351 <strong>au</strong>tre chose qu’une opération tout intellectuelle. Qu’est -ce que le<br />
« Je ne sais quoi », <strong>au</strong>quel on est obligé de recourir quand on se trouve à court<br />
d’explicati ons, qui a en soi quelque chose de mystérieux, et qui par son nom<br />
même tourmente l’entendement ? Qu’est -ce que le sublime, qui semble défier<br />
les prises ? Qu’est -ce que le génie ? — Et, dans un flot voisin : qu’est -ce <strong>au</strong><br />
fond que la poésie ? qu’est -ce que la vraie poésie, par rapport à la f<strong>au</strong>sse ? De<br />
l’étranger affluent <strong>des</strong> formes qui ne se réduisent pas <strong>au</strong>x nôtres ; <strong>au</strong> fond <strong>des</strong><br />
âges, nous entrevoyons <strong>des</strong> formes qui ne se réduisent pas <strong>au</strong>x nôtres : ces<br />
formes, cependant, revendiquent le nom de poésie. Qu’e st-ce que la peinture ?<br />
la sculpture ? l’architecture ? <strong>Les</strong> vieilles définitions ne suffisaient plus.<br />
Ainsi se produisaient <strong>des</strong> rébellions multiples contre l’état d’esprit<br />
qu’Antonio Conti, savant, homme de lettres, et cos mopolite, signalait chez les<br />
régents du Parnasse : « Ils ont introduit dans les Belles Lettres l’esprit et la<br />
méthode de M. Descartes, et ils jugent de la poésie et de l’éloquence indé -<br />
1 Le P. André, Traité sur le Be<strong>au</strong>, 1741. Premier Discours.<br />
2 Crousaz, Traité du Be<strong>au</strong>, 1715.