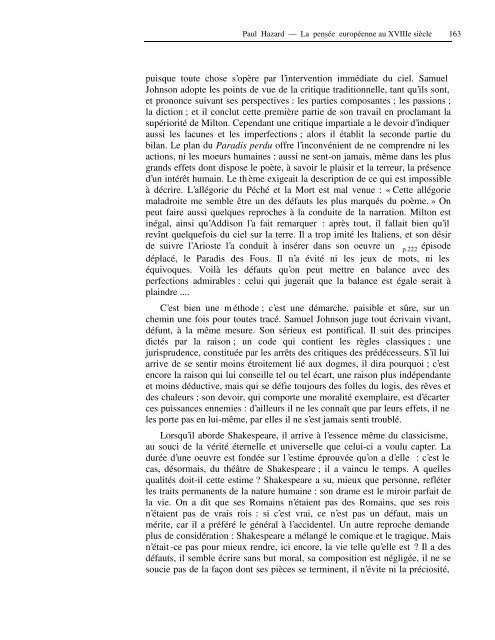La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 163<br />
puisque toute chose s’opère par l’intervention immédiate du ciel. Samuel<br />
Johnson adopte les points de vue de la critique traditionnelle, tant qu’ils sont,<br />
et prononce suivant ses perspectives : les parties composantes ; les passions ;<br />
la diction ; et il conclut cette première partie de son travail en proclamant la<br />
supériorité de Milton. Cependant une critique impartiale a le devoir d’indiquer<br />
<strong>au</strong>ssi les lacunes et les imperfections ; alors il établit la seconde partie du<br />
bilan. Le plan du Paradis perdu offre l’inconvénient de ne comprendre ni les<br />
actions, ni les moeurs humaines : <strong>au</strong>ssi ne sent-on jamais, même dans les plus<br />
grands effets dont dispose le poète, à savoir le plaisir et la terreur, la présence<br />
d’un intérêt humain. Le th ème exigeait la <strong>des</strong>cription de ce qui est impossible<br />
à décrire. L’allégorie du Péché et la Mort est mal venue : « Cette allégorie<br />
maladroite me semble être un <strong>des</strong> déf<strong>au</strong>ts les plus marqués du poème. » On<br />
peut faire <strong>au</strong>ssi quelques reproches à la conduite de la narration. Milton est<br />
inégal, ainsi qu’Addison l’a fait remarquer : après tout, il fallait bien qu’il<br />
revînt quelquefois du ciel sur la terre. Il a trop imité les Italiens, et son désir<br />
de suivre l’Arioste l’a conduit à insérer dans son oeuvre un p.222 épisode<br />
déplacé, le Paradis <strong>des</strong> Fous. Il n’a évité ni les jeux de mots, ni les<br />
équivoques. Voilà les déf<strong>au</strong>ts qu’on peut mettre en balance avec <strong>des</strong><br />
perfections admirables : celui qui jugerait que la balance est égale serait à<br />
plaindre ....<br />
C’est bien une m éthode ; c’est une démarche, paisible et sûre, sur un<br />
chemin une fois pour toutes tracé. Samuel Johnson juge tout écrivain vivant,<br />
défunt, à la même mesure. Son sérieux est pontifical. Il suit <strong>des</strong> principes<br />
dictés par la raison ; un code qui contient les règles classiques ; une<br />
jurisprudence, constituée par les arrêts <strong>des</strong> critiques <strong>des</strong> prédécesseurs. S’il lui<br />
arrive de se sentir moins étroitement lié <strong>au</strong>x dogmes, il dira pourquoi ; c’est<br />
encore la raison qui lui conseille tel ou tel écart, une raison plus indépendante<br />
et moins déductive, mais qui se défie toujours <strong>des</strong> folles du logis, <strong>des</strong> rêves et<br />
<strong>des</strong> chaleurs ; son devoir, qui comporte une moralité exemplaire, est d’écarter<br />
ces puissances ennemies : d’ailleurs il ne les connaît que par leurs effets, il ne<br />
les porte pas en lui-même, par elles il ne s’est jamais senti troublé.<br />
Lorsqu’il aborde Shakespeare, il arrive à l’essence même du classicisme,<br />
<strong>au</strong> souci de la vérité éternelle et universelle que celui-ci a voulu capter. <strong>La</strong><br />
durée d’une oeuvre est fondée sur l ’estime éprouvée qu’on a d’elle : c’est le<br />
cas, désormais, du théâtre de Shakespeare ; il a vaincu le temps. A quelles<br />
qualités doit-il cette estime ? Shakespeare a su, mieux que personne, refléter<br />
les traits permanents de la nature humaine : son drame est le miroir parfait de<br />
la vie. On a dit que ses Romains n’étaient pas <strong>des</strong> Romains, que ses rois<br />
n’étaient pas de vrais rois : si c’est vrai, ce n’est pas un déf<strong>au</strong>t, mais un<br />
mérite, car il a préféré le général à l’accidentel. Un <strong>au</strong>tre reproche demande<br />
plus de considération : Shakespeare a mélangé le comique et le tragique. Mais<br />
n’était -ce pas pour mieux rendre, ici encore, la vie telle qu’elle est ? Il a <strong>des</strong><br />
déf<strong>au</strong>ts, il semble écrire sans but moral, sa composition est négligée, il ne se<br />
soucie pas de la façon dont ses pièces se terminent, il n’évite ni la préciosité,