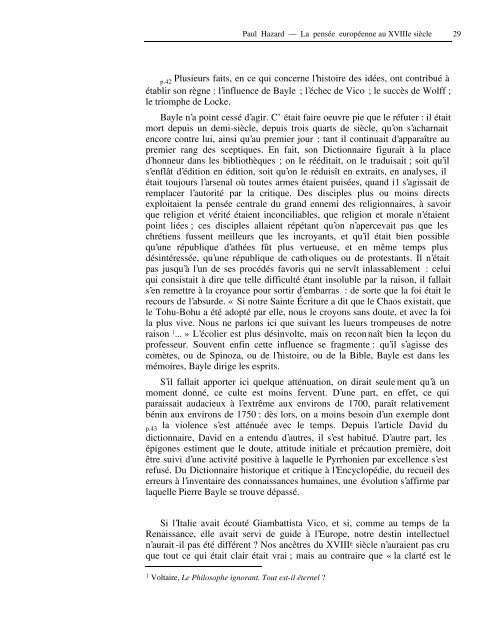La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 29<br />
p.42 Plusieurs faits, en ce qui concerne l’histoire <strong>des</strong> idées, ont contribué à<br />
établir son règne : l’influence de Bayle ; l’échec de Vico ; le succès de Wolff ;<br />
le triomphe de Locke.<br />
Bayle n’a point cessé d’agir. C’ était faire oeuvre pie que le réfuter : il était<br />
mort depuis un demi-<strong>siècle</strong>, depuis trois quarts de <strong>siècle</strong>, qu’on s’acharnait<br />
encore contre lui, ainsi qu’<strong>au</strong> premier jour : tant il continuait d’apparaître <strong>au</strong><br />
premier rang <strong>des</strong> sceptiques. En fait, son Dictionnaire figurait à la place<br />
d’honneur dans les bibliothèques ; on le rééditait, on le traduisait ; soit qu’il<br />
s’enflât d’édition en édition, soit qu’on le réduisît en extraits, en analyses, il<br />
était toujours l’arsenal où toutes armes étaient puisées, quand i l s’agissait de<br />
remplacer l’<strong>au</strong>torité par la critique. Des disciples plus ou moins directs<br />
exploitaient la <strong>pensée</strong> centrale du grand ennemi <strong>des</strong> religionnaires, à savoir<br />
que religion et vérité étaient inconciliables, que religion et morale n’étaient<br />
point liées ; ces disciples allaient répétant qu’on n’apercevait pas que les<br />
chrétiens fussent meilleurs que les incroyants, et qu’il était bien possible<br />
qu’une république d’athées fût plus vertueuse, et en même temps plus<br />
désintéressée, qu’une république de cath oliques ou de protestants. Il n’était<br />
pas jusqu’à l’un de ses procédés favoris qui ne servît inlassablement : celui<br />
qui consistait à dire que telle difficulté étant insoluble par la raison, il fallait<br />
s’en remettre à la croyance pour sortir d’embarras : de sorte que la foi était le<br />
recours de l’absurde. « Si notre Sainte Écriture a dit que le Chaos existait, que<br />
le Tohu-Bohu a été adopté par elle, nous le croyons sans doute, et avec la foi<br />
la plus vive. Nous ne parlons ici que suivant les lueurs trompeuses de notre<br />
raison 1 ... » L’écolier est plus désinvolte, mais on recon naît bien la leçon du<br />
professeur. Souvent enfin cette influence se fragmente : qu’il s’agisse <strong>des</strong><br />
comètes, ou de Spinoza, ou de l’histoire, ou de la Bible, Bayle est dans les<br />
mémoires, Bayle dirige les esprits.<br />
S’il fallait apporter ici quelque atténuation, on dirait seule ment qu’à un<br />
moment donné, ce culte est moins fervent. D’une part, en effet, ce qui<br />
paraissait <strong>au</strong>dacieux à l’extrême <strong>au</strong>x environs de 1700, paraît relativement<br />
bénin <strong>au</strong>x environs de 1750 : dès lors, on a moins besoin d’un exemple dont<br />
p.43 la violence s’est atténuée avec le temps. Depuis l’article David du<br />
dictionnaire, David en a entendu d’<strong>au</strong>tres, il s’est habitué. D’<strong>au</strong>tre part, les<br />
épigones estiment que le doute, attitude initiale et préc<strong>au</strong>tion première, doit<br />
être suivi d’une activité positive à laquelle le Pyrrhonien par excellence s’est<br />
refusé. Du Dictionnaire historique et critique à l’Encyclopédie, du recueil <strong>des</strong><br />
erreurs à l’inventaire <strong>des</strong> connaissances humaines, une évolution s’affirme par<br />
laquelle Pierre Bayle se trouve dépassé.<br />
Si l’Italie avait écouté Giambattista Vico, et si, comme <strong>au</strong> temps de la<br />
Renaissance, elle avait servi de guide à l’Europe, notre <strong>des</strong>tin intellectuel<br />
n’<strong>au</strong>rait -il pas été différent ? Nos ancêtres du XVIII e <strong>siècle</strong> n’<strong>au</strong>raient pas cru<br />
que tout ce qui était clair était vrai ; mais <strong>au</strong> contraire que « la clarté est le<br />
1 Voltaire, Le Philosophe ignorant. Tout est-il éternel ?