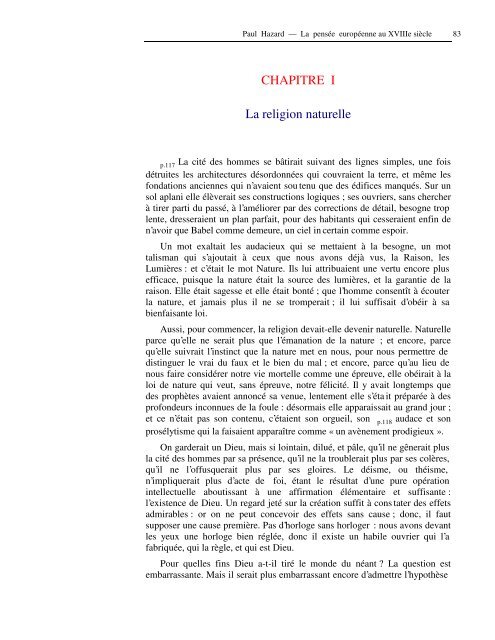La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 83<br />
CHAPITRE I<br />
<strong>La</strong> religion naturelle<br />
p.117 <strong>La</strong> cité <strong>des</strong> hommes se bâtirait suivant <strong>des</strong> lignes simples, une fois<br />
détruites les architectures désordonnées qui couvraient la terre, et même les<br />
fondations anciennes qui n’avaient sou tenu que <strong>des</strong> édifices manqués. Sur un<br />
sol aplani elle élèverait ses constructions logiques ; ses ouvriers, sans chercher<br />
à tirer parti du passé, à l’améliorer par <strong>des</strong> corrections de détail, besogne trop<br />
lente, dresseraient un plan parfait, pour <strong>des</strong> habitants qui cesseraient enfin de<br />
n’avoir que Babel comme demeure, un ciel in certain comme espoir.<br />
Un mot exaltait les <strong>au</strong>dacieux qui se mettaient à la besogne, un mot<br />
talisman qui s’ajoutait à ceux que nous avons déjà vus, la Raison, les<br />
Lumières : et c’était le mot Nature. Ils lui attribuaient une vertu encore plus<br />
efficace, puisque la nature était la source <strong>des</strong> lumières, et la garantie de la<br />
raison. Elle était sagesse et elle était bonté ; que l’homme consentît à écouter<br />
la nature, et jamais plus il ne se tromperait ; il lui suffisait d’obéir à sa<br />
bienfaisante loi.<br />
Aussi, pour commencer, la religion devait-elle devenir naturelle. Naturelle<br />
parce qu’elle ne serait plus que l’émanation de la nature ; et encore, parce<br />
qu’elle suivrait l’instinct que la nature met en nous, pour nous permettre de<br />
distinguer le vrai du f<strong>au</strong>x et le bien du mal ; et encore, parce qu’<strong>au</strong> lieu de<br />
nous faire considérer notre vie mortelle comme une épreuve, elle obéirait à la<br />
loi de nature qui veut, sans épreuve, notre félicité. Il y avait longtemps que<br />
<strong>des</strong> prophètes avaient annoncé sa venue, lentement elle s’éta it préparée à <strong>des</strong><br />
profondeurs inconnues de la foule : désormais elle apparaissait <strong>au</strong> grand jour ;<br />
et ce n’était pas son contenu, c’étaient son orgueil, son p.118 <strong>au</strong>dace et son<br />
prosélytisme qui la faisaient apparaître comme « un avènement prodigieux ».<br />
On garderait un Dieu, mais si lointain, dilué, et pâle, qu’il ne gênerait plus<br />
la cité <strong>des</strong> hommes par sa présence, qu’il ne la troublerait plus par ses colères,<br />
qu’il ne l’offusquerait plus par ses gloires. Le déisme, ou théisme,<br />
n’impliquerait plus d’acte de foi, étant le résultat d’une pure opération<br />
intellectuelle aboutissant à une affirmation élémentaire et suffisante :<br />
l’existence de Dieu. Un regard jeté sur la création suffit à cons tater <strong>des</strong> effets<br />
admirables : or on ne peut concevoir <strong>des</strong> effets sans c<strong>au</strong>se ; donc, il f<strong>au</strong>t<br />
supposer une c<strong>au</strong>se première. Pas d’horloge sans horloger : nous avons devant<br />
les yeux une horloge bien réglée, donc il existe un habile ouvrier qui l’a<br />
fabriquée, qui la règle, et qui est Dieu.<br />
Pour quelles fins Dieu a-t-il tiré le monde du néant ? <strong>La</strong> question est<br />
embarrassante. Mais il serait plus embarrassant encore d’admettre l’hypothèse