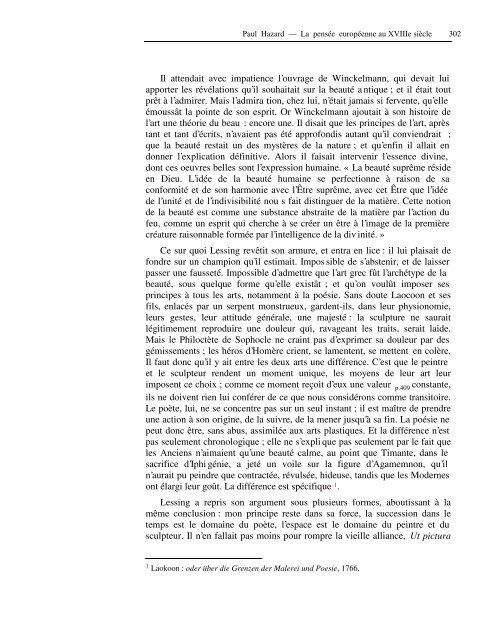La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 302<br />
Il attendait avec impatience l’ouvrage de Winckelmann, qui devait lui<br />
apporter les révélations qu’il souhaitait sur la be<strong>au</strong>té a ntique ; et il était tout<br />
prêt à l’admirer. Mais l’admira tion, chez lui, n’était jamais si fervente, qu’elle<br />
émoussât la pointe de son esprit. Or Winckelmann ajoutait à son histoire de<br />
l’art une théorie du be<strong>au</strong> : encore une. Il disait que les principes de l’art, après<br />
tant et tant d’écrits, n’avaient pas été approfondis <strong>au</strong>tant qu’il conviendrait ;<br />
que la be<strong>au</strong>té restait un <strong>des</strong> mystères de la nature ; et qu’enfin il allait en<br />
donner l’explication définitive. Alors il faisait intervenir l’essence divine,<br />
dont ces oeuvres belles sont l’expression humaine. « <strong>La</strong> be<strong>au</strong>té suprême réside<br />
en Dieu. L’idée de la be<strong>au</strong>té humaine se perfectionne à raison de sa<br />
conformité et de son harmonie avec l’Être suprême, avec cet Être que l’idée<br />
de l’unité et de l’indivisibilité nou s fait distinguer de la matière. Cette notion<br />
de la be<strong>au</strong>té est comme une substance abstraite de la matière par l’action du<br />
feu, comme un esprit qui cherche à se créer un être à l’image de la première<br />
créature raisonnable formée par l’intelligence de la div inité. »<br />
Ce sur quoi <strong>Les</strong>sing revêtit son armure, et entra en lice : il lui plaisait de<br />
fondre sur un champion qu’il estimait. Impos sible de s’abstenir, et de laisser<br />
passer une f<strong>au</strong>sseté. Impossible d’admettre que l’art grec fût l’archétype de la<br />
be<strong>au</strong>té, sous quelque forme qu’elle existât ; et qu’on voulût imposer ses<br />
principes à tous les arts, notamment à la poésie. Sans doute <strong>La</strong>ocoon et ses<br />
fils, enlacés par un serpent monstrueux, gardent-ils, dans leur physionomie,<br />
leurs gestes, leur attitude générale, une majesté : la sculpture ne s<strong>au</strong>rait<br />
légitimement reproduire une douleur qui, ravageant les traits, serait laide.<br />
Mais le Philoctète de Sophocle ne craint pas d’exprimer sa douleur par <strong>des</strong><br />
gémissements ; les héros d’Homère crient, se lamentent, se mettent en colère.<br />
Il f<strong>au</strong>t donc qu’il y ait entre les deux arts une différence. C’est que le peintre<br />
et le sculpteur rendent un moment unique, les moyens de leur art leur<br />
imposent ce choix ; comme ce moment reçoit d’eux une valeur p.409 constante,<br />
ils ne doivent rien lui conférer de ce que nous considérons comme transitoire.<br />
Le poète, lui, ne se concentre pas sur un seul instant ; il est maître de prendre<br />
une action à son origine, de la suivre, de la mener jusqu’à sa fin. <strong>La</strong> poésie ne<br />
peut donc être, sans abus, assimilée <strong>au</strong>x arts plastiques. Et la différence n’est<br />
pas seulement chronologique ; elle ne s’expli que pas seulement par le fait que<br />
les Anciens n’aimaient qu’une be<strong>au</strong>té calme, <strong>au</strong> point que Timante, dans le<br />
sacrifice d’Iphi génie, a jeté un voile sur la figure d’Agamemnon, qu’il<br />
n’<strong>au</strong>rait pu peindre que contractée, révulsée, hideuse, tandis que les Modernes<br />
ont élargi leur goût. <strong>La</strong> différence est spécifique 1.<br />
<strong>Les</strong>sing a repris son argument sous plusieurs formes, aboutissant à la<br />
même conclusion : mon principe reste dans sa force, la succession dans le<br />
temps est le domaine du poète, l’espace est le domaine du peintre et du<br />
sculpteur. Il n’en fallait pas moins pour rompre la vieille alliance, Ut pictura<br />
1 <strong>La</strong>okoon : oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, 1766.