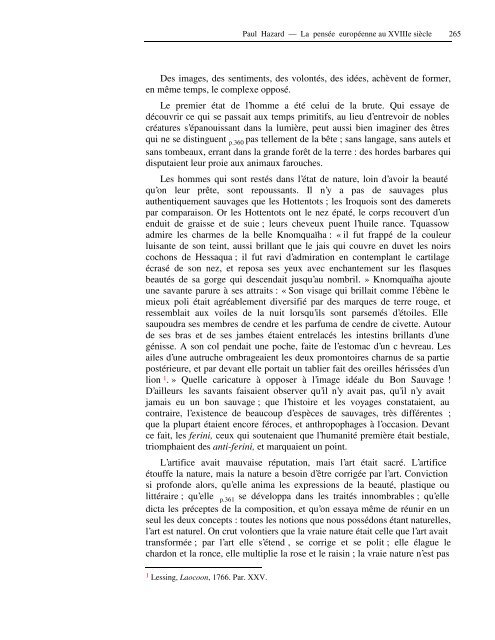La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 265<br />
Des images, <strong>des</strong> sentiments, <strong>des</strong> volontés, <strong>des</strong> idées, achèvent de former,<br />
en même temps, le complexe opposé.<br />
Le premier état de l’homme a été celui de la brute. Qui essaye de<br />
découvrir ce qui se passait <strong>au</strong>x temps primitifs, <strong>au</strong> lieu d’entrevoir de nobles<br />
créatures s’épanouissant dans la lumière, peut <strong>au</strong>ssi bien imaginer <strong>des</strong> êtres<br />
qui ne se distinguent p.360 pas tellement de la bête ; sans langage, sans <strong>au</strong>tels et<br />
sans tombe<strong>au</strong>x, errant dans la grande forêt de la terre : <strong>des</strong> hor<strong>des</strong> barbares qui<br />
disputaient leur proie <strong>au</strong>x anim<strong>au</strong>x farouches.<br />
<strong>Les</strong> hommes qui sont restés dans l’état de nature, loin d’avoir la be<strong>au</strong>té<br />
qu’on leur prête, sont repoussants. Il n’y a pas de s<strong>au</strong>vages plus<br />
<strong>au</strong>thentiquement s<strong>au</strong>vages que les Hottentots ; les Iroquois sont <strong>des</strong> damerets<br />
par comparaison. Or les Hottentots ont le nez épaté, le corps recouvert d’un<br />
enduit de graisse et de suie ; leurs cheveux puent l’huile rance. Tquassow<br />
admire les charmes de la belle Knomquaïha : « il fut frappé de la couleur<br />
luisante de son teint, <strong>au</strong>ssi brillant que le jais qui couvre en duvet les noirs<br />
cochons de Hessaqua ; il fut ravi d’admiration en contemplant le cartilage<br />
écrasé de son nez, et reposa ses yeux avec enchantement sur les flasques<br />
be<strong>au</strong>tés de sa gorge qui <strong>des</strong>cendait jusqu’<strong>au</strong> nombril. » Knomquaïha ajoute<br />
une savante parure à ses attraits : « Son visage qui brillait comme l’ébène le<br />
mieux poli était agréablement diversifié par <strong>des</strong> marques de terre rouge, et<br />
ressemblait <strong>au</strong>x voiles de la nuit lorsqu’ils sont parsemés d’étoiles. Elle<br />
s<strong>au</strong>poudra ses membres de cendre et les parfuma de cendre de civette. Autour<br />
de ses bras et de ses jambes étaient entrelacés les intestins brillants d’une<br />
génisse. A son col pendait une poche, faite de l’estomac d’un c hevre<strong>au</strong>. <strong>Les</strong><br />
ailes d’une <strong>au</strong>truche ombrageaient les deux promontoires charnus de sa partie<br />
postérieure, et par devant elle portait un tablier fait <strong>des</strong> oreilles hérissées d’un<br />
lion 1. » Quelle caricature à opposer à l’image idéale du Bon S<strong>au</strong>vage !<br />
D’ailleurs les savants faisaient observer qu’il n’y avait pas, qu’il n’y avait<br />
jamais eu un bon s<strong>au</strong>vage ; que l’histoire et les voyages constataient, <strong>au</strong><br />
contraire, l’existence de be<strong>au</strong>coup d’espèces de s<strong>au</strong>vages, très différentes ;<br />
que la plupart étaient encore féroces, et anthropophages à l’occasion. Devant<br />
ce fait, les ferini, ceux qui soutenaient que l’humanité première était bestiale,<br />
triomphaient <strong>des</strong> anti-ferini, et marquaient un point.<br />
L’artifice avait m<strong>au</strong>vaise réputation, mais l’art était sacré. L’artifice<br />
étouffe la nature, mais la nature a besoin d’être corrigée par l’art. Conviction<br />
si profonde alors, qu’elle anima les expressions de la be<strong>au</strong>té, plastique ou<br />
littéraire ; qu’elle p.361 se développa dans les traités innombrables ; qu’elle<br />
dicta les préceptes de la composition, et qu’on essaya même de réunir en un<br />
seul les deux concepts : toutes les notions que nous possédons étant naturelles,<br />
l’art est naturel. On crut volontiers que la vraie nature était celle que l’art avait<br />
transformée ; par l’art elle s’étend , se corrige et se polit ; elle élague le<br />
chardon et la ronce, elle multiplie la rose et le raisin ; la vraie nature n’est pas<br />
1 <strong>Les</strong>sing, <strong>La</strong>ocoon, 1766. Par. XXV.