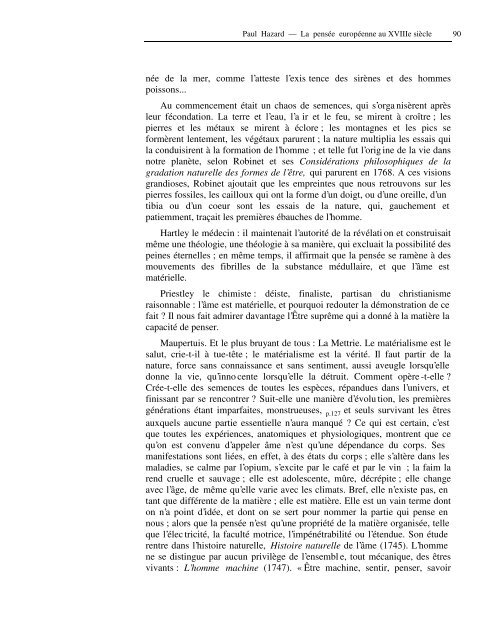La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 90<br />
née de la mer, comme l’atteste l’exis tence <strong>des</strong> sirènes et <strong>des</strong> hommes<br />
poissons...<br />
Au commencement était un chaos de semences, qui s’orga nisèrent après<br />
leur fécondation. <strong>La</strong> terre et l’e<strong>au</strong>, l’a ir et le feu, se mirent à croître ; les<br />
pierres et les mét<strong>au</strong>x se mirent à éclore ; les montagnes et les pics se<br />
formèrent lentement, les végét<strong>au</strong>x parurent ; la nature multiplia les essais qui<br />
la conduisirent à la formation de l’homme ; et telle fut l’orig ine de la vie dans<br />
notre planète, selon Robinet et ses Considérations philosophiques de la<br />
gradation naturelle <strong>des</strong> formes de l’être, qui parurent en 1768. A ces visions<br />
grandioses, Robinet ajoutait que les empreintes que nous retrouvons sur les<br />
pierres fossiles, les cailloux qui ont la forme d’un doigt, ou d’une oreille, d’un<br />
tibia ou d’un coeur sont les essais de la nature, qui, g<strong>au</strong>chement et<br />
patiemment, traçait les premières éb<strong>au</strong>ches de l’homme.<br />
Hartley le médecin : il maintenait l’<strong>au</strong>torité de la révélati on et construisait<br />
même une théologie, une théologie à sa manière, qui excluait la possibilité <strong>des</strong><br />
peines éternelles ; en même temps, il affirmait que la <strong>pensée</strong> se ramène à <strong>des</strong><br />
mouvements <strong>des</strong> fibrilles de la substance médullaire, et que l’âme est<br />
matérielle.<br />
Priestley le chimiste : déiste, finaliste, partisan du christianisme<br />
raisonnable : l’âme est matérielle, et pourquoi redouter la démonstration de ce<br />
fait ? Il nous fait admirer davantage l’Être suprême qui a donné à la matière la<br />
capacité de penser.<br />
M<strong>au</strong>pertuis. Et le plus bruyant de tous : <strong>La</strong> Mettrie. Le matérialisme est le<br />
salut, crie-t-il à tue-tête ; le matérialisme est la vérité. Il f<strong>au</strong>t partir de la<br />
nature, force sans connaissance et sans sentiment, <strong>au</strong>ssi aveugle lorsqu’elle<br />
donne la vie, qu’inno cente lorsqu’elle la détruit. Comment opère -t-elle ?<br />
Crée-t-elle <strong>des</strong> semences de toutes les espèces, répandues dans l’univers, et<br />
finissant par se rencontrer ? Suit-elle une manière d’évolu tion, les premières<br />
générations étant imparfaites, monstrueuses, p.127 et seuls survivant les êtres<br />
<strong>au</strong>xquels <strong>au</strong>cune partie essentielle n’<strong>au</strong>ra manqué ? Ce qui est certain, c’est<br />
que toutes les expériences, anatomiques et physiologiques, montrent que ce<br />
qu’on est convenu d’appeler âme n’est qu’une dépendance du corps. Ses<br />
manifestations sont liées, en effet, à <strong>des</strong> états du corps ; elle s’altère dans les<br />
maladies, se calme par l’opium, s’excite par le café et par le vin ; la faim la<br />
rend cruelle et s<strong>au</strong>vage ; elle est adolescente, mûre, décrépite ; elle change<br />
avec l’âge, de même qu’elle varie avec les climats. Bref, elle n’existe pas, en<br />
tant que différente de la matière ; elle est matière. Elle est un vain terme dont<br />
on n’a point d’idée, et dont on se sert pour nommer la partie qui pense en<br />
nous ; alors que la <strong>pensée</strong> n’est qu’une propriété de la matière organisée, telle<br />
que l’élec tricité, la faculté motrice, l’impénétrabilité ou l’étendue. Son étude<br />
rentre dans l’histoire naturelle, Histoire naturelle de l’âme (1745). L’homme<br />
ne se distingue par <strong>au</strong>cun privilège de l’ensembl e, tout mécanique, <strong>des</strong> êtres<br />
vivants : L’homme machine (1747). « Être machine, sentir, penser, savoir