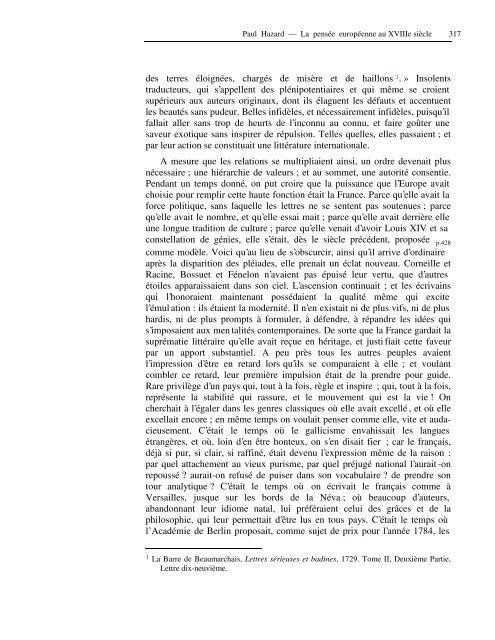La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 317<br />
<strong>des</strong> terres éloignées, chargés de misère et de haillons 1. » Insolents<br />
traducteurs, qui s’appellent <strong>des</strong> plénipotentiaires et qui même se croient<br />
supérieurs <strong>au</strong>x <strong>au</strong>teurs origin<strong>au</strong>x, dont ils élaguent les déf<strong>au</strong>ts et accentuent<br />
les be<strong>au</strong>tés sans pudeur. Belles infidèles, et nécessairement infidèles, puisqu’il<br />
fallait aller sans trop de heurts de l’inconnu <strong>au</strong> connu, et faire goûter une<br />
saveur exotique sans inspirer de répulsion. Telles quelles, elles passaient ; et<br />
par leur action se constituait une littérature internationale.<br />
A mesure que les relations se multipliaient ainsi, un ordre devenait plus<br />
nécessaire ; une hiérarchie de valeurs ; et <strong>au</strong> sommet, une <strong>au</strong>torité consentie.<br />
Pendant un temps donné, on put croire que la puissance que l’Europe avait<br />
choisie pour remplir cette h<strong>au</strong>te fonction était la France. Parce qu’elle avait la<br />
force politique, sans laquelle les lettres ne se sentent pas soutenues ; parce<br />
qu’elle avait le nombre, et qu’elle essai mait ; parce qu’elle avait derrière elle<br />
une longue tradition de culture ; parce qu’elle venait d’avoir Louis XIV et sa<br />
constellation de génies, elle s’était, dès le <strong>siècle</strong> précédent, proposée p.428<br />
comme modèle. Voici qu’<strong>au</strong> lieu de s’obscurcir, ainsi qu’il arrive d’ordinaire<br />
après la disparition <strong>des</strong> pléia<strong>des</strong>, elle prenait un éclat nouve<strong>au</strong>. Corneille et<br />
Racine, Bossuet et Fénelon n’avaient pas épuisé leur vertu, que d’<strong>au</strong>tres<br />
étoiles apparaissaient dans son ciel. L’ascension continuait ; et les écrivains<br />
qui l’honoraient maintenant possédaient la qualité même qui excite<br />
l’émul ation : ils étaient la modernité. Il n’en existait ni de plus vifs, ni de plus<br />
hardis, ni de plus prompts à formuler, à défendre, à répandre les idées qui<br />
s’imposaient <strong>au</strong>x men talités contemporaines. De sorte que la France gardait la<br />
suprématie littéraire qu’elle avait reçue en héritage, et justi fiait cette faveur<br />
par un apport substantiel. A peu près tous les <strong>au</strong>tres peuples avaient<br />
l’impression d’être en retard lors qu’ils se comparaient à elle ; et voulant<br />
combler ce retard, leur première impulsion était de la prendre pour guide.<br />
Rare privilège d’un pays qui, tout à la fois, règle et inspire ; qui, tout à la fois,<br />
représente la stabilité qui rassure, et le mouvement qui est la vie ! On<br />
cherchait à l’égaler dans les genres classiques où elle avait excellé , et où elle<br />
excellait encore ; en même temps on voulait penser comme elle, vite et <strong>au</strong>dacieusement.<br />
C’était le temps où le gallicisme envahissait les langues<br />
étrangères, et où, loin d’en être honteux, on s’en disait fier ; car le français,<br />
déjà si pur, si clair, si raffiné, était devenu l’expression même de la raison :<br />
par quel attachement <strong>au</strong> vieux purisme, par quel préjugé national l’<strong>au</strong>rait -on<br />
repoussé ? <strong>au</strong>rait-on refusé de puiser dans son vocabulaire ? de prendre son<br />
tour analytique ? C’était le temps où on écrivait le français comme à<br />
Versailles, jusque sur les bords de la Néva ; où be<strong>au</strong>coup d’<strong>au</strong>teurs,<br />
abandonnant leur idiome natal, lui préféraient celui <strong>des</strong> grâces et de la<br />
philosophie, qui leur permettait d’être lus en tous pays. C’était le temps où<br />
l’ Académie de Berlin proposait, comme sujet de prix pour l’année 1784, les<br />
1 <strong>La</strong> Barre de Be<strong>au</strong>marchais, Lettres sérieuses et badines, 1729. Tome II, Deuxième Partie,<br />
Lettre dix-neuvième.