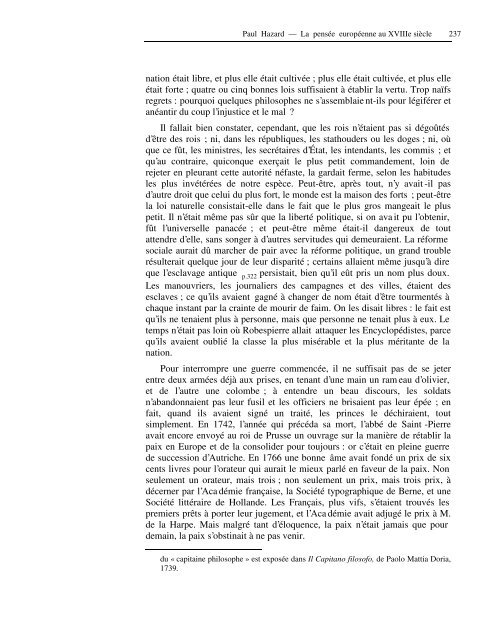La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 237<br />
nation était libre, et plus elle était cultivée ; plus elle était cultivée, et plus elle<br />
était forte ; quatre ou cinq bonnes lois suffisaient à établir la vertu. Trop naïfs<br />
regrets : pourquoi quelques philosophes ne s’assemblaie nt-ils pour légiférer et<br />
anéantir du coup l’injustice et le mal ?<br />
Il fallait bien constater, cependant, que les rois n’étaient pas si dégoûtés<br />
d’être <strong>des</strong> rois ; ni, dans les républiques, les stathouders ou les doges ; ni, où<br />
que ce fût, les ministres, les secrétaires d’État, les intendants, les commis ; et<br />
qu’<strong>au</strong> contraire, quiconque exerçait le plus petit commandement, loin de<br />
rejeter en pleurant cette <strong>au</strong>torité néfaste, la gardait ferme, selon les habitu<strong>des</strong><br />
les plus invétérées de notre espèce. Peut-être, après tout, n’y avait -il pas<br />
d’<strong>au</strong>tre droit que celui du plus fort, le monde est la maison <strong>des</strong> forts ; peut-être<br />
la loi naturelle consistait-elle dans le fait que le plus gros mangeait le plus<br />
petit. Il n’était même pas sûr que la liberté politique, si on ava it pu l’obtenir,<br />
fût l’universelle panacée ; et peut-être même était-il dangereux de tout<br />
attendre d’elle, sans songer à d’<strong>au</strong>tres servitu<strong>des</strong> qui demeuraient. <strong>La</strong> réforme<br />
sociale <strong>au</strong>rait dû marcher de pair avec la réforme politique, un grand trouble<br />
résulterait quelque jour de leur disparité ; certains allaient même jusqu’à dire<br />
que l’esclavage antique p.322 persistait, bien qu’il eût pris un nom plus doux.<br />
<strong>Les</strong> manouvriers, les journaliers <strong>des</strong> campagnes et <strong>des</strong> villes, étaient <strong>des</strong><br />
esclaves ; ce qu’ils avaient gagné à changer de nom était d’être tourmentés à<br />
chaque instant par la crainte de mourir de faim. On les disait libres : le fait est<br />
qu’ils ne tenaient plus à personne, mais que personne ne tenait plus à eux. Le<br />
temps n’était pas loin où Robespierre allait attaquer les Encyclopédistes, parce<br />
qu’ils avaient oublié la classe la plus misérable et la plus méritante de la<br />
nation.<br />
Pour interrompre une guerre commencée, il ne suffisait pas de se jeter<br />
entre deux armées déjà <strong>au</strong>x prises, en tenant d’une main un ram e<strong>au</strong> d’olivier,<br />
et de l’<strong>au</strong>tre une colombe ; à entendre un be<strong>au</strong> discours, les soldats<br />
n’abandonnaient pas leur fusil et les officiers ne brisaient pas leur épée ; en<br />
fait, quand ils avaient signé un traité, les princes le déchiraient, tout<br />
simplement. En 1742, l’année qui précéda sa mort, l’abbé de Saint -Pierre<br />
avait encore envoyé <strong>au</strong> roi de Prusse un ouvrage sur la manière de rétablir la<br />
paix en Europe et de la consolider pour toujours : or c’était en pleine guerre<br />
de succession d’Autriche. En 1766 une bonne âme avait fondé un prix de six<br />
cents livres pour l’orateur qui <strong>au</strong>rait le mieux parlé en faveur de la paix. Non<br />
seulement un orateur, mais trois ; non seulement un prix, mais trois prix, à<br />
décerner par l’Aca démie française, la Société typographique de Berne, et une<br />
Société littéraire de Hollande. <strong>Les</strong> Français, plus vifs, s’étaient trouvés les<br />
premiers prêts à porter leur jugement, et l’Aca démie avait adjugé le prix à M.<br />
de la Harpe. Mais malgré tant d’éloquence, la paix n’était jamais que pour<br />
demain, la paix s’obstinait à ne pas venir.<br />
du « capitaine philosophe » est exposée dans Il Capitano filosofo, de Paolo Mattia Doria,<br />
1739.