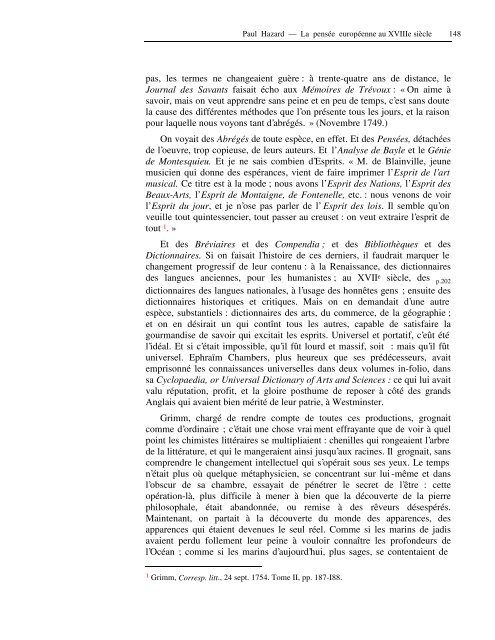La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 148<br />
pas, les termes ne changeaient guère : à trente-quatre ans de distance, le<br />
Journal <strong>des</strong> Savants faisait écho <strong>au</strong>x Mémoires de Trévoux : « On aime à<br />
savoir, mais on veut apprendre sans peine et en peu de temps, c’est sans doute<br />
la c<strong>au</strong>se <strong>des</strong> différentes métho<strong>des</strong> que l’on présente tous les jours, et la raison<br />
pour laquelle nous voyons tant d’abrégés. » (Novembre 1749.)<br />
On voyait <strong>des</strong> Abrégés de toute espèce, en effet. Et <strong>des</strong> Pensées, détachées<br />
de l’oeuvre, trop copieuse, de leurs <strong>au</strong>teurs. Et l’ Analyse de Bayle et le Génie<br />
de Montesquieu. Et je ne sais combien d’Esprits. « M. de Blainville, jeune<br />
musicien qui donne <strong>des</strong> espérances, vient de faire imprimer l’ Esprit de l’art<br />
musical. Ce titre est à la mode ; nous avons l’ Esprit <strong>des</strong> Nations, l’ Esprit <strong>des</strong><br />
Be<strong>au</strong>x-Arts, l’ Esprit de Montaigne, de Fontenelle, etc. : nous venons de voir<br />
l’ Esprit du jour, et je n’ose pas parler de l’ Esprit <strong>des</strong> lois. Il semble qu’on<br />
veuille tout quintessencier, tout passer <strong>au</strong> creuset : on veut extraire l’esprit de<br />
tout 1. »<br />
Et <strong>des</strong> Bréviaires et <strong>des</strong> Compendia ; et <strong>des</strong> Bibliothèques et <strong>des</strong><br />
Dictionnaires. Si on faisait l’histoire de ces derniers, il f<strong>au</strong>drait marquer le<br />
changement progressif de leur contenu : à la Renaissance, <strong>des</strong> dictionnaires<br />
<strong>des</strong> langues anciennes, pour les humanistes ; <strong>au</strong> XVII e <strong>siècle</strong>, <strong>des</strong> p.202<br />
dictionnaires <strong>des</strong> langues nationales, à l’usage <strong>des</strong> honnêtes gens ; ensuite <strong>des</strong><br />
dictionnaires historiques et critiques. Mais on en demandait d’une <strong>au</strong>tre<br />
espèce, substantiels : dictionnaires <strong>des</strong> arts, du commerce, de la géographie ;<br />
et on en désirait un qui contînt tous les <strong>au</strong>tres, capable de satisfaire la<br />
gourmandise de savoir qui excitait les esprits. Universel et portatif, c’eût été<br />
l’idéal. Et si c’était impossible, qu’il fût lourd et massif, soit : mais qu’il fût<br />
universel. Ephraïm Chambers, plus heureux que ses prédécesseurs, avait<br />
emprisonné les connaissances universelles dans deux volumes in-folio, dans<br />
sa Cyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts and Sciences : ce qui lui avait<br />
valu réputation, profit, et la gloire posthume de reposer à côté <strong>des</strong> grands<br />
Anglais qui avaient bien mérité de leur patrie, à Westminster.<br />
Grimm, chargé de rendre compte de toutes ces productions, grognait<br />
comme d’ordinaire ; c’était une chose vrai ment effrayante que de voir à quel<br />
point les chimistes littéraires se multipliaient : chenilles qui rongeaient l’arbre<br />
de la littérature, et qui le mangeraient ainsi jusqu’<strong>au</strong>x racines. Il grognait, sans<br />
comprendre le changement intellectuel qui s’opérait sous ses yeux. Le temps<br />
n’était plus où quelque métaphysicien, se concentrant sur lui -même et dans<br />
l’obscur de sa chambre, essayait de pénétrer le secret de l’être : cette<br />
opération-là, plus difficile à mener à bien que la découverte de la pierre<br />
philosophale, était abandonnée, ou remise à <strong>des</strong> rêveurs désespérés.<br />
Maintenant, on partait à la découverte du monde <strong>des</strong> apparences, <strong>des</strong><br />
apparences qui étaient devenues le seul réel. Comme si les marins de jadis<br />
avaient perdu follement leur peine à vouloir connaître les profondeurs de<br />
l’Océan ; comme si les marins d’<strong>au</strong>jourd’hui, plus sages, se contentaient de<br />
1 Grimm, Corresp. litt., 24 sept. 1754. Tome II, pp. 187-I88.