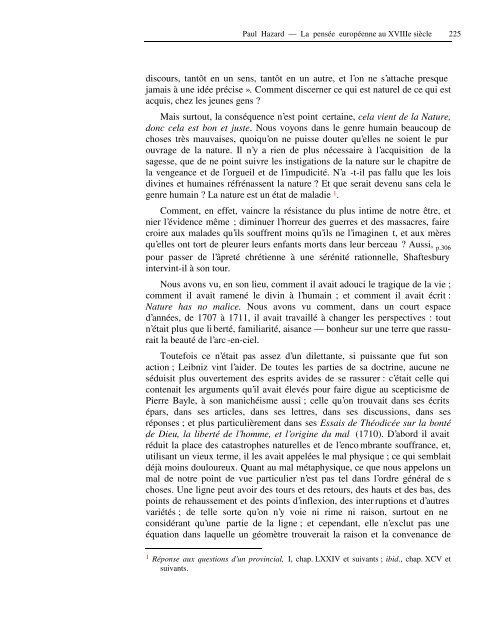La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 225<br />
discours, tantôt en un sens, tantôt en un <strong>au</strong>tre, et l’on ne s’attache presque<br />
jamais à une idée précise ». Comment discerner ce qui est naturel de ce qui est<br />
acquis, chez les jeunes gens ?<br />
Mais surtout, la conséquence n’est point certaine, cela vient de la Nature,<br />
donc cela est bon et juste. Nous voyons dans le genre humain be<strong>au</strong>coup de<br />
choses très m<strong>au</strong>vaises, quoiqu’on ne puisse douter qu’elles ne soient le pur<br />
ouvrage de la nature. Il n’y a rien de plus nécessaire à l’acquisition de la<br />
sagesse, que de ne point suivre les instigations de la nature sur le chapitre de<br />
la vengeance et de l’orgueil et de l’impudicité. N’a -t-il pas fallu que les lois<br />
divines et humaines réfrénassent la nature ? Et que serait devenu sans cela le<br />
genre humain ? <strong>La</strong> nature est un état de maladie 1.<br />
Comment, en effet, vaincre la résistance du plus intime de notre être, et<br />
nier l’évidence même ; diminuer l’horreur <strong>des</strong> guerres et <strong>des</strong> massacres, faire<br />
croire <strong>au</strong>x mala<strong>des</strong> qu’ils souffrent moins qu’ils ne l’imaginen t, et <strong>au</strong>x mères<br />
qu’elles ont tort de pleurer leurs enfants morts dans leur berce<strong>au</strong> ? Aussi, p.306<br />
pour passer de l’âpreté chrétienne à une sérénité rationnelle, Shaftesbury<br />
intervint-il à son tour.<br />
Nous avons vu, en son lieu, comment il avait adouci le tragique de la vie ;<br />
comment il avait ramené le divin à l’humain ; et comment il avait écrit :<br />
Nature has no malice. Nous avons vu comment, dans un court espace<br />
d’années, de 1707 à 1711, il avait travaillé à changer les perspectives : tout<br />
n’était plus que li berté, familiarité, aisance — bonheur sur une terre que rassurait<br />
la be<strong>au</strong>té de l’arc -en-ciel.<br />
Toutefois ce n’était pas assez d’un dilettante, si puissante que fut son<br />
action ; Leibniz vint l’aider. De toutes les parties de sa doctrine, <strong>au</strong>cune ne<br />
séduisit plus ouvertement <strong>des</strong> esprits avi<strong>des</strong> de se rassurer : c’était celle qui<br />
contenait les arguments qu’il avait élevés pour faire digue <strong>au</strong> scepticisme de<br />
Pierre Bayle, à son manichéisme <strong>au</strong>ssi ; celle qu’on trouvait dans ses écrits<br />
épars, dans ses articles, dans ses lettres, dans ses discussions, dans ses<br />
réponses ; et plus particulièrement dans ses Essais de Théodicée sur la bonté<br />
de Dieu, la liberté de l’homme, et l’origine du mal (1710). D’abord il avait<br />
réduit la place <strong>des</strong> catastrophes naturelles et de l’enco mbrante souffrance, et,<br />
utilisant un vieux terme, il les avait appelées le mal physique ; ce qui semblait<br />
déjà moins douloureux. Quant <strong>au</strong> mal métaphysique, ce que nous appelons un<br />
mal de notre point de vue particulier n’est pas tel dans l’ordre général de s<br />
choses. Une ligne peut avoir <strong>des</strong> tours et <strong>des</strong> retours, <strong>des</strong> h<strong>au</strong>ts et <strong>des</strong> bas, <strong>des</strong><br />
points de reh<strong>au</strong>ssement et <strong>des</strong> points d’inflexion, <strong>des</strong> inter ruptions et d’<strong>au</strong>tres<br />
variétés ; de telle sorte qu’on n’y voie ni rime ni raison, surtout en ne<br />
considérant qu’une partie de la ligne ; et cependant, elle n’exclut pas une<br />
équation dans laquelle un géomètre trouverait la raison et la convenance de<br />
1 Réponse <strong>au</strong>x questions d’un provincial, I, chap. LXXIV et suivants ; ibid., chap. XCV et<br />
suivants.