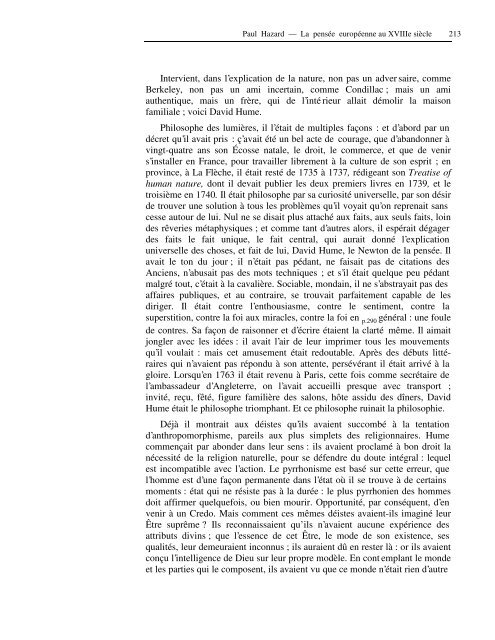La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 213<br />
Intervient, dans l’explication de la nature, non pas un adver saire, comme<br />
Berkeley, non pas un ami incertain, comme Condillac ; mais un ami<br />
<strong>au</strong>thentique, mais un frère, qui de l’inté rieur allait démolir la maison<br />
familiale ; voici David Hume.<br />
Philosophe <strong>des</strong> lumières, il l’était de multiples façons : et d’abord par un<br />
décret qu’il avait pris : ç’avait été un bel acte de courage, que d’abandonner à<br />
vingt-quatre ans son Écosse natale, le droit, le commerce, et que de venir<br />
s’installer en France, pour travailler librement à la culture de son esprit ; en<br />
province, à <strong>La</strong> Flèche, il était resté de 1735 à 1737, rédigeant son Treatise of<br />
human nature, dont il devait publier les deux premiers livres en 1739, et le<br />
troisième en 1740. Il était philosophe par sa curiosité universelle, par son désir<br />
de trouver une solution à tous les problèmes qu’il voyait qu’on reprenait sans<br />
cesse <strong>au</strong>tour de lui. Nul ne se disait plus attaché <strong>au</strong>x faits, <strong>au</strong>x seuls faits, loin<br />
<strong>des</strong> rêveries métaphysiques ; et comme tant d’<strong>au</strong>tres alors, il espérait dégager<br />
<strong>des</strong> faits le fait unique, le fait central, qui <strong>au</strong>rait donné l’explication<br />
universelle <strong>des</strong> choses, et fait de lui, David Hume, le Newton de la <strong>pensée</strong>. Il<br />
avait le ton du jour ; il n’était pas pédant, ne faisait pas de citations <strong>des</strong><br />
Anciens, n’abusait pas <strong>des</strong> mots techniques ; et s’il était quelque peu pédant<br />
malgré tout, c’était à la cavalière. Sociable, mondain, il ne s’abstrayait pas <strong>des</strong><br />
affaires publiques, et <strong>au</strong> contraire, se trouvait parfaitement capable de les<br />
diriger. Il était contre l’enthousiasme, contre le sentiment, contre la<br />
superstition, contre la foi <strong>au</strong>x miracles, contre la foi en p.290 général : une foule<br />
de contres. Sa façon de raisonner et d’écrire étaient la clarté même. Il aimait<br />
jongler avec les idées : il avait l’air de leur imprimer tous les mouvements<br />
qu’il voulait : mais cet amusement était redoutable. Après <strong>des</strong> débuts littéraires<br />
qui n’avaient pas répondu à son attente, persévérant il était arrivé à la<br />
gloire. Lorsqu’en 1763 il était revenu à Paris, cette fois comme secrétaire de<br />
l’ambassadeur d’Angleterre, on l’avait accueilli presque avec transport ;<br />
invité, reçu, fêté, figure familière <strong>des</strong> salons, hôte assidu <strong>des</strong> dîners, David<br />
Hume était le philosophe triomphant. Et ce philosophe ruinait la philosophie.<br />
Déjà il montrait <strong>au</strong>x déistes qu’ils avaient succombé à la tentation<br />
d’anthropomorphisme, pareils <strong>au</strong>x plus simplets <strong>des</strong> religionnaires. Hume<br />
commençait par abonder dans leur sens : ils avaient proclamé à bon droit la<br />
nécessité de la religion naturelle, pour se défendre du doute intégral : lequel<br />
est incompatible avec l’action. Le pyrrhonisme est basé sur cette erreur, que<br />
l’homme est d’une façon permanente dans l’état où il se trouve à de certains<br />
moments : état qui ne résiste pas à la durée : le plus pyrrhonien <strong>des</strong> hommes<br />
doit affirmer quelquefois, ou bien mourir. Opportunité, par conséquent, d’en<br />
venir à un Credo. Mais comment ces mêmes déistes avaient-ils imaginé leur<br />
Être suprême ? Ils reconnaissaient qu’ ils n’avaient <strong>au</strong>cune expérience <strong>des</strong><br />
attributs divins ; que l’essence de cet Être, le mode de son existence, ses<br />
qualités, leur demeuraient inconnus ; ils <strong>au</strong>raient dû en rester là : or ils avaient<br />
conçu l’intelligence de Dieu sur leur propre modèle. En cont emplant le monde<br />
et les parties qui le composent, ils avaient vu que ce monde n’était rien d’<strong>au</strong>tre