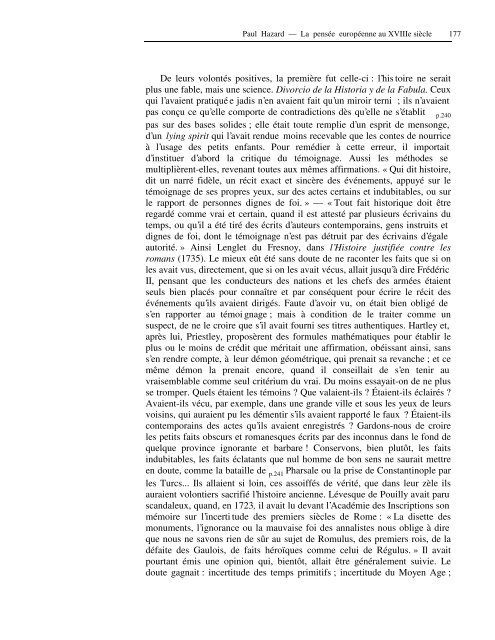La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 177<br />
De leurs volontés positives, la première fut celle-ci : l’his toire ne serait<br />
plus une fable, mais une science. Divorcio de la Historia y de la Fabula. Ceux<br />
qui l’avaient pratiqué e jadis n’en avaient fait qu’un miroir terni ; ils n’avaient<br />
pas conçu ce qu’elle comporte de contradictions dès qu’elle ne s’établit p.240<br />
pas sur <strong>des</strong> bases soli<strong>des</strong> ; elle était toute remplie d’un esprit de mensonge,<br />
d’un lying spirit qui l’avait rendue moins recevable que les contes de nourrice<br />
à l’usage <strong>des</strong> petits enfants. Pour remédier à cette erreur, il importait<br />
d’instituer d’abord la critique du témoignage. Aussi les métho<strong>des</strong> se<br />
multiplièrent-elles, revenant toutes <strong>au</strong>x mêmes affirmations. « Qui dit histoire,<br />
dit un narré fidèle, un récit exact et sincère <strong>des</strong> événements, appuyé sur le<br />
témoignage de ses propres yeux, sur <strong>des</strong> actes certains et indubitables, ou sur<br />
le rapport de personnes dignes de foi. » — « Tout fait historique doit être<br />
regardé comme vrai et certain, quand il est attesté par plusieurs écrivains du<br />
temps, ou qu’il a été tiré <strong>des</strong> écrits d’<strong>au</strong>teurs contemporains, gens instruits et<br />
dignes de foi, dont le témoignage n’est pas détruit par <strong>des</strong> écrivains d’égale<br />
<strong>au</strong>torité. » Ainsi Lenglet du Fresnoy, dans l’Histoire justifiée contre les<br />
romans (1735). Le mieux eût été sans doute de ne raconter les faits que si on<br />
les avait vus, directement, que si on les avait vécus, allait jusqu’à dire Frédéric<br />
II, pensant que les conducteurs <strong>des</strong> nations et les chefs <strong>des</strong> armées étaient<br />
seuls bien placés pour connaître et par conséquent pour écrire le récit <strong>des</strong><br />
événements qu’ils avaient dirigés. F<strong>au</strong>te d’avoir vu, on était bien obligé de<br />
s’en rapporter <strong>au</strong> témoi gnage ; mais à condition de le traiter comme un<br />
suspect, de ne le croire que s’il avait fourni ses titres <strong>au</strong>thentiques. Hartley et,<br />
après lui, Priestley, proposèrent <strong>des</strong> formules mathématiques pour établir le<br />
plus ou le moins de crédit que méritait une affirmation, obéissant ainsi, sans<br />
s’en rendre compte, à leur démon géométrique, qui prenait sa revanche ; et ce<br />
même démon la prenait encore, quand il conseillait de s’en tenir <strong>au</strong><br />
vraisemblable comme seul critérium du vrai. Du moins essayait-on de ne plus<br />
se tromper. Quels étaient les témoins ? Que valaient-ils ? Étaient-ils éclairés ?<br />
Avaient-ils vécu, par exemple, dans une grande ville et sous les yeux de leurs<br />
voisins, qui <strong>au</strong>raient pu les démentir s’ils avaient rapporté le f<strong>au</strong>x ? Étaient-ils<br />
contemporains <strong>des</strong> actes qu’ils avaient enregistrés ? Gardons-nous de croire<br />
les petits faits obscurs et romanesques écrits par <strong>des</strong> inconnus dans le fond de<br />
quelque province ignorante et barbare ! Conservons, bien plutôt, les faits<br />
indubitables, les faits éclatants que nul homme de bon sens ne s<strong>au</strong>rait mettre<br />
en doute, comme la bataille de p.241 Pharsale ou la prise de Constantinople par<br />
les Turcs... Ils allaient si loin, ces assoiffés de vérité, que dans leur zèle ils<br />
<strong>au</strong>raient volontiers sacrifié l’histoire ancienne. Lévesque de Pouilly avait paru<br />
scandaleux, quand, en 1723, il avait lu devant l’Académie <strong>des</strong> Inscriptions son<br />
mémoire sur l’incerti tude <strong>des</strong> premiers <strong>siècle</strong>s de Rome : « <strong>La</strong> disette <strong>des</strong><br />
monuments, l’ignorance ou la m<strong>au</strong>vaise foi <strong>des</strong> annalistes nous oblige à dire<br />
que nous ne savons rien de sûr <strong>au</strong> sujet de Romulus, <strong>des</strong> premiers rois, de la<br />
défaite <strong>des</strong> G<strong>au</strong>lois, de faits héroïques comme celui de Régulus. » Il avait<br />
pourtant émis une opinion qui, bientôt, allait être généralement suivie. Le<br />
doute gagnait : incertitude <strong>des</strong> temps primitifs ; incertitude du Moyen Age ;