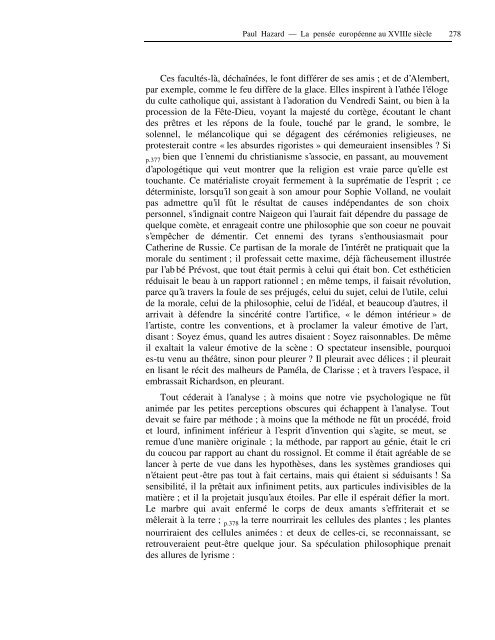La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 278<br />
Ces facultés-là, déchaînées, le font différer de ses amis ; et de d’Alembert,<br />
par exemple, comme le feu diffère de la glace. Elles inspirent à l’athée l’éloge<br />
du culte catholique qui, assistant à l’adoration du Vendredi Saint, ou bien à la<br />
procession de la Fête-Dieu, voyant la majesté du cortège, écoutant le chant<br />
<strong>des</strong> prêtres et les répons de la foule, touché par le grand, le sombre, le<br />
solennel, le mélancolique qui se dégagent <strong>des</strong> cérémonies religieuses, ne<br />
protesterait contre « les absur<strong>des</strong> rigoristes » qui demeuraient insensibles ? Si<br />
p.377 bien que 1’ennemi du christianisme s’associe, en passant, <strong>au</strong> mouvement<br />
d’apologétique qui veut montrer que la religion est vraie parce qu’elle est<br />
touchante. Ce matérialiste croyait fermement à la suprématie de l’esprit ; ce<br />
déterministe, lorsqu’il son geait à son amour pour Sophie Volland, ne voulait<br />
pas admettre qu’il fût le résultat de c<strong>au</strong>ses indépendantes de son choix<br />
personnel, s’indignait contre Naigeon qui l’<strong>au</strong>rait fait dépendre du passage de<br />
quelque comète, et enrageait contre une philosophie que son coeur ne pouvait<br />
s’empêcher de démentir. Cet ennemi <strong>des</strong> tyrans s’enthousiasmait pour<br />
Catherine de Russie. Ce partisan de la morale de l’intérêt ne pratiquait que la<br />
morale du sentiment ; il professait cette maxime, déjà fâcheusement illustrée<br />
par l’ab bé Prévost, que tout était permis à celui qui était bon. Cet esthéticien<br />
réduisait le be<strong>au</strong> à un rapport rationnel ; en même temps, il faisait révolution,<br />
parce qu’à travers la foule de ses préjugés, celui du sujet, celui de l’utile, celui<br />
de la morale, celui de la philosophie, celui de l’idéal, et be<strong>au</strong>coup d’<strong>au</strong>tres, il<br />
arrivait à défendre la sincérité contre l’artifice, « le démon intérieur » de<br />
l’artiste, contre les conventions, et à proclamer la valeur émotive de l’art,<br />
disant : Soyez émus, quand les <strong>au</strong>tres disaient : Soyez raisonnables. De même<br />
il exaltait la valeur émotive de la scène : O spectateur insensible, pourquoi<br />
es-tu venu <strong>au</strong> théâtre, sinon pour pleurer ? Il pleurait avec délices ; il pleurait<br />
en lisant le récit <strong>des</strong> malheurs de Paméla, de Clarisse ; et à travers l’espace, il<br />
embrassait Richardson, en pleurant.<br />
Tout céderait à l’analyse ; à moins que notre vie psychologique ne fût<br />
animée par les petites perceptions obscures qui échappent à l’analyse. Tout<br />
devait se faire par méthode ; à moins que la méthode ne fût un procédé, froid<br />
et lourd, infiniment inférieur à l’esprit d’invention qui s’agite, se meut, se<br />
remue d’une manière originale ; la méthode, par rapport <strong>au</strong> génie, était le cri<br />
du coucou par rapport <strong>au</strong> chant du rossignol. Et comme il était agréable de se<br />
lancer à perte de vue dans les hypothèses, dans les systèmes grandioses qui<br />
n’étaient peut -être pas tout à fait certains, mais qui étaient si séduisants ! Sa<br />
sensibilité, il la prêtait <strong>au</strong>x infiniment petits, <strong>au</strong>x particules indivisibles de la<br />
matière ; et il la projetait jusqu’<strong>au</strong>x étoiles. Par elle il espérait défier la mort.<br />
Le marbre qui avait enfermé le corps de deux amants s’effriterait et se<br />
mêlerait à la terre ; p.378 la terre nourrirait les cellules <strong>des</strong> plantes ; les plantes<br />
nourriraient <strong>des</strong> cellules animées : et deux de celles-ci, se reconnaissant, se<br />
retrouveraient peut-être quelque jour. Sa spéculation philosophique prenait<br />
<strong>des</strong> allures de lyrisme :