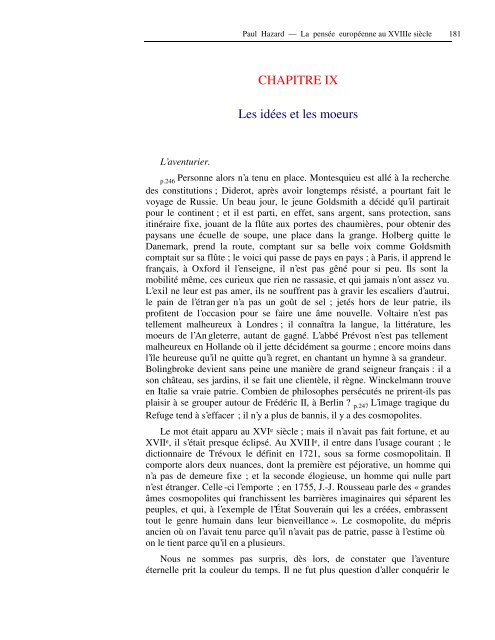La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
La pensée européenne au XVIIIe siècle - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’aventurier.<br />
P<strong>au</strong>l Hazard — <strong>La</strong> <strong>pensée</strong> <strong>européenne</strong> <strong>au</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>siècle</strong> 181<br />
CHAPITRE IX<br />
<strong>Les</strong> idées et les moeurs<br />
p.246 Personne alors n’a tenu en place. Montesquieu est allé à la recherche<br />
<strong>des</strong> constitutions ; Diderot, après avoir longtemps résisté, a pourtant fait le<br />
voyage de Russie. Un be<strong>au</strong> jour, le jeune Goldsmith a décidé qu’il partirait<br />
pour le continent ; et il est parti, en effet, sans argent, sans protection, sans<br />
itinéraire fixe, jouant de la flûte <strong>au</strong>x portes <strong>des</strong> ch<strong>au</strong>mières, pour obtenir <strong>des</strong><br />
paysans une écuelle de soupe, une place dans la grange. Holberg quitte le<br />
Danemark, prend la route, comptant sur sa belle voix comme Goldsmith<br />
comptait sur sa flûte ; le voici qui passe de pays en pays ; à Paris, il apprend le<br />
français, à Oxford il l’enseigne, il n’est pas gêné pour si peu. Ils sont la<br />
mobilité même, ces curieux que rien ne rassasie, et qui jamais n’ont assez vu.<br />
L’exil ne leur est pas amer, ils ne souffrent pas à gravir les escaliers d’<strong>au</strong>trui,<br />
le pain de l’étran ger n’a pas un goût de sel ; jetés hors de leur patrie, ils<br />
profitent de l’occasion pour se faire une âme nouvelle. Voltaire n’est pas<br />
tellement malheureux à Londres ; il connaîtra la langue, la littérature, les<br />
moeurs de l’An gleterre, <strong>au</strong>tant de gagné. L’abbé Prévost n’est pas tellement<br />
malheureux en Hollande où il jette décidément sa gourme ; encore moins dans<br />
l’île heureuse qu’il ne quitte qu’à regret, en chantant un hymne à sa grandeur.<br />
Bolingbroke devient sans peine une manière de grand seigneur français : il a<br />
son châte<strong>au</strong>, ses jardins, il se fait une clientèle, il règne. Winckelmann trouve<br />
en Italie sa vraie patrie. Combien de philosophes persécutés ne prirent-ils pas<br />
plaisir à se grouper <strong>au</strong>tour de Frédéric II, à Berlin ? p.247 L’image tragique du<br />
Refuge tend à s’effacer ; il n’y a plus de bannis, il y a <strong>des</strong> cosmopolites.<br />
Le mot était apparu <strong>au</strong> XVI e <strong>siècle</strong> ; mais il n’avait pas fait fortune, et <strong>au</strong><br />
XVII e, il s’était presque éclipsé. Au XVII I e, il entre dans l’usage courant ; le<br />
dictionnaire de Trévoux le définit en 1721, sous sa forme cosmopolitain. Il<br />
comporte alors deux nuances, dont la première est péjorative, un homme qui<br />
n’a pas de demeure fixe ; et la seconde élogieuse, un homme qui nulle part<br />
n’est étranger. Celle -ci l’emporte ; en 1755, J.-J. Rousse<strong>au</strong> parle <strong>des</strong> « gran<strong>des</strong><br />
âmes cosmopolites qui franchissent les barrières imaginaires qui séparent les<br />
peuples, et qui, à l’exemple de l’État Souverain qui les a créées, embrassent<br />
tout le genre humain dans leur bienveillance ». Le cosmopolite, du mépris<br />
ancien où on l’avait tenu parce qu’il n’avait pas de patrie, passe à l’estime où<br />
on le tient parce qu’il en a plusieurs.<br />
Nous ne sommes pas surpris, dès lors, de constater que l’aventure<br />
éternelle prit la couleur du temps. Il ne fut plus question d’aller conquérir le