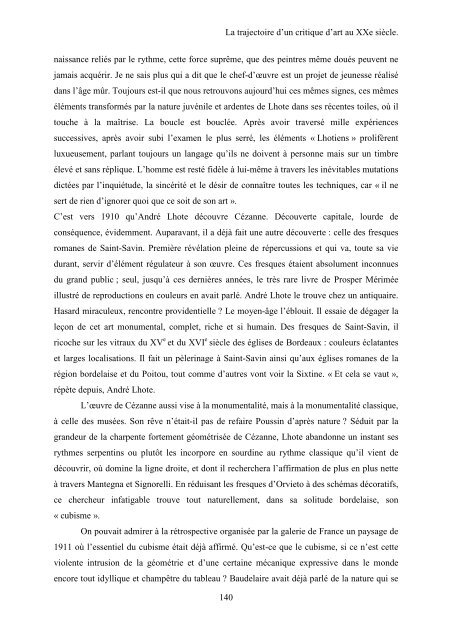anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
naissance reliés par le rythme, cette force suprême, que des peintres même doués peuvent ne<br />
jamais acquérir. Je ne sais plus qui a dit que le chef-d’œuvre est un projet de jeunesse réalisé<br />
dans l’âge mûr. Toujours est-il que nous retrouvons aujourd’hui ces mêmes signes, ces mêmes<br />
éléments transformés par la nature juvénile et ardentes de Lhote dans ses récentes toiles, où il<br />
touche à la maîtrise. La boucle est bouclée. Après avoir traversé mille expériences<br />
successives, après avoir subi l’examen le plus serré, les éléments « Lhotiens » prolifèrent<br />
luxueusement, parlant toujours un langage qu’ils ne doivent à personne mais sur un timbre<br />
élevé et sans réplique. L’homme est resté fidèle à lui-même à travers les inévitables mutations<br />
dictées par l’inquiétude, la sincérité et le désir de connaître toutes les techniques, car « il ne<br />
sert de rien d’ignorer quoi que ce soit de son art ».<br />
C’est vers 1910 qu’André Lhote découvre Cézanne. Découverte capitale, lourde de<br />
conséquence, évidemment. Auparavant, il a déjà fait une autre découverte : celle des fresques<br />
romanes de Saint-Savin. Première révélation pleine de répercussions et qui va, toute sa vie<br />
durant, servir d’élément régulateur à son œuvre. Ces fresques étaient absolument inconnues<br />
du grand public ; seul, jusqu’à ces dernières années, le très rare livre de Prosper Mérimée<br />
illustré de reproductions en couleurs en avait parlé. André Lhote le trouve chez un antiquaire.<br />
Hasard miraculeux, rencontre providentielle ? Le moyen-âge l’éblouit. Il essaie de dégager la<br />
leçon de cet art monumental, complet, riche et si humain. Des fresques de Saint-Savin, il<br />
ricoche sur les vitraux du XV e et du XVI e siècle des églises de Bordeaux : couleurs éclatantes<br />
et larges localisations. Il fait un pèlerinage à Saint-Savin ainsi qu’aux églises romanes de la<br />
région bordelaise et du Poitou, tout comme d’autres vont voir la Sixtine. « Et cela se vaut »,<br />
répète depuis, André Lhote.<br />
L’œuvre de Cézanne aussi vise à la monumentalité, mais à la monumentalité classique,<br />
à celle des musées. Son rêve n’était-il pas de refaire Poussin d’après nature ? Séduit par la<br />
grandeur de la charpente fortement géométrisée de Cézanne, Lhote abandonne un instant ses<br />
rythmes serpentins ou plutôt les incorpore en sourdine au rythme classique qu’il vient de<br />
découvrir, où domine la ligne droite, et dont il recherchera l’affirmation de plus en plus nette<br />
à travers Mantegna et Signorelli. En réduisant les fresques d’Orvieto à des schémas décoratifs,<br />
ce chercheur infatigable trouve tout naturellement, dans sa solitude bordelaise, son<br />
« cubisme ».<br />
On pouvait admirer à la rétrospective organisée par la galerie de France un paysage de<br />
1911 où l’essentiel du cubisme était déjà affirmé. Qu’est-ce que le cubisme, si ce n’est cette<br />
violente intrusion de la géométrie et d’une certaine mécanique expressive dans le monde<br />
encore tout idyllique et champêtre du tableau ? Baudelaire avait déjà parlé de la nature qui se<br />
140