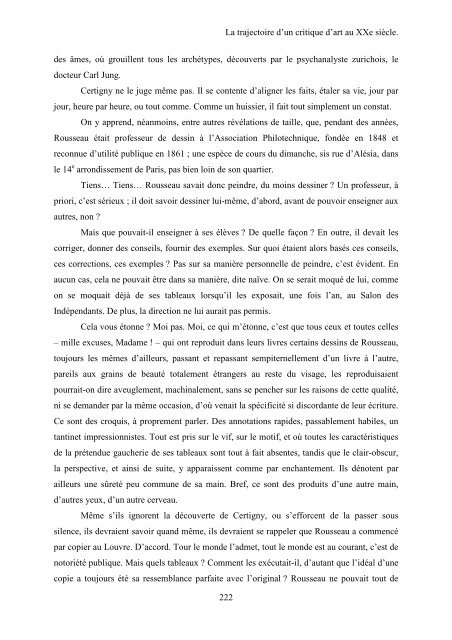anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
des âmes, où grouillent tous les archétypes, découverts par le psychanalyste zurichois, le<br />
docteur Carl Jung.<br />
Certigny ne le juge même pas. Il se contente d’aligner les faits, étaler sa vie, jour par<br />
jour, heure par heure, ou tout comme. Comme un huissier, il fait tout simplement un constat.<br />
On y apprend, néanmoins, entre autres révélations de taille, que, pendant des années,<br />
Rousseau était professeur de dessin à l’Association Philotechnique, fondée en 1848 et<br />
reconnue d’utilité publique en 1861 ; une espèce de cours du dimanche, sis rue d’Alésia, dans<br />
le 14 e arrondissement de Paris, pas bien loin de son quartier.<br />
Tiens… Tiens… Rousseau savait donc peindre, du moins dessiner ? Un professeur, à<br />
priori, c’est sérieux ; il doit savoir dessiner lui-même, d’abord, avant de pouvoir enseigner aux<br />
autres, non ?<br />
Mais que pouvait-il enseigner à ses élèves ? De quelle façon ? En outre, il devait les<br />
corriger, donner des conseils, fournir des exemples. Sur quoi étaient alors basés ces conseils,<br />
ces corrections, ces exemples ? Pas sur sa manière personnelle de peindre, c’est évident. En<br />
aucun cas, cela ne pouvait être dans sa manière, dite naïve. On se serait moqué de lui, comme<br />
on se moquait déjà de ses tableaux lorsqu’il les exposait, une fois l’an, au Salon des<br />
Indépendants. De plus, la direction ne lui aurait pas permis.<br />
Cela vous étonne ? Moi pas. Moi, ce qui m’étonne, c’est que tous ceux et toutes celles<br />
– mille excuses, Madame ! – qui ont reproduit dans leurs livres certains dessins de Rousseau,<br />
toujours les mêmes d’ailleurs, passant et repassant sempiternellement d’un livre à l’autre,<br />
pareils aux grains de beauté totalement étrangers au reste du visage, les reproduisaient<br />
pourrait-on dire aveuglement, machinalement, sans se pencher sur les raisons de cette qualité,<br />
ni se demander par la même occasion, d’où venait la spécificité si discordante de leur écriture.<br />
Ce sont des croquis, à proprement parler. Des annotations rapides, passablement habiles, un<br />
tantinet impressionnistes. Tout est pris sur le vif, sur le motif, et où toutes les caractéristiques<br />
de la prétendue gaucherie de ses tableaux sont tout à fait absentes, tandis que le clair-obscur,<br />
la perspective, et ainsi de suite, y apparaissent comme par enchantement. Ils dénotent par<br />
ailleurs une sûreté peu commune de sa main. Bref, ce sont des produits d’une autre main,<br />
d’autres yeux, d’un autre cerveau.<br />
Même s’ils ignorent la découverte de Certigny, ou s’efforcent de la passer sous<br />
silence, ils devraient savoir quand même, ils devraient se rappeler que Rousseau a commencé<br />
par copier au Louvre. D’accord. Tour le monde l’admet, tout le monde est au courant, c’est de<br />
notoriété publique. Mais quels tableaux ? Comment les exécutait-il, d’autant que l’idéal d’une<br />
copie a toujours été sa ressemblance parfaite avec l’original ? Rousseau ne pouvait tout de<br />
222