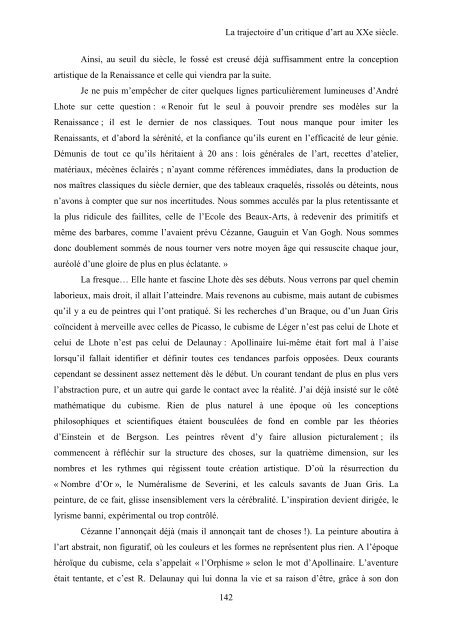anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
Ainsi, au seuil du siècle, le fossé est creusé déjà suffisamment entre la conception<br />
artistique de la Renaissance et celle qui viendra par la suite.<br />
Je ne puis m’empêcher de citer quelques lignes particulièrement lumineuses d’André<br />
Lhote sur cette question : « Renoir fut le seul à pouvoir prendre ses modèles sur la<br />
Renaissance ; il est le dernier de nos classiques. Tout nous manque pour imiter les<br />
Renaissants, et d’abord la sérénité, et la confiance qu’ils eurent en l’efficacité de leur génie.<br />
Démunis de tout ce qu’ils héritaient à 20 ans : lois générales de l’art, recettes d’atelier,<br />
matériaux, mécènes éclairés ; n’ayant comme références immédiates, dans la production de<br />
nos maîtres classiques du siècle dernier, que des tableaux craquelés, rissolés ou déteints, nous<br />
n’avons à compter que sur nos incertitudes. Nous sommes acculés par la plus retentissante et<br />
la plus ridicule des faillites, celle de l’Ecole des Beaux-Arts, à redevenir des primitifs et<br />
même des barbares, comme l’avaient prévu Cézanne, Gauguin et Van Gogh. Nous sommes<br />
donc doublement sommés de nous tourner vers notre moyen âge qui ressuscite chaque jour,<br />
auréolé d’une gloire de plus en plus éclatante. »<br />
La fresque… Elle hante et fascine Lhote dès ses débuts. Nous verrons par quel chemin<br />
laborieux, mais droit, il allait l’atteindre. Mais revenons au cubisme, mais autant de cubismes<br />
qu’il y a eu de peintres qui l’ont pratiqué. Si les recherches d’un Braque, ou d’un Juan Gris<br />
coïncident à merveille avec celles de Picasso, le cubisme de Léger n’est pas celui de Lhote et<br />
celui de Lhote n’est pas celui de Delaunay : Apollinaire lui-même était fort mal à l’aise<br />
lorsqu’il fallait identifier et définir toutes ces tendances parfois opposées. Deux courants<br />
cependant se dessinent assez nettement dès le début. Un courant tendant de plus en plus vers<br />
l’abstraction pure, et un autre qui garde le contact avec la réalité. J’ai déjà insisté sur le côté<br />
mathématique du cubisme. Rien de plus naturel à une époque où les conceptions<br />
philosophiques et scientifiques étaient bousculées de fond en comble par les théories<br />
d’Einstein et de Bergson. Les peintres rêvent d’y faire allusion picturalement ; ils<br />
commencent à réfléchir sur la structure des choses, sur la quatrième dimension, sur les<br />
nombres et les rythmes qui régissent toute création artistique. D’où la résurrection du<br />
« Nombre d’Or », le Numéralisme de Severini, et les calculs savants de Juan Gris. La<br />
peinture, de ce fait, glisse insensiblement vers la cérébralité. L’inspiration devient dirigée, le<br />
lyrisme banni, expérimental ou trop contrôlé.<br />
Cézanne l’annonçait déjà (mais il annonçait tant de choses !). La peinture aboutira à<br />
l’art abstrait, non figuratif, où les couleurs et les formes ne représentent plus rien. A l’époque<br />
héroïque du cubisme, cela s’appelait « l’Orphisme » selon le mot d’Apollinaire. L’aventure<br />
était tentante, et c’est R. Delaunay qui lui donna la vie et sa raison d’être, grâce à son don<br />
142