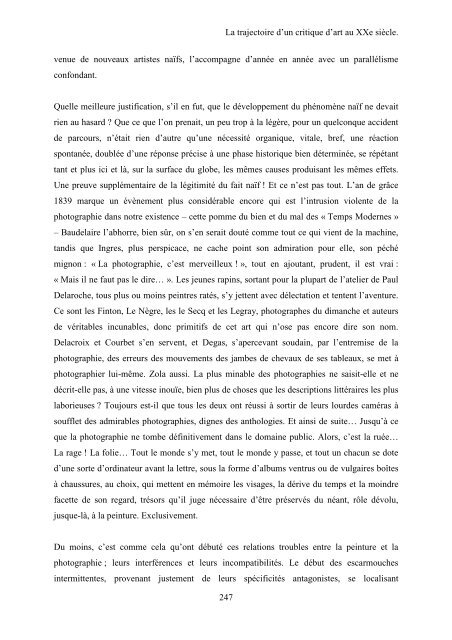anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
venue de nouveaux artistes naïfs, l’accompagne d’année en année avec un parallélisme<br />
confondant.<br />
Quelle meilleure justification, s’il en fut, que le développement du phénomène naïf ne devait<br />
rien au hasard ? Que ce que l’on prenait, un peu trop à la légère, pour un quelconque accident<br />
de parcours, n’était rien d’autre qu’une nécessité organique, vitale, bref, une réaction<br />
spontanée, doublée d’une réponse précise à une phase historique bien déterminée, se répétant<br />
tant et plus ici et là, sur la surface du globe, les mêmes causes produisant les mêmes effets.<br />
Une preuve supplémentaire de la légitimité du fait naïf ! Et ce n’est pas tout. L’an de grâce<br />
1839 marque un évènement plus considérable encore qui est l’intrusion violente de la<br />
photographie dans notre existence – cette pomme du bien et du mal des « Temps Modernes »<br />
– Baudelaire l’abhorre, bien sûr, on s’en serait douté comme tout ce qui vient de la machine,<br />
tandis que Ingres, plus perspicace, ne cache point son admiration pour elle, son péché<br />
mignon : « La photographie, c’est merveilleux ! », tout en ajoutant, prudent, il est vrai :<br />
« Mais il ne faut pas le dire… ». Les jeunes rapins, sortant pour la plupart de l’atelier de Paul<br />
Delaroche, tous plus ou moins peintres ratés, s’y jettent avec délectation et tentent l’aventure.<br />
Ce sont les Finton, Le Nègre, les le Secq et les Legray, photographes du dimanche et auteurs<br />
de véritables incunables, donc primitifs de cet art qui n’ose pas encore dire son nom.<br />
Delacroix et Courbet s’en servent, et Degas, s’apercevant soudain, par l’entremise de la<br />
photographie, des erreurs des mouvements des jambes de chevaux de ses tableaux, se met à<br />
photographier lui-même. Zola aussi. La plus minable des photographies ne saisit-elle et ne<br />
décrit-elle pas, à une vitesse inouïe, bien plus de choses que les descriptions littéraires les plus<br />
laborieuses ? Toujours est-il que tous les deux ont réussi à sortir de leurs lourdes caméras à<br />
soufflet des admirables photographies, dignes des anthologies. Et ainsi de suite… Jusqu’à ce<br />
que la photographie ne tombe définitivement dans le domaine public. Alors, c’est la ruée…<br />
La rage ! La folie… Tout le monde s’y met, tout le monde y passe, et tout un chacun se dote<br />
d’une sorte d’ordinateur avant la lettre, sous la forme d’albums ventrus ou de vulgaires boîtes<br />
à chaussures, au choix, qui mettent en mémoire les visages, la dérive du temps et la moindre<br />
facette de son regard, trésors qu’il juge nécessaire d’être préservés du néant, rôle dévolu,<br />
jusque-là, à la peinture. Exclusivement.<br />
Du moins, c’est comme cela qu’ont débuté ces relations troubles entre la peinture et la<br />
photographie ; leurs interférences et leurs incompatibilités. Le début des escarmouches<br />
intermittentes, provenant justement de leurs spécificités antagonistes, se localisant<br />
247