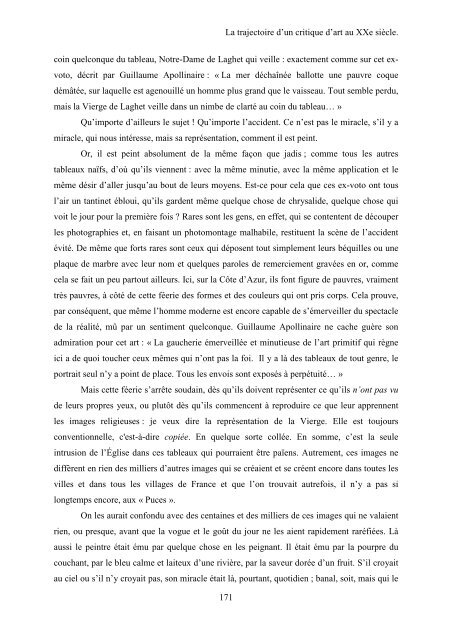anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
coin quelconque du tableau, Notre-Dame de Laghet qui veille : exactement comme sur cet exvoto,<br />
décrit par Guillaume Apollinaire : « La mer déchaînée ballotte une pauvre coque<br />
démâtée, sur laquelle est agenouillé un homme plus grand que le vaisseau. Tout semble perdu,<br />
mais la Vierge de Laghet veille dans un nimbe de clarté au coin du tableau… »<br />
Qu’importe d’ailleurs le sujet ! Qu’importe l’accident. Ce n’est pas le miracle, s’il y a<br />
miracle, qui nous intéresse, mais sa représentation, comment il est peint.<br />
Or, il est peint absolument de la même façon que jadis ; comme tous les autres<br />
tableaux naïfs, d’où qu’ils viennent : avec la même minutie, avec la même application et le<br />
même désir d’aller jusqu’au bout de leurs moyens. Est-ce pour cela que ces ex-voto ont tous<br />
l’air un tantinet ébloui, qu’ils gardent même quelque chose de chrysalide, quelque chose qui<br />
voit le jour pour la première fois ? Rares sont les gens, en effet, qui se contentent de découper<br />
les photographies et, en faisant un photomontage malhabile, restituent la scène de l’accident<br />
évité. De même que forts rares sont ceux qui déposent tout simplement leurs béquilles ou une<br />
plaque de marbre avec leur nom et quelques paroles de remerciement gravées en or, comme<br />
cela se fait un peu partout ailleurs. Ici, sur la Côte d’Azur, ils font figure de pauvres, vraiment<br />
très pauvres, à côté de cette féerie des formes et des couleurs qui ont pris corps. Cela prouve,<br />
par conséquent, que même l’homme moderne est encore capable de s’émerveiller du spectacle<br />
de la réalité, mû par un sentiment quelconque. Guillaume Apollinaire ne cache guère son<br />
admiration pour cet art : « La gaucherie émerveillée et minutieuse de l’art primitif qui règne<br />
ici a de quoi toucher ceux mêmes qui n’ont pas la foi. Il y a là des tableaux de tout genre, le<br />
portrait seul n’y a point de place. Tous les envois sont exposés à perpétuité… »<br />
Mais cette féerie s’arrête soudain, dès qu’ils doivent représenter ce qu’ils n’ont pas vu<br />
de leurs propres yeux, ou plutôt dès qu’ils commencent à reproduire ce que leur apprennent<br />
les images religieuses : je veux dire la représentation de la Vierge. Elle est toujours<br />
conventionnelle, c'est-à-dire copiée. En quelque sorte collée. En somme, c’est la seule<br />
intrusion de l’Église dans ces tableaux qui pourraient être païens. Autrement, ces images ne<br />
diffèrent en rien des milliers d’autres images qui se créaient et se créent encore dans toutes les<br />
villes et dans tous les villages de France et que l’on trouvait autrefois, il n’y a pas si<br />
longtemps encore, aux « Puces ».<br />
On les aurait confondu avec des centaines et des milliers de ces images qui ne valaient<br />
rien, ou presque, avant que la vogue et le goût du jour ne les aient rapidement raréfiées. Là<br />
aussi le peintre était ému par quelque chose en les peignant. Il était ému par la pourpre du<br />
couchant, par le bleu calme et laiteux d’une rivière, par la saveur dorée d’un fruit. S’il croyait<br />
au ciel ou s’il n’y croyait pas, son miracle était là, pourtant, quotidien ; banal, soit, mais qui le<br />
171