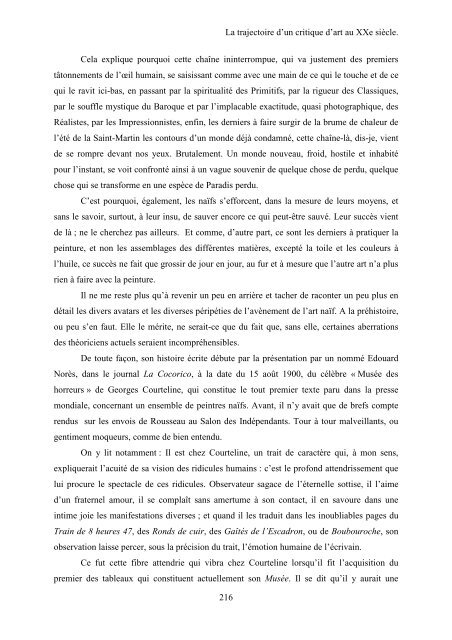anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
Cela explique pourquoi cette chaîne ininterrompue, qui va justement des premiers<br />
tâtonnements de l’œil humain, se saisissant comme avec une main de ce qui le touche et de ce<br />
qui le ravit ici-bas, en passant par la spiritualité des Primitifs, par la rigueur des Classiques,<br />
par le souffle mystique du Baroque et par l’implacable exactitude, quasi photographique, des<br />
Réalistes, par les Impressionnistes, enfin, les derniers à faire surgir de la brume de chaleur de<br />
l’été de la Saint-Martin les contours d’un monde déjà condamné, cette chaîne-là, dis-je, vient<br />
de se rompre devant nos yeux. Brutalement. Un monde nouveau, froid, hostile et inhabité<br />
pour l’instant, se voit confronté ainsi à un vague souvenir de quelque chose de perdu, quelque<br />
chose qui se transforme en une espèce de Paradis perdu.<br />
C’est pourquoi, également, les naïfs s’efforcent, dans la mesure de leurs moyens, et<br />
sans le savoir, surtout, à leur insu, de sauver encore ce qui peut-être sauvé. Leur succès vient<br />
de là ; ne le cherchez pas ailleurs. Et comme, d’autre part, ce sont les derniers à pratiquer la<br />
peinture, et non les assemblages des différentes matières, excepté la toile et les couleurs à<br />
l’huile, ce succès ne fait que grossir de jour en jour, au fur et à mesure que l’autre art n’a plus<br />
rien à faire avec la peinture.<br />
Il ne me reste plus qu’à revenir un peu en arrière et tacher de raconter un peu plus en<br />
détail les divers avatars et les diverses péripéties de l’avènement de l’art naïf. A la préhistoire,<br />
ou peu s’en faut. Elle le mérite, ne serait-ce que du fait que, sans elle, certaines aberrations<br />
des théoriciens actuels seraient incompréhensibles.<br />
De toute façon, son histoire écrite débute par la présentation par un nommé Edouard<br />
Norès, dans le journal La Cocorico, à la date du 15 août 1900, du célèbre « Musée des<br />
horreurs » de Georges Courteline, qui constitue le tout premier texte paru dans la presse<br />
mondiale, concernant un ensemble de peintres naïfs. Avant, il n’y avait que de brefs compte<br />
rendus sur les envois de Rousseau au Salon des Indépendants. Tour à tour malveillants, ou<br />
gentiment moqueurs, comme de bien entendu.<br />
On y lit notamment : Il est chez Courteline, un trait de caractère qui, à mon sens,<br />
expliquerait l’acuité de sa vision des ridicules humains : c’est le profond attendrissement que<br />
lui procure le spectacle de ces ridicules. Observateur sagace de l’éternelle sottise, il l’aime<br />
d’un fraternel amour, il se complaît sans amertume à son contact, il en savoure dans une<br />
intime joie les manifestations diverses ; et quand il les traduit dans les inoubliables pages du<br />
Train de 8 heures 47, des Ronds de cuir, des Gaîtés de l’Escadron, ou de Boubouroche, son<br />
observation laisse percer, sous la précision du trait, l’émotion humaine de l’écrivain.<br />
Ce fut cette fibre attendrie qui vibra chez Courteline lorsqu’il fit l’acquisition du<br />
premier des tableaux qui constituent actuellement son Musée. Il se dit qu’il y aurait une<br />
216