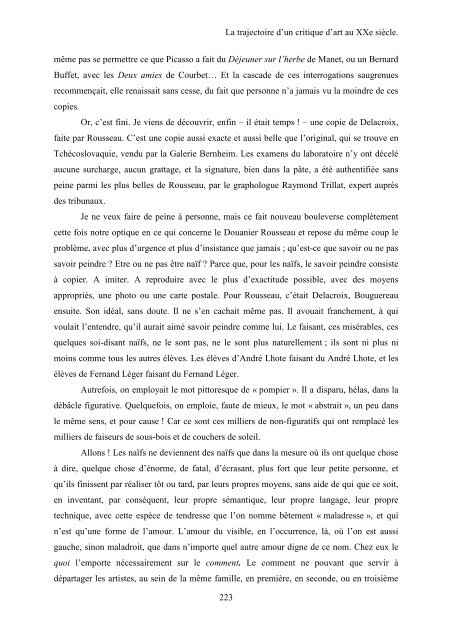anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
anatole jakovsky (1907/1909 ? â 1983) - Bibliothèque Kandinsky
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La trajectoire d’un critique d’art au XXe siècle.<br />
même pas se permettre ce que Picasso a fait du Déjeuner sur l’herbe de Manet, ou un Bernard<br />
Buffet, avec les Deux amies de Courbet… Et la cascade de ces interrogations saugrenues<br />
recommençait, elle renaissait sans cesse, du fait que personne n’a jamais vu la moindre de ces<br />
copies.<br />
Or, c’est fini. Je viens de découvrir, enfin – il était temps ! – une copie de Delacroix,<br />
faite par Rousseau. C’est une copie aussi exacte et aussi belle que l’original, qui se trouve en<br />
Tchécoslovaquie, vendu par la Galerie Bernheim. Les examens du laboratoire n’y ont décelé<br />
aucune surcharge, aucun grattage, et la signature, bien dans la pâte, a été authentifiée sans<br />
peine parmi les plus belles de Rousseau, par le graphologue Raymond Trillat, expert auprès<br />
des tribunaux.<br />
Je ne veux faire de peine à personne, mais ce fait nouveau bouleverse complètement<br />
cette fois notre optique en ce qui concerne le Douanier Rousseau et repose du même coup le<br />
problème, avec plus d’urgence et plus d’insistance que jamais ; qu’est-ce que savoir ou ne pas<br />
savoir peindre ? Etre ou ne pas être naïf ? Parce que, pour les naïfs, le savoir peindre consiste<br />
à copier. A imiter. A reproduire avec le plus d’exactitude possible, avec des moyens<br />
appropriés, une photo ou une carte postale. Pour Rousseau, c’était Delacroix, Bouguereau<br />
ensuite. Son idéal, sans doute. Il ne s’en cachait même pas. Il avouait franchement, à qui<br />
voulait l’entendre, qu’il aurait aimé savoir peindre comme lui. Le faisant, ces misérables, ces<br />
quelques soi-disant naïfs, ne le sont pas, ne le sont plus naturellement ; ils sont ni plus ni<br />
moins comme tous les autres élèves. Les élèves d’André Lhote faisant du André Lhote, et les<br />
élèves de Fernand Léger faisant du Fernand Léger.<br />
Autrefois, on employait le mot pittoresque de « pompier ». Il a disparu, hélas, dans la<br />
débâcle figurative. Quelquefois, on emploie, faute de mieux, le mot « abstrait », un peu dans<br />
le même sens, et pour cause ! Car ce sont ces milliers de non-figuratifs qui ont remplacé les<br />
milliers de faiseurs de sous-bois et de couchers de soleil.<br />
Allons ! Les naïfs ne deviennent des naïfs que dans la mesure où ils ont quelque chose<br />
à dire, quelque chose d’énorme, de fatal, d’écrasant, plus fort que leur petite personne, et<br />
qu’ils finissent par réaliser tôt ou tard, par leurs propres moyens, sans aide de qui que ce soit,<br />
en inventant, par conséquent, leur propre sémantique, leur propre langage, leur propre<br />
technique, avec cette espèce de tendresse que l’on nomme bêtement « maladresse », et qui<br />
n’est qu’une forme de l’amour. L’amour du visible, en l’occurrence, là, où l’on est aussi<br />
gauche, sinon maladroit, que dans n’importe quel autre amour digne de ce nom. Chez eux le<br />
quoi l’emporte nécessairement sur le comment. Le comment ne pouvant que servir à<br />
départager les artistes, au sein de la même famille, en première, en seconde, ou en troisième<br />
223