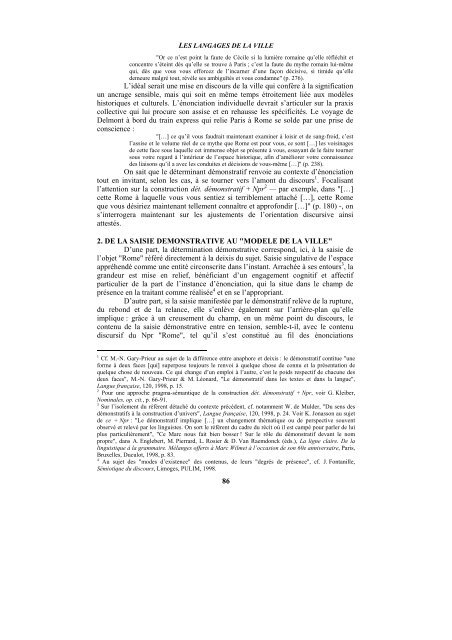Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
"Or ce n’est point la faute de Cécile si la lumière romaine qu’elle réfléchit et<br />
concentre s’éteint dès qu’elle se trouve à Paris ; c’est la faute du mythe romain lui-même<br />
qui, dès que vous vous efforcez de l’incarner d’une façon décisive, si timide qu’elle<br />
demeure malgré tout, révèle ses ambiguïtés et vous condamne" (p. 276).<br />
L’idéal serait une mise en discours de la ville qui confère à la signification<br />
un ancrage sensible, mais qui soit en même temps étroitement liée aux modèles<br />
historiques et culturels. L’énonciation individuelle devrait s’articuler sur la praxis<br />
collective qui lui procure son assise et en rehausse les spécificités. Le voyage de<br />
Delmont à bord du train express qui relie Paris à Rome se solde par une prise de<br />
conscience :<br />
"[…] ce qu’il vous faudrait maintenant examiner à loisir et de sang-froid, c’est<br />
l’assise et le volume réel de ce mythe que Rome est pour vous, ce sont […] les voisinages<br />
de cette face sous laquelle cet immense objet se présente à vous, essayant de le faire tourner<br />
sous votre regard à l’intérieur de l’espace historique, afin d’améliorer votre connaissance<br />
des liaisons qu’il a avec les conduites et décisions de vous-même […]" (p. 238).<br />
On sait que le déterminant démonstratif renvoie au contexte d’énonciation<br />
tout en invitant, selon les cas, à se tourner vers l’amont du discours 1 . Focalisant<br />
l’attention sur la construction dét. démonstratif + Npr 2 — par exemple, dans "[…]<br />
cette Rome à laquelle vous vous sentiez si terriblement attaché […], cette Rome<br />
que vous désiriez maintenant tellement connaître et approfondir […]" (p. 180) -, on<br />
s’interrogera maintenant sur les ajustements de l’orientation discursive ainsi<br />
attestés.<br />
2. DE LA SAISIE DEMONSTRATIVE AU "MODELE DE LA VILLE"<br />
D’une part, la détermination démonstrative correspond, ici, à la saisie de<br />
l’objet "Rome" référé directement à la deixis du sujet. Saisie singulative de l’espace<br />
appréhendé comme une entité circonscrite dans l’instant. Arrachée à ses entours 3 , la<br />
grandeur est mise en relief, bénéficiant d’un engagement cognitif et affectif<br />
particulier de la part de l’instance d’énonciation, qui la situe dans le champ de<br />
présence en la traitant comme réalisée 4 et en se l’appropriant.<br />
D’autre part, si la saisie manifestée par le démonstratif relève de la rupture,<br />
du rebond et de la relance, elle s’enlève également sur l’arrière-plan qu’elle<br />
implique : grâce à un creusement du champ, en un même point du discours, le<br />
contenu de la saisie démonstrative entre en tension, semble-t-il, avec le contenu<br />
discursif du Npr "Rome", tel qu’il s’est constitué au fil des énonciations<br />
1 Cf. M.-N. Gary-Prieur au sujet de la différence entre anaphore et deixis : le démonstratif contitue "une<br />
forme à deux faces [qui] superpose toujours le renvoi à quelque chose de connu et la présentation de<br />
quelque chose de nouveau. Ce qui change d’un emploi à l’autre, c’est le poids respectif de chacune des<br />
deux faces", M.-N. Gary-Prieur & M. Léonard, "Le démonstratif dans les textes et dans la langue",<br />
Langue française, 120, 1998, p. 15.<br />
2 Pour une approche pragma-sémantique de la construction dét. démonstratif + Npr, voir G. Kleiber,<br />
Nominales, op. cit., p. 66-91.<br />
3 Sur l’isolement du référent détaché du contexte précédent, cf. notamment W. de Mulder, "Du sens des<br />
démonstratifs à la construction d’univers", Langue française, 120, 1998, p. 24. Voir K. Jonasson au sujet<br />
de ce + Npr : "Le démonstratif implique […] un changement thématique ou de perspective souvent<br />
observé et relevé par les linguistes. On sort le référent du cadre du récit où il est campé pour parler de lui<br />
plus particulièrement", "Ce Marc nous fait bien bosser ! Sur le rôle du démonstratif devant le nom<br />
propre", dans A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier & D. Van Raemdonck (éds.), La ligne claire. De la<br />
linguistique à la grammaire. Mélanges offerts à Marc Wilmet à l’occasion de son 60e anniversaire, Paris,<br />
Bruxelles, Duculot, 1998, p. 83.<br />
4 Au sujet des "modes d’existence" des contenus, de leurs "degrés de présence", cf. J. Fontanille,<br />
Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, 1998.<br />
86