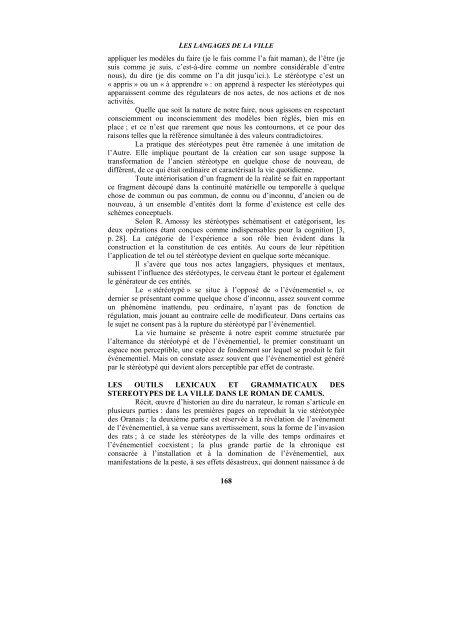Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
appliquer les modèles du faire (je le fais comme l’a fait maman), de l’être (je<br />
suis comme je suis, c’est-à-dire comme un nombre considérable d’entre<br />
nous), du dire (je dis comme on l’a dit jusqu’ici.). Le stéréotype c’est un<br />
« appris » ou un « à apprendre » : on apprend à respecter les stéréotypes qui<br />
apparaissent comme des régulateurs de nos actes, de nos actions et de nos<br />
activités.<br />
Quelle que soit la nature de notre faire, nous agissons en respectant<br />
consciemment ou inconsciemment des modèles bien réglés, bien mis en<br />
place ; et ce n’est que rarement que nous les contournons, et ce pour des<br />
raisons telles que la référence simultanée à des valeurs contradictoires.<br />
La pratique des stéréotypes peut être ramenée à une imitation de<br />
l’Autre. Elle implique pourtant de la création car son usage suppose la<br />
transformation de l’ancien stéréotype en quelque chose de nouveau, de<br />
différent, de ce qui était ordinaire et caractérisait la vie quotidienne.<br />
Toute intériorisation d’un fragment de la réalité se fait en rapportant<br />
ce fragment découpé dans la continuité matérielle ou temporelle à quelque<br />
chose de commun ou pas commun, de connu ou d’inconnu, d’ancien ou de<br />
nouveau, à un ensemble d’entités dont la forme d’existence est celle des<br />
schèmes conceptuels.<br />
Selon R. Amossy les stéréotypes schématisent et catégorisent, les<br />
deux opérations étant conçues comme indispensables pour la cognition [3,<br />
p. 28]. La catégorie de l’expérience a son rôle bien évident dans la<br />
construction et la constitution de ces entités. Au cours de leur répétition<br />
l’application de tel ou tel stéréotype devient en quelque sorte mécanique.<br />
Il s’avère que tous nos actes langagiers, physiques et mentaux,<br />
subissent l’influence des stéréotypes, le cerveau étant le porteur et également<br />
le générateur de ces entités.<br />
Le « stéréotypé » se situe à l’opposé de « l’événementiel », ce<br />
dernier se présentant comme quelque chose d’inconnu, assez souvent comme<br />
un phénomène inattendu, peu ordinaire, n’ayant pas de fonction de<br />
régulation, mais jouant au contraire celle de modificateur. Dans certains cas<br />
le sujet ne consent pas à la rupture du stéréotypé par l’événementiel.<br />
La vie humaine se présente à notre esprit comme structurée par<br />
l’alternance du stéréotypé et de l’événementiel, le premier constituant un<br />
espace non perceptible, une espèce de fondement sur lequel se produit le fait<br />
événementiel. Mais on constate assez souvent que l’événementiel est généré<br />
par le stéréotypé qui devient alors perceptible par effet de contraste.<br />
LES OUTILS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX DES<br />
STEREOTYPES DE LA VILLE DANS LE ROMAN DE CAMUS.<br />
Récit, œuvre d’historien au dire du narrateur, le roman s’articule en<br />
plusieurs parties : dans les premières pages on reproduit la vie stéréotypée<br />
des Oranais ; la deuxième partie est réservée à la révélation de l’avènement<br />
de l’événementiel, à sa venue sans avertissement, sous la forme de l’invasion<br />
des rats ; à ce stade les stéréotypes de la ville des temps ordinaires et<br />
l’événementiel coexistent ; la plus grande partie de la chronique est<br />
consacrée à l’installation et à la domination de l’événementiel, aux<br />
manifestations de la peste, à ses effets désastreux, qui donnent naissance à de<br />
168