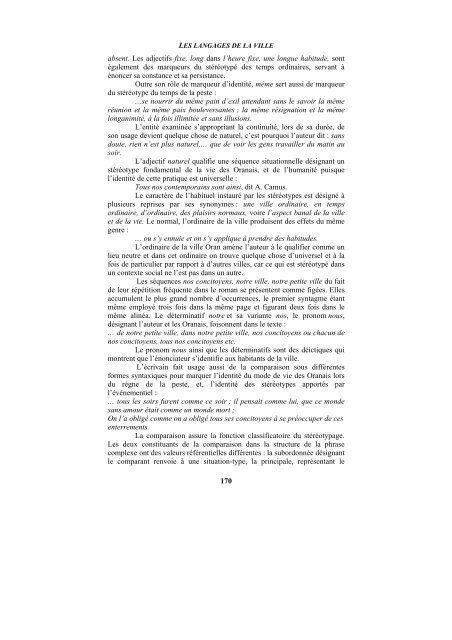Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
absent. Les adjectifs fixe, long dans l’heure fixe, une longue habitude, sont<br />
également des marqueurs du stéréotypé des temps ordinaires, servant à<br />
énoncer sa constance et sa persistance.<br />
Outre son rôle de marqueur d’identité, même sert aussi de marqueur<br />
du stéréotype du temps de la peste :<br />
…se nourrir du même pain d’exil attendant sans le savoir la même<br />
réunion et la même paix bouleversantes ; la même résignation et la même<br />
longanimité, à la fois illimitée et sans illusions.<br />
L’entité examinée s’appropriant la continuité, lors de sa durée, de<br />
son usage devient quelque chose de naturel, c’est pourquoi l’auteur dit : sans<br />
doute, rien n’est plus naturel,… que de voir les gens travailler du matin au<br />
soir.<br />
L’adjectif naturel qualifie une séquence situationnelle désignant un<br />
stéréotype fondamental de la vie des Oranais, et de l’humanité puisque<br />
l’identité de cette pratique est universelle :<br />
Tous nos contemporains sont ainsi, dit A. Camus.<br />
Le caractère de l’habituel instauré par les stéréotypes est désigné à<br />
plusieurs reprises par ses synonymes : une ville ordinaire, en temps<br />
ordinaire, d’ordinaire, des plaisirs normaux, voire l’aspect banal de la ville<br />
et de la vie. Le normal, l’ordinaire de la ville produisent des effets du même<br />
genre :<br />
… ou s’y ennuie et on s’y applique à prendre des habitudes.<br />
L’ordinaire de la ville Oran amène l’auteur à le qualifier comme un<br />
lieu neutre et dans cet ordinaire on trouve quelque chose d’universel et à la<br />
fois de particulier par rapport à d’autres villes, car ce qui est stéréotypé dans<br />
un contexte social ne l’est pas dans un autre.<br />
Les séquences nos concitoyens, notre ville, notre petite ville du fait<br />
de leur répétition fréquente dans le roman se présentent comme figées. Elles<br />
accumulent le plus grand nombre d’occurrences, le premier syntagme étant<br />
même employé trois fois dans la même page et figurant deux fois dans le<br />
même alinéa. Le déterminatif notre et sa variante nos, le pronom nous,<br />
désignant l’auteur et les Oranais, foisonnent dans le texte :<br />
… de notre petite ville, dans notre petite ville, nos concitoyens ou chacun de<br />
nos concitoyens, tous nos concitoyens etc.<br />
Le pronom nous ainsi que les déterminatifs sont des déictiques qui<br />
montrent que l’énonciateur s’identifie aux habitants de la ville.<br />
L’écrivain fait usage aussi de la comparaison sous différentes<br />
formes syntaxiques pour marquer l’identité du mode de vie des Oranais lors<br />
du règne de la peste, et, l’identité des stéréotypes apportés par<br />
l’événementiel :<br />
… tous les soirs furent comme ce soir ; il pensait comme lui, que ce monde<br />
sans amour était comme un monde mort ;<br />
On l’a obligé comme on a obligé tous ses concitoyens à se préoccuper de ces<br />
enterrements.<br />
La comparaison assure la fonction classificatoire du stéréotypage.<br />
Les deux constituants de la comparaison dans la structure de la phrase<br />
complexe ont des valeurs référentielles différentes : la subordonnée désignant<br />
le comparant renvoie à une situation-type, la principale, représentant le<br />
170