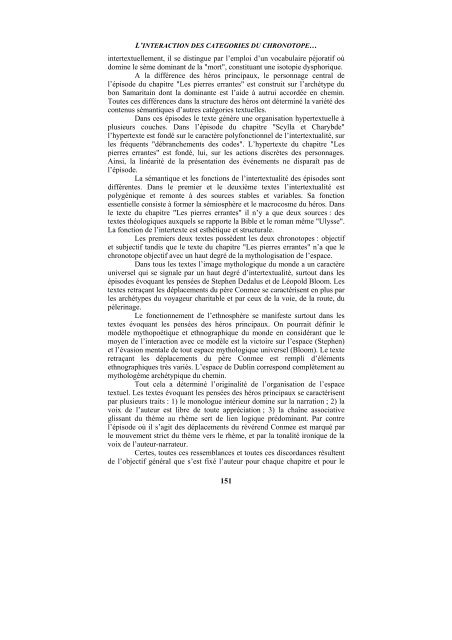You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’INTERACTION DES CATEGORIES DU CHRONOTOPE…<br />
intertextuellement, il se distingue par l’emploi d’un vocabulaire péjoratif où<br />
domine le sème dominant de la "mort", constituant une isotopie dysphorique.<br />
A la différence des héros principaux, le personnage central de<br />
l’épisode du chapitre "Les pierres errantes" est construit sur l’archétype du<br />
bon Samaritain dont la dominante est l’aide à autrui accordée en chemin.<br />
Toutes ces différences dans la structure des héros ont déterminé la variété des<br />
contenus sémantiques d’autres catégories textuelles.<br />
Dans ces épisodes le texte génère une organisation hypertextuelle à<br />
plusieurs couches. Dans l’épisode du chapitre "Scylla et Charybde"<br />
l’hypertexte est fondé sur le caractère polyfonctionnel de l’intertextualité, sur<br />
les fréquents "débranchements des codes". L’hypertexte du chapitre "Les<br />
pierres errantes" est fondé, lui, sur les actions discrètes des personnages.<br />
Ainsi, la linéarité de la présentation des événements ne disparaît pas de<br />
l’épisode.<br />
La sémantique et les fonctions de l’intertextualité des épisodes sont<br />
différentes. Dans le premier et le deuxième textes l’intertextualité est<br />
polygénique et remonte à des sources stables et variables. Sa fonction<br />
essentielle consiste à former la sémiosphère et le macrocosme du héros. Dans<br />
le texte du chapitre "Les pierres errantes" il n’y a que deux sources : des<br />
textes théologiques auxquels se rapporte la Bible et le roman même "Ulysse".<br />
La fonction de l’intertexte est esthétique et structurale.<br />
Les premiers deux textes possèdent les deux chronotopes : objectif<br />
et subjectif tandis que le texte du chapitre "Les pierres errantes" n’a que le<br />
chronotope objectif avec un haut degré de la mythologisation de l’espace.<br />
Dans tous les textes l’image mythologique du monde a un caractère<br />
universel qui se signale par un haut degré d’intertextualité, surtout dans les<br />
épisodes évoquant les pensées de Stephen Dedalus et de Léopold Bloom. Les<br />
textes retraçant les déplacements du père Conmee se caractérisent en plus par<br />
les archétypes du voyageur charitable et par ceux de la voie, de la route, du<br />
pèlerinage.<br />
Le fonctionnement de l’ethnosphère se manifeste surtout dans les<br />
textes évoquant les pensées des héros principaux. On pourrait définir le<br />
modèle mythopoétique et ethnographique du monde en considérant que le<br />
moyen de l’interaction avec ce modèle est la victoire sur l’espace (Stephen)<br />
et l’évasion mentale de tout espace mythologique universel (Bloom). Le texte<br />
retraçant les déplacements du père Conmee est rempli d’éléments<br />
ethnographiques très variés. L’espace de Dublin correspond complètement au<br />
mythologème archétypique du chemin.<br />
Tout cela a déterminé l’originalité de l’organisation de l’espace<br />
textuel. Les textes évoquant les pensées des héros principaux se caractérisent<br />
par plusieurs traits : 1) le monologue intérieur domine sur la narration ; 2) la<br />
voix de l’auteur est libre de toute appréciation ; 3) la chaîne associative<br />
glissant du thème au rhème sert de lien logique prédominant. Par contre<br />
l’épisode où il s’agit des déplacements du révérend Conmee est marqué par<br />
le mouvement strict du thème vers le rhème, et par la tonalité ironique de la<br />
voix de l’auteur-narrateur.<br />
Certes, toutes ces ressemblances et toutes ces discordances résultent<br />
de l’objectif général que s’est fixé l’auteur pour chaque chapitre et pour le<br />
151