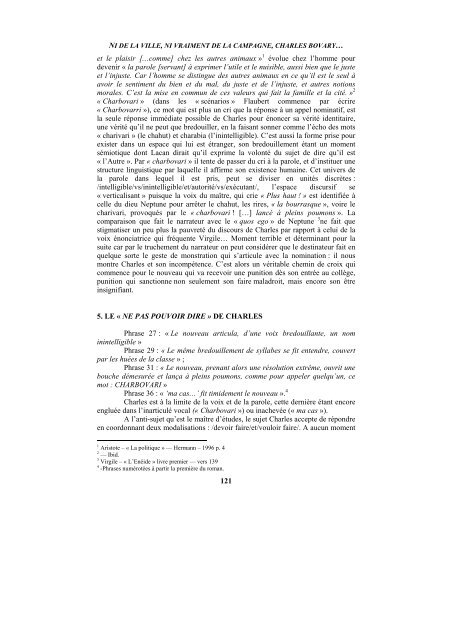You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA CAMPAGNE, CHARLES BOVARY…<br />
et le plaisir […comme] chez les autres animaux » 1 évolue chez l’homme pour<br />
devenir « la parole [servant] à exprimer l’utile et le nuisible, aussi bien que le juste<br />
et l’injuste. Car l’homme se distingue des autres animaux en ce qu’il est le seul à<br />
avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et autres notions<br />
morales. C’est la mise en commun de ces valeurs qui fait la famille et la cité. » 2<br />
« Charbovari » (dans les « scénarios » Flaubert commence par écrire<br />
« Charbovarri »), ce mot qui est plus un cri que la réponse à un appel nominatif, est<br />
la seule réponse immédiate possible de Charles pour énoncer sa vérité identitaire,<br />
une vérité qu’il ne peut que bredouiller, en la faisant sonner comme l’écho des mots<br />
« charivari » (le chahut) et charabia (l’inintelligible). C’est aussi la forme prise pour<br />
exister dans un espace qui lui est étranger, son bredouillement étant un moment<br />
sémiotique dont Lacan dirait qu’il exprime la volonté du sujet de dire qu’il est<br />
« l’Autre ». Par « charbovari » il tente de passer du cri à la parole, et d’instituer une<br />
structure linguistique par laquelle il affirme son existence humaine. Cet univers de<br />
la parole dans lequel il est pris, peut se diviser en unités discrètes :<br />
/intelligible/vs/inintelligible/et/autorité/vs/exécutant/, l’espace discursif se<br />
« verticalisant » puisque la voix du maître, qui crie « Plus haut ! » est identifiée à<br />
celle du dieu Neptune pour arrêter le chahut, les rires, « la bourrasque », voire le<br />
charivari, provoqués par le « charbovari ! […] lancé à pleins poumons ». La<br />
comparaison que fait le narrateur avec le « quos ego » de Neptune 3 ne fait que<br />
stigmatiser un peu plus la pauvreté du discours de Charles par rapport à celui de la<br />
voix énonciatrice qui fréquente Virgile… Moment terrible et déterminant pour la<br />
suite car par le truchement du narrateur on peut considérer que le destinateur fait en<br />
quelque sorte le geste de monstration qui s’articule avec la nomination : il nous<br />
montre Charles et son incompétence. C’est alors un véritable chemin de croix qui<br />
commence pour le nouveau qui va recevoir une punition dès son entrée au collège,<br />
punition qui sanctionne non seulement son faire maladroit, mais encore son être<br />
insignifiant.<br />
5. LE « NE PAS POUVOIR DIRE » DE CHARLES<br />
Phrase 27 : « Le nouveau articula, d’une voix bredouillante, un nom<br />
inintelligible »<br />
Phrase 29 : « Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert<br />
par les huées de la classe » ;<br />
Phrase 31 : « Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une<br />
bouche démesurée et lança à pleins poumons, comme pour appeler quelqu’un, ce<br />
mot : CHARBOVARI »<br />
Phrase 36 : « ‘ma cas…’ fit timidement le nouveau ». 4<br />
Charles est à la limite de la voix et de la parole, cette dernière étant encore<br />
engluée dans l’inarticulé vocal (« Charbovari ») ou inachevée (« ma cas »).<br />
A l’anti-sujet qu’est le maître d’études, le sujet Charles accepte de répondre<br />
en coordonnant deux modalisations : /devoir faire/et/vouloir faire/. A aucun moment<br />
1 Aristote – « La politique » — Hermann – 1996 p. 4<br />
2 — Ibid.<br />
3 Virgile – « L’Enéide » livre premier — vers 139<br />
4 -Phrases numérotées à partir la première du roman.<br />
121