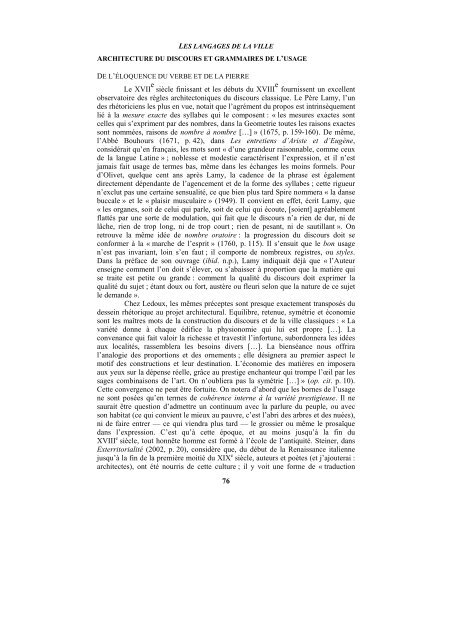Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
ARCHITECTURE DU DISCOURS ET GRAMMAIRES DE L’USAGE<br />
DE L’ÉLOQUENCE DU VERBE ET DE LA PIERRE<br />
Le XVII e siècle finissant et les débuts du XVIII e fournissent un excellent<br />
observatoire des règles architectoniques du discours classique. Le Père Lamy, l’un<br />
des rhétoriciens les plus en vue, notait que l’agrément du propos est intrinsèquement<br />
lié à la mesure exacte des syllabes qui le composent : « les mesures exactes sont<br />
celles qui s’expriment par des nombres, dans la Geometrie toutes les raisons exactes<br />
sont nommées, raisons de nombre à nombre […] » (1675, p. 159-160). De même,<br />
l’Abbé Bouhours (1671, p. 42), dans Les entretiens d’Ariste et d’Eugène,<br />
considérait qu’en français, les mots sont « d’une grandeur raisonnable, comme ceux<br />
de la langue Latine » ; noblesse et modestie caractérisent l’expression, et il n’est<br />
jamais fait usage de termes bas, même dans les échanges les moins formels. Pour<br />
d’Olivet, quelque cent ans après Lamy, la cadence de la phrase est également<br />
directement dépendante de l’agencement et de la forme des syllabes ; cette rigueur<br />
n’exclut pas une certaine sensualité, ce que bien plus tard Spire nommera « la danse<br />
buccale » et le « plaisir musculaire » (1949). Il convient en effet, écrit Lamy, que<br />
« les organes, soit de celui qui parle, soit de celui qui écoute, [soient] agréablement<br />
flattés par une sorte de modulation, qui fait que le discours n’a rien de dur, ni de<br />
lâche, rien de trop long, ni de trop court ; rien de pesant, ni de sautillant ». On<br />
retrouve la même idée de nombre oratoire : la progression du discours doit se<br />
conformer à la « marche de l’esprit » (1760, p. 115). Il s’ensuit que le bon usage<br />
n’est pas invariant, loin s’en faut ; il comporte de nombreux registres, ou styles.<br />
Dans la préface de son ouvrage (ibid. n.p.), Lamy indiquait déjà que « l’Auteur<br />
enseigne comment l’on doit s’élever, ou s’abaisser à proportion que la matière qui<br />
se traite est petite ou grande : comment la qualité du discours doit exprimer la<br />
qualité du sujet ; étant doux ou fort, austère ou fleuri selon que la nature de ce sujet<br />
le demande ».<br />
Chez Ledoux, les mêmes préceptes sont presque exactement transposés du<br />
dessein rhétorique au projet architectural. Equilibre, retenue, symétrie et économie<br />
sont les maîtres mots de la construction du discours et de la ville classiques : « La<br />
variété donne à chaque édifice la physionomie qui lui est propre […]. La<br />
convenance qui fait valoir la richesse et travestit l’infortune, subordonnera les idées<br />
aux localités, rassemblera les besoins divers […]. La bienséance nous offrira<br />
l’analogie des proportions et des ornements ; elle désignera au premier aspect le<br />
motif des constructions et leur destination. L’économie des matières en imposera<br />
aux yeux sur la dépense réelle, grâce au prestige enchanteur qui trompe l’œil par les<br />
sages combinaisons de l’art. On n’oubliera pas la symétrie […] » (op. cit. p. 10).<br />
Cette convergence ne peut être fortuite. On notera d’abord que les bornes de l’usage<br />
ne sont posées qu’en termes de cohérence interne à la variété prestigieuse. Il ne<br />
saurait être question d’admettre un continuum avec la parlure du peuple, ou avec<br />
son habitat (ce qui convient le mieux au pauvre, c’est l’abri des arbres et des nuées),<br />
ni de faire entrer — ce qui viendra plus tard — le grossier ou même le prosaïque<br />
dans l’expression. C’est qu’à cette époque, et au moins jusqu’à la fin du<br />
XVIII e siècle, tout honnête homme est formé à l’école de l’antiquité. Steiner, dans<br />
Exterritorialité (2002, p. 20), considère que, du début de la Renaissance italienne<br />
jusqu’à la fin de la première moitié du XIX e siècle, auteurs et poètes (et j’ajouterai :<br />
architectes), ont été nourris de cette culture ; il y voit une forme de « traduction<br />
76