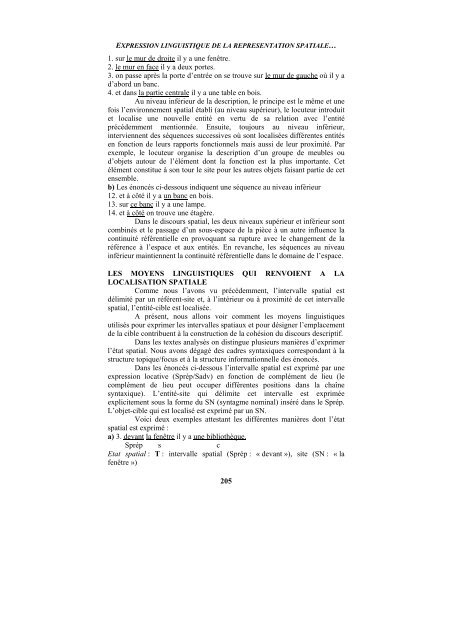Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
EXPRESSION LINGUISTIQUE DE LA REPRESENTATION SPATIALE…<br />
1. sur le mur de droite il y a une fenêtre.<br />
2. le mur en face il y a deux portes.<br />
3. on passe après la porte d’entrée on se trouve sur le mur de gauche où il y a<br />
d’abord un banc.<br />
4. et dans la partie centrale il y a une table en bois.<br />
Au niveau inférieur de la description, le principe est le même et une<br />
fois l’environnement spatial établi (au niveau supérieur), le locuteur introduit<br />
et localise une nouvelle entité en vertu de sa relation avec l’entité<br />
précédemment mentionnée. Ensuite, toujours au niveau inférieur,<br />
interviennent des séquences successives où sont localisées différentes entités<br />
en fonction de leurs rapports fonctionnels mais aussi de leur proximité. Par<br />
exemple, le locuteur organise la description d’un groupe de meubles ou<br />
d’objets autour de l’élément dont la fonction est la plus importante. Cet<br />
élément constitue à son tour le site pour les autres objets faisant partie de cet<br />
ensemble.<br />
b) Les énoncés ci-dessous indiquent une séquence au niveau inférieur<br />
12. et à côté il y a un banc en bois.<br />
13. sur ce banc il y a une lampe.<br />
14. et à côté on trouve une étagère.<br />
Dans le discours spatial, les deux niveaux supérieur et inférieur sont<br />
combinés et le passage d’un sous-espace de la pièce à un autre influence la<br />
continuité référentielle en provoquant sa rupture avec le changement de la<br />
référence à l’espace et aux entités. En revanche, les séquences au niveau<br />
inférieur maintiennent la continuité référentielle dans le domaine de l’espace.<br />
LES MOYENS LINGUISTIQUES QUI RENVOIENT A LA<br />
LOCALISATION SPATIALE<br />
Comme nous l’avons vu précédemment, l’intervalle spatial est<br />
délimité par un référent-site et, à l’intérieur ou à proximité de cet intervalle<br />
spatial, l’entité-cible est localisée.<br />
A présent, nous allons voir comment les moyens linguistiques<br />
utilisés pour exprimer les intervalles spatiaux et pour désigner l’emplacement<br />
de la cible contribuent à la construction de la cohésion du discours descriptif.<br />
Dans les textes analysés on distingue plusieurs manières d’exprimer<br />
l’état spatial. Nous avons dégagé des cadres syntaxiques correspondant à la<br />
structure topique/focus et à la structure informationnelle des énoncés.<br />
Dans les énoncés ci-dessous l’intervalle spatial est exprimé par une<br />
expression locative (Sprép/Sadv) en fonction de complément de lieu (le<br />
complément de lieu peut occuper différentes positions dans la chaîne<br />
syntaxique). L’entité-site qui délimite cet intervalle est exprimée<br />
explicitement sous la forme du SN (syntagme nominal) inséré dans le Sprép.<br />
L’objet-cible qui est localisé est exprimé par un SN.<br />
Voici deux exemples attestant les différentes manières dont l’état<br />
spatial est exprimé :<br />
a) 3. devant la fenêtre il y a une bibliothèque.<br />
Sprép s c<br />
Etat spatial : T : intervalle spatial (Sprép : « devant »), site (SN : « la<br />
fenêtre »)<br />
205