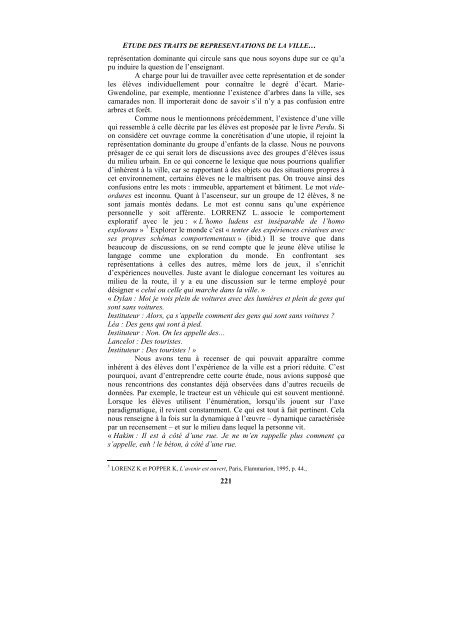Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ETUDE DES TRAITS DE REPRESENTATIONS DE LA VILLE…<br />
représentation dominante qui circule sans que nous soyons dupe sur ce qu’a<br />
pu induire la question de l’enseignant.<br />
A charge pour lui de travailler avec cette représentation et de sonder<br />
les élèves individuellement pour connaître le degré d’écart. Marie-<br />
Gwendoline, par exemple, mentionne l’existence d’arbres dans la ville, ses<br />
camarades non. Il importerait donc de savoir s’il n’y a pas confusion entre<br />
arbres et forêt.<br />
Comme nous le mentionnons précédemment, l’existence d’une ville<br />
qui ressemble à celle décrite par les élèves est proposée par le livre Perdu. Si<br />
on considère cet ouvrage comme la concrétisation d’une utopie, il rejoint la<br />
représentation dominante du groupe d’enfants de la classe. Nous ne pouvons<br />
présager de ce qui serait lors de discussions avec des groupes d’élèves issus<br />
du milieu urbain. En ce qui concerne le lexique que nous pourrions qualifier<br />
d’inhérent à la ville, car se rapportant à des objets ou des situations propres à<br />
cet environnement, certains élèves ne le maîtrisent pas. On trouve ainsi des<br />
confusions entre les mots : immeuble, appartement et bâtiment. Le mot videordures<br />
est inconnu. Quant à l’ascenseur, sur un groupe de 12 élèves, 8 ne<br />
sont jamais montés dedans. Le mot est connu sans qu’une expérience<br />
personnelle y soit afférente. LORRENZ L. associe le comportement<br />
exploratif avec le jeu : « L’homo ludens est inséparable de l’homo<br />
explorans » 1 Explorer le monde c’est « tenter des expériences créatives avec<br />
ses propres schémas comportementaux » (ibid.) Il se trouve que dans<br />
beaucoup de discussions, on se rend compte que le jeune élève utilise le<br />
langage comme une exploration du monde. En confrontant ses<br />
représentations à celles des autres, même lors de jeux, il s’enrichit<br />
d’expériences nouvelles. Juste avant le dialogue concernant les voitures au<br />
milieu de la route, il y a eu une discussion sur le terme employé pour<br />
désigner « celui ou celle qui marche dans la ville. »<br />
« Dylan : Moi je vois plein de voitures avec des lumières et plein de gens qui<br />
sont sans voitures.<br />
Instituteur : Alors, ça s’appelle comment des gens qui sont sans voitures ?<br />
Léa : Des gens qui sont à pied.<br />
Instituteur : Non. On les appelle des…<br />
Lancelot : Des touristes.<br />
Instituteur : Des touristes ! »<br />
Nous avons tenu à recenser de qui pouvait apparaître comme<br />
inhérent à des élèves dont l’expérience de la ville est a priori réduite. C’est<br />
pourquoi, avant d’entreprendre cette courte étude, nous avions supposé que<br />
nous rencontrions des constantes déjà observées dans d’autres recueils de<br />
données. Par exemple, le tracteur est un véhicule qui est souvent mentionné.<br />
Lorsque les élèves utilisent l’énumération, lorsqu’ils jouent sur l’axe<br />
paradigmatique, il revient constamment. Ce qui est tout à fait pertinent. Cela<br />
nous renseigne à la fois sur la dynamique à l’œuvre – dynamique caractérisée<br />
par un recensement – et sur le milieu dans lequel la personne vit.<br />
« Hakim : Il est à côté d’une rue. Je ne m’en rappelle plus comment ça<br />
s’appelle, euh ! le béton, à côté d’une rue.<br />
1<br />
LORENZ K et POPPER K, L’avenir est ouvert, Paris, Flammarion, 1995, p. 44.,<br />
221