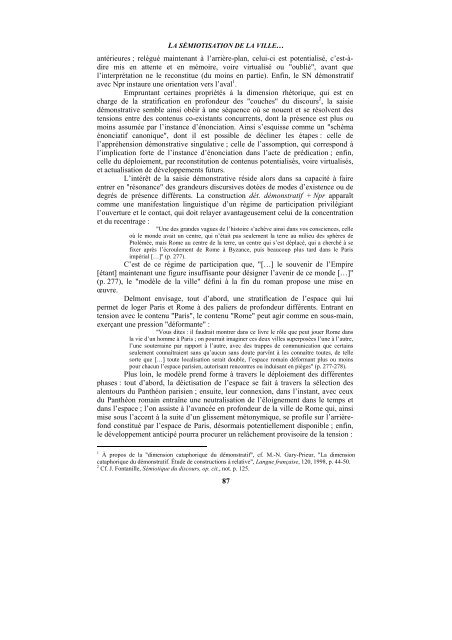Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA SÉMIOTISATION DE LA VILLE…<br />
antérieures ; relégué maintenant à l’arrière-plan, celui-ci est potentialisé, c’est-àdire<br />
mis en attente et en mémoire, voire virtualisé ou "oublié", avant que<br />
l’interprétation ne le reconstitue (du moins en partie). Enfin, le SN démonstratif<br />
avec Npr instaure une orientation vers l’aval 1 .<br />
Empruntant certaines propriétés à la dimension rhétorique, qui est en<br />
charge de la stratification en profondeur des "couches" du discours 2 , la saisie<br />
démonstrative semble ainsi obéir à une séquence où se nouent et se résolvent des<br />
tensions entre des contenus co-existants concurrents, dont la présence est plus ou<br />
moins assumée par l’instance d’énonciation. Ainsi s’esquisse comme un "schéma<br />
énonciatif canonique", dont il est possible de décliner les étapes : celle de<br />
l’appréhension démonstrative singulative ; celle de l’assomption, qui correspond à<br />
l’implication forte de l’instance d’énonciation dans l’acte de prédication ; enfin,<br />
celle du déploiement, par reconstitution de contenus potentialisés, voire virtualisés,<br />
et actualisation de développements futurs.<br />
L’intérêt de la saisie démonstrative réside alors dans sa capacité à faire<br />
entrer en "résonance" des grandeurs discursives dotées de modes d’existence ou de<br />
degrés de présence différents. La construction dét. démonstratif + Npr apparaît<br />
comme une manifestation linguistique d’un régime de participation privilégiant<br />
l’ouverture et le contact, qui doit relayer avantageusement celui de la concentration<br />
et du recentrage :<br />
"Une des grandes vagues de l’histoire s’achève ainsi dans vos consciences, celle<br />
où le monde avait un centre, qui n’était pas seulement la terre au milieu des sphères de<br />
Ptolémée, mais Rome au centre de la terre, un centre qui s’est déplacé, qui a cherché à se<br />
fixer après l’écroulement de Rome à Byzance, puis beaucoup plus tard dans le Paris<br />
impérial […]" (p. 277).<br />
C’est de ce régime de participation que, "[…] le souvenir de l’Empire<br />
[étant] maintenant une figure insuffisante pour désigner l’avenir de ce monde […]"<br />
(p. 277), le "modèle de la ville" défini à la fin du roman propose une mise en<br />
œuvre.<br />
Delmont envisage, tout d’abord, une stratification de l’espace qui lui<br />
permet de loger Paris et Rome à des paliers de profondeur différents. Entrant en<br />
tension avec le contenu "Paris", le contenu "Rome" peut agir comme en sous-main,<br />
exerçant une pression "déformante" :<br />
"Vous dites : il faudrait montrer dans ce livre le rôle que peut jouer Rome dans<br />
la vie d’un homme à Paris ; on pourrait imaginer ces deux villes superposées l’une à l’autre,<br />
l’une souterraine par rapport à l’autre, avec des trappes de communication que certains<br />
seulement connaîtraient sans qu’aucun sans doute parvînt à les connaître toutes, de telle<br />
sorte que […] toute localisation serait double, l’espace romain déformant plus ou moins<br />
pour chacun l’espace parisien, autorisant rencontres ou induisant en pièges" (p. 277-278).<br />
Plus loin, le modèle prend forme à travers le déploiement des différentes<br />
phases : tout d’abord, la déictisation de l’espace se fait à travers la sélection des<br />
alentours du Panthéon parisien ; ensuite, leur connexion, dans l’instant, avec ceux<br />
du Panthéon romain entraîne une neutralisation de l’éloignement dans le temps et<br />
dans l’espace ; l’on assiste à l’avancée en profondeur de la ville de Rome qui, ainsi<br />
mise sous l’accent à la suite d’un glissement métonymique, se profile sur l’arrièrefond<br />
constitué par l’espace de Paris, désormais potentiellement disponible ; enfin,<br />
le développement anticipé pourra procurer un relâchement provisoire de la tension :<br />
1 À propos de la "dimension cataphorique du démonstratif", cf. M.-N. Gary-Prieur, "La dimension<br />
cataphorique du démonstratif. Étude de constructions à relative", Langue française, 120, 1998, p. 44-50.<br />
2 Cf. J. Fontanille, Sémiotique du discours, op. cit., not. p. 125.<br />
87