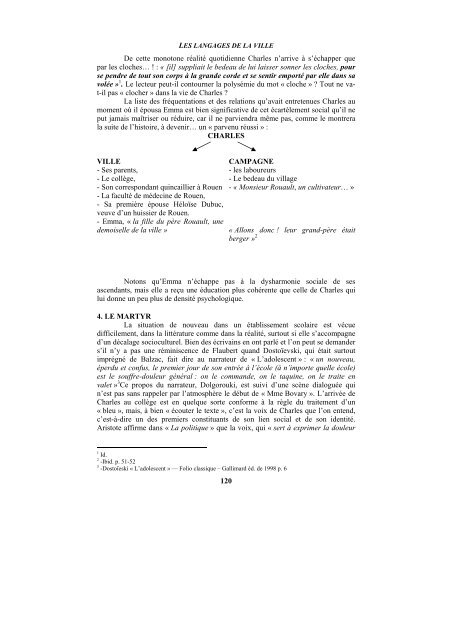Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
De cette monotone réalité quotidienne Charles n’arrive à s’échapper que<br />
par les cloches… ! : « [il] suppliait le bedeau de lui laisser sonner les cloches, pour<br />
se pendre de tout son corps à la grande corde et se sentir emporté par elle dans sa<br />
volée » 1 . Le lecteur peut-il contourner la polysémie du mot « cloche » ? Tout ne vat-il<br />
pas « clocher » dans la vie de Charles ?<br />
La liste des fréquentations et des relations qu’avait entretenues Charles au<br />
moment où il épousa Emma est bien significative de cet écartèlement social qu’il ne<br />
put jamais maîtriser ou réduire, car il ne parviendra même pas, comme le montrera<br />
la suite de l’histoire, à devenir… un « parvenu réussi » :<br />
CHARLES<br />
VILLE<br />
- Ses parents,<br />
- Le collège,<br />
- Son correspondant quincaillier à Rouen<br />
- La faculté de médecine de Rouen,<br />
- Sa première épouse Héloïse Dubuc,<br />
veuve d’un huissier de Rouen.<br />
- Emma, « la fille du père Rouault, une<br />
demoiselle de la ville »<br />
CAMPAGNE<br />
- les laboureurs<br />
- Le bedeau du village<br />
- « Monsieur Rouault, un cultivateur… »<br />
« Allons donc ! leur grand-père était<br />
berger » 2<br />
Notons qu’Emma n’échappe pas à la dysharmonie sociale de ses<br />
ascendants, mais elle a reçu une éducation plus cohérente que celle de Charles qui<br />
lui donne un peu plus de densité psychologique.<br />
4. LE MARTYR<br />
La situation de nouveau dans un établissement scolaire est vécue<br />
difficilement, dans la littérature comme dans la réalité, surtout si elle s’accompagne<br />
d’un décalage socioculturel. Bien des écrivains en ont parlé et l’on peut se demander<br />
s’il n’y a pas une réminiscence de Flaubert quand Dostoïevski, qui était surtout<br />
imprégné de Balzac, fait dire au narrateur de « L’adolescent » : « un nouveau,<br />
éperdu et confus, le premier jour de son entrée à l’école (à n’importe quelle école)<br />
est le souffre-douleur général : on le commande, on le taquine, on le traite en<br />
valet » 3 Ce propos du narrateur, Dolgorouki, est suivi d’une scène dialoguée qui<br />
n’est pas sans rappeler par l’atmosphère le début de « Mme Bovary ». L’arrivée de<br />
Charles au collège est en quelque sorte conforme à la règle du traitement d’un<br />
« bleu », mais, à bien « écouter le texte », c’est la voix de Charles que l’on entend,<br />
c’est-à-dire un des premiers constituants de son lien social et de son identité.<br />
Aristote affirme dans « La politique » que la voix, qui « sert à exprimer la douleur<br />
1 Id.<br />
2 -Ibid. p. 51-52<br />
3 -Dostoïeski « L’adolescent » — Folio classique – Gallimard éd. de 1998 p. 6<br />
120