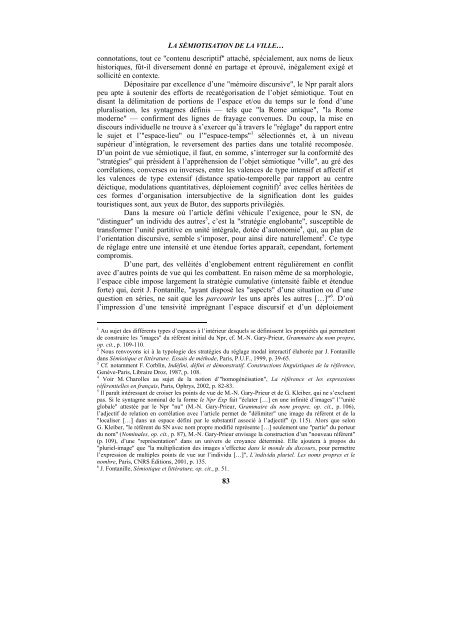Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA SÉMIOTISATION DE LA VILLE…<br />
connotations, tout ce "contenu descriptif" attaché, spécialement, aux noms de lieux<br />
historiques, fût-il diversement donné en partage et éprouvé, inégalement exigé et<br />
sollicité en contexte.<br />
Dépositaire par excellence d’une "mémoire discursive", le Npr paraît alors<br />
peu apte à soutenir des efforts de recatégorisation de l’objet sémiotique. Tout en<br />
disant la délimitation de portions de l’espace et/ou du temps sur le fond d’une<br />
pluralisation, les syntagmes définis — tels que "la Rome antique", "la Rome<br />
moderne" — confirment des lignes de frayage convenues. Du coup, la mise en<br />
discours individuelle ne trouve à s’exercer qu’à travers le "réglage" du rapport entre<br />
le sujet et l’"espace-lieu" ou l’"espace-temps" 1 sélectionnés et, à un niveau<br />
supérieur d’intégration, le reversement des parties dans une totalité recomposée.<br />
D’un point de vue sémiotique, il faut, en somme, s’interroger sur la conformité des<br />
"stratégies" qui président à l’appréhension de l’objet sémiotique "ville", au gré des<br />
corrélations, converses ou inverses, entre les valences de type intensif et affectif et<br />
les valences de type extensif (distance spatio-temporelle par rapport au centre<br />
déictique, modulations quantitatives, déploiement cognitif) 2 avec celles héritées de<br />
ces formes d’organisation intersubjective de la signification dont les guides<br />
touristiques sont, aux yeux de Butor, des supports privilégiés.<br />
Dans la mesure où l’article défini véhicule l’exigence, pour le SN, de<br />
"distinguer" un individu des autres 3 , c’est la "stratégie englobante", susceptible de<br />
transformer l’unité partitive en unité intégrale, dotée d’autonomie 4 , qui, au plan de<br />
l’orientation discursive, semble s’imposer, pour ainsi dire naturellement 5 . Ce type<br />
de réglage entre une intensité et une étendue fortes apparaît, cependant, fortement<br />
compromis.<br />
D’une part, des velléités d’englobement entrent régulièrement en conflit<br />
avec d’autres points de vue qui les combattent. En raison même de sa morphologie,<br />
l’espace cible impose largement la stratégie cumulative (intensité faible et étendue<br />
forte) qui, écrit J. Fontanille, "ayant disposé les "aspects" d’une situation ou d’une<br />
question en séries, ne sait que les parcourir les uns après les autres […]" 6 . D’où<br />
l’impression d’une tensivité imprégnant l’espace discursif et d’un déploiement<br />
1 Au sujet des différents types d’espaces à l’intérieur desquels se définissent les propriétés qui permettent<br />
de construire les "images" du référent initial du Npr, cf. M.-N. Gary-Prieur, Grammaire du nom propre,<br />
op. cit., p. 109-110.<br />
2 Nous renvoyons ici à la typologie des stratégies du réglage modal interactif élaborée par J. Fontanille<br />
dans Sémiotique et littérature. Essais de méthode, Paris, P.U.F., 1999, p. 39-65.<br />
3 Cf. notamment F. Corblin, Indéfini, défini et démonstratif. Constructions linguistiques de la référence,<br />
Genève-Paris, Libraire Droz, 1987, p. 108.<br />
4<br />
Voir M. Charolles au sujet de la notion d’"homogénéisation", La référence et les expressions<br />
référentielles en français, Paris, Ophrys, 2002, p. 82-83.<br />
5 Il paraît intéressant de croiser les points de vue de M.-N. Gary-Prieur et de G. Kleiber, qui ne s’excluent<br />
pas. Si le syntagme nominal de la forme le Npr Exp fait "éclater […] en une infinité d’images" l’"unité<br />
globale" attestée par le Npr "nu" (M.-N. Gary-Prieur, Grammaire du nom propre, op. cit., p. 106),<br />
l’adjectif de relation en corrélation avec l’article permet de "délimiter" une image du référent et de la<br />
"localiser […] dans un espace défini par le substantif associé à l’adjectif" (p. 115). Alors que selon<br />
G. Kleiber, "le référent du SN avec nom propre modifié représente […] seulement une "partie" du porteur<br />
du nom" (Nominales, op. cit., p. 87), M.-N. Gary-Prieur envisage la construction d’un "nouveau référent"<br />
(p. 109), d’une "représentation" dans un univers de croyance déterminé. Elle ajoutera à propos du<br />
"pluriel-image" que "la multiplication des images s’effectue dans le monde du discours, pour permettre<br />
l’expression de multiples points de vue sur l’individu […]", L’individu pluriel. Les noms propres et le<br />
nombre, Paris, CNRS Éditions, 2001, p. 135.<br />
6 J. Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 51.<br />
83