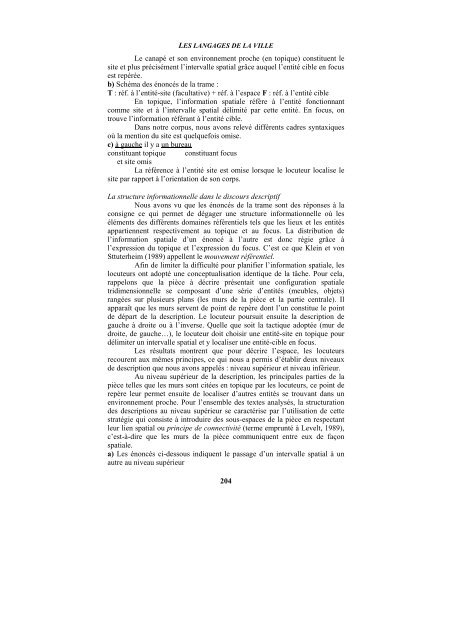Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
Le canapé et son environnement proche (en topique) constituent le<br />
site et plus précisément l’intervalle spatial grâce auquel l’entité cible en focus<br />
est repérée.<br />
b) Schéma des énoncés de la trame :<br />
T : réf. à l’entité-site (facultative) + réf. à l’espace F : réf. à l’entité cible<br />
En topique, l’information spatiale réfère à l’entité fonctionnant<br />
comme site et à l’intervalle spatial délimité par cette entité. En focus, on<br />
trouve l’information référant à l’entité cible.<br />
Dans notre corpus, nous avons relevé différents cadres syntaxiques<br />
où la mention du site est quelquefois omise.<br />
c) à gauche il y a un bureau<br />
constituant topique constituant focus<br />
et site omis<br />
La référence à l’entité site est omise lorsque le locuteur localise le<br />
site par rapport à l’orientation de son corps.<br />
La structure informationnelle dans le discours descriptif<br />
Nous avons vu que les énoncés de la trame sont des réponses à la<br />
consigne ce qui permet de dégager une structure informationnelle où les<br />
éléments des différents domaines référentiels tels que les lieux et les entités<br />
appartiennent respectivement au topique et au focus. La distribution de<br />
l’information spatiale d’un énoncé à l’autre est donc régie grâce à<br />
l’expression du topique et l’expression du focus. C’est ce que Klein et von<br />
Sttuterheim (1989) appellent le mouvement référentiel.<br />
Afin de limiter la difficulté pour planifier l’information spatiale, les<br />
locuteurs ont adopté une conceptualisation identique de la tâche. Pour cela,<br />
rappelons que la pièce à décrire présentait une configuration spatiale<br />
tridimensionnelle se composant d’une série d’entités (meubles, objets)<br />
rangées sur plusieurs plans (les murs de la pièce et la partie centrale). Il<br />
apparaît que les murs servent de point de repère dont l’un constitue le point<br />
de départ de la description. Le locuteur poursuit ensuite la description de<br />
gauche à droite ou à l’inverse. Quelle que soit la tactique adoptée (mur de<br />
droite, de gauche…), le locuteur doit choisir une entité-site en topique pour<br />
délimiter un intervalle spatial et y localiser une entité-cible en focus.<br />
Les résultats montrent que pour décrire l’espace, les locuteurs<br />
recourent aux mêmes principes, ce qui nous a permis d’établir deux niveaux<br />
de description que nous avons appelés : niveau supérieur et niveau inférieur.<br />
Au niveau supérieur de la description, les principales parties de la<br />
pièce telles que les murs sont citées en topique par les locuteurs, ce point de<br />
repère leur permet ensuite de localiser d’autres entités se trouvant dans un<br />
environnement proche. Pour l’ensemble des textes analysés, la structuration<br />
des descriptions au niveau supérieur se caractérise par l’utilisation de cette<br />
stratégie qui consiste à introduire des sous-espaces de la pièce en respectant<br />
leur lien spatial ou principe de connectivité (terme emprunté à Levelt, 1989),<br />
c’est-à-dire que les murs de la pièce communiquent entre eux de façon<br />
spatiale.<br />
a) Les énoncés ci-dessous indiquent le passage d’un intervalle spatial à un<br />
autre au niveau supérieur<br />
204