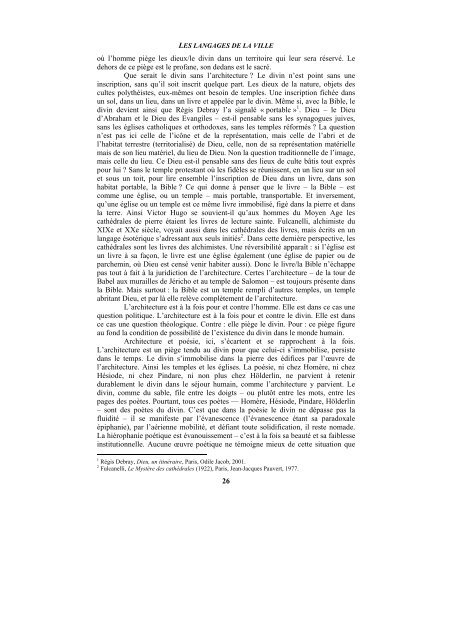You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LES LANGAGES DE LA VILLE<br />
où l’homme piège les dieux/le divin dans un territoire qui leur sera réservé. Le<br />
dehors de ce piège est le profane, son dedans est le sacré.<br />
Que serait le divin sans l’architecture ? Le divin n’est point sans une<br />
inscription, sans qu’il soit inscrit quelque part. Les dieux de la nature, objets des<br />
cultes polythéistes, eux-mêmes ont besoin de temples. Une inscription fichée dans<br />
un sol, dans un lieu, dans un livre et appelée par le divin. Même si, avec la Bible, le<br />
divin devient ainsi que Régis Debray l’a signalé « portable » 1 . Dieu – le Dieu<br />
d’Abraham et le Dieu des Evangiles – est-il pensable sans les synagogues juives,<br />
sans les églises catholiques et orthodoxes, sans les temples réformés ? La question<br />
n’est pas ici celle de l’icône et de la représentation, mais celle de l’abri et de<br />
l’habitat terrestre (territorialisé) de Dieu, celle, non de sa représentation matérielle<br />
mais de son lieu matériel, du lieu de Dieu. Non la question traditionnelle de l’image,<br />
mais celle du lieu. Ce Dieu est-il pensable sans des lieux de culte bâtis tout exprès<br />
pour lui ? Sans le temple protestant où les fidèles se réunissent, en un lieu sur un sol<br />
et sous un toit, pour lire ensemble l’inscription de Dieu dans un livre, dans son<br />
habitat portable, la Bible ? Ce qui donne à penser que le livre – la Bible – est<br />
comme une église, ou un temple – mais portable, transportable. Et inversement,<br />
qu’une église ou un temple est ce même livre immobilisé, figé dans la pierre et dans<br />
la terre. Ainsi Victor Hugo se souvient-il qu’aux hommes du Moyen Age les<br />
cathédrales de pierre étaient les livres de lecture sainte. Fulcanelli, alchimiste du<br />
XIXe et XXe siècle, voyait aussi dans les cathédrales des livres, mais écrits en un<br />
langage ésotérique s’adressant aux seuls initiés 2 . Dans cette dernière perspective, les<br />
cathédrales sont les livres des alchimistes. Une réversibilité apparaît : si l’église est<br />
un livre à sa façon, le livre est une église également (une église de papier ou de<br />
parchemin, où Dieu est censé venir habiter aussi). Donc le livre/la Bible n’échappe<br />
pas tout à fait à la juridiction de l’architecture. Certes l’architecture – de la tour de<br />
Babel aux murailles de Jéricho et au temple de Salomon – est toujours présente dans<br />
la Bible. Mais surtout : la Bible est un temple rempli d’autres temples, un temple<br />
abritant Dieu, et par là elle relève complètement de l’architecture.<br />
L’architecture est à la fois pour et contre l’homme. Elle est dans ce cas une<br />
question politique. L’architecture est à la fois pour et contre le divin. Elle est dans<br />
ce cas une question théologique. Contre : elle piège le divin. Pour : ce piège figure<br />
au fond la condition de possibilité de l’existence du divin dans le monde humain.<br />
Architecture et poésie, ici, s’écartent et se rapprochent à la fois.<br />
L’architecture est un piège tendu au divin pour que celui-ci s’immobilise, persiste<br />
dans le temps. Le divin s’immobilise dans la pierre des édifices par l’œuvre de<br />
l’architecture. Ainsi les temples et les églises. La poésie, ni chez Homère, ni chez<br />
Hésiode, ni chez Pindare, ni non plus chez Hölderlin, ne parvient à retenir<br />
durablement le divin dans le séjour humain, comme l’architecture y parvient. Le<br />
divin, comme du sable, file entre les doigts – ou plutôt entre les mots, entre les<br />
pages des poètes. Pourtant, tous ces poètes — Homère, Hésiode, Pindare, Hölderlin<br />
– sont des poètes du divin. C’est que dans la poésie le divin ne dépasse pas la<br />
fluidité – il se manifeste par l’évanescence (l’évanescence étant sa paradoxale<br />
épiphanie), par l’aérienne mobilité, et défiant toute solidification, il reste nomade.<br />
La hiérophanie poétique est évanouissement – c’est à la fois sa beauté et sa faiblesse<br />
institutionnelle. Aucune œuvre poétique ne témoigne mieux de cette situation que<br />
1 Régis Debray, Dieu, un itinéraire, Paris, Odile Jacob, 2001.<br />
2 Fulcanelli, Le Mystère des cathédrales (1922), Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1977.<br />
26