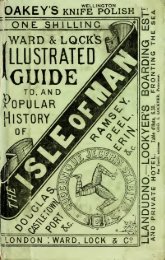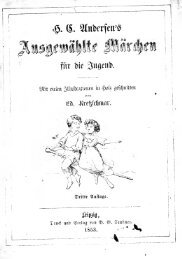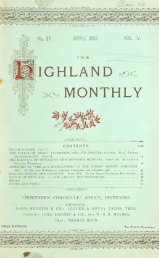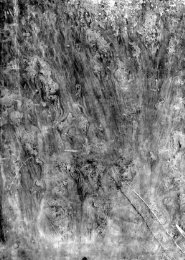- Page 1 and 2:
CHRESTOMATHIE BRETONNE (ARMORICAIN,
- Page 5 and 6:
CHRESTOMÂTHIE BRETONNE
- Page 7:
CHRESTOMATHIE BRETONNE (ARMORIGALX,
- Page 11 and 12:
AVERTISSEMENT AU LECTEUR Cet ouvrag
- Page 13 and 14:
CHRESTOMATHIE BRETONNE (Armoricain,
- Page 15 and 16:
— 3 — CroixanvGc, Saint-Gilles,
- Page 17 and 18:
Les traits les plus caractéristiqu
- Page 19 and 20:
— 7 — Ategnaii Druiicni carnilu
- Page 21 and 22:
— 9 — mar, au gallois maicr, au
- Page 23 and 24:
- 11 — lascriplion d'Aulun. CON L
- Page 25 and 26:
- 13 — En joignant à l'étude de
- Page 27 and 28: — 15 — Le vocabulaire gaulois s
- Page 29 and 30: peut phonétiquement en rapprocher
- Page 31 and 32: — 19 - Les noms propres d'hommes
- Page 33 and 34: - 21 - p. 85), d'afe, cVepo-, cheva
- Page 35 and 36: - 23 — Camulos-enus (César, VII,
- Page 37 and 38: - '25 - qui sait d'avance, composé
- Page 39 and 40: - 27 ^ diiriim, la forteresse à'Is
- Page 41 and 42: - 29 — Bretagne), de novio-, yow
- Page 43 and 44: — 31 - [Gramm. celt., 2° édit.,
- Page 45 and 46: - 33 - différence entre le gaulois
- Page 47 and 48: — 35 — du milieu du Y" à la fi
- Page 49 and 50: - 37 — Vernemetum [Itin. d'Ani.,
- Page 51 and 52: - 39 — cf. Hoiernin dans Plehs Ho
- Page 53 and 54: 41 CARACTERES OGPIAMIQUES AVEC LEUR
- Page 55 and 56: — 43 - Camelorigi (Kliys, 82; Hub
- Page 57 and 58: - 45 - Dumnocenni (Rhys, 105, comt
- Page 59 and 60: Saliciduni (Rhys, 39); M. Rhys, non
- Page 61 and 62: Vortipori, vocatif; nom du roi des
- Page 63 and 64: entre ô et ïi (l'u français), \
- Page 65 and 66: — 53 — etn avec la perte régul
- Page 67 and 68: main = (/y)/r7;/?rt (cf. latin palm
- Page 69 and 70: — 57 — et cin'episcopus ail ét
- Page 71 and 72: — 59 — cipaiix : 1° conservati
- Page 73 and 74: — 61 — affaibli. Ce phénomène
- Page 75 and 76: — «3 - des remarques analogues p
- Page 77: - G5 — on constate la même hési
- Page 81 and 82: - G9 — souvent et en armoricain p
- Page 83 and 84: — 71 - M. Schuchardt {Romania, II
- Page 85 and 86: - 7;},— On le voit, hé féminin
- Page 87 and 88: A quelle époque a couitnoucé l'é
- Page 89 and 90: - 77 - pas en général ïs final d
- Page 91 and 92: — 79 — plus heureux que le bret
- Page 93 and 94: — 81 — Signalons encore les Col
- Page 95 and 96: — 83 — ALAMNVS.REDONIS (1). Cet
- Page 97 and 98: — 85 ~ 8° Inscription de Kervili
- Page 99 and 100: — 87 — III. — Manuscrit de Be
- Page 101 and 102: Arcogued ou Ancogued, gl. niciuos.
- Page 103 and 104: Deurr, gl. acri. Lux. Dicomit : in
- Page 105 and 106: Hint, gl. per avia'? Lux. Holeu, gl
- Page 107 and 108: Tinsot ou Tinsit, gl. sparsit. G. G
- Page 109 and 110: — 97 — Battha insula, Paul Aur
- Page 111 and 112: - 99 — Hinuuoret, le personnage a
- Page 113 and 114: — 101 — transmarinae Toquonocum
- Page 115 and 116: — 103 — moyen, th doux anglais)
- Page 117 and 118: - -105 - vieux celtique ate, qui a
- Page 119 and 120: — 107 - Ar, généralement repré
- Page 121 and 122: — 109 — Balilakel, nom de lieu,
- Page 123 and 124: — 111 — Bothlenus 816 (Boslenus
- Page 125 and 126: — 143 — Budinit, Budinet, de hu
- Page 127 and 128: — 115 — Cat combat; Catoc, Cati
- Page 129 and 130:
— 117 — Clegeruc (1), 871, aujo
- Page 131 and 132:
— 119 — Coet bois, écrit aussi
- Page 133 and 134:
— 121 — Gornic, surnom de Maenh
- Page 135 and 136:
— 123 — Dabat brebis? : Caer Da
- Page 137 and 138:
— 4'25 — Diurth (1) prépositio
- Page 139 and 140:
Drid (1) boud). — 127 — : Dridu
- Page 141 and 142:
Ergentet, nom de lieu. — 129 —
- Page 143 and 144:
— 131 — Freudor (1), 859, Freod
- Page 145 and 146:
— 133 — Gleu-uueten(l) 888, Gle
- Page 147 and 148:
— 135 — Hael-uuocon, Helogon 11
- Page 149 and 150:
— 137 — Hidran, Hidric, Hedroc
- Page 151 and 152:
— 139 — Hoiant(l). Hoiarn fer :
- Page 153 and 154:
larn-bidoe 845, larn- — 141 — l
- Page 155 and 156:
ludhael (1), de ivd et hael. — 14
- Page 157 and 158:
;-coet.
- Page 159 and 160:
— Ul — Louor, surnom d'Even, p.
- Page 161 and 162:
— 149 — Mel-houuen (Rann) 846.
- Page 163 and 164:
— 151 — Meinion, plus souvent M
- Page 166 and 167:
~ 15i =- Moroc (1). Mouric (2), du
- Page 168 and 169:
Padrun (1) — 156 — : usque ad p
- Page 170 and 171:
Prit (1) Prost (3) : Ran uuoret. Pu
- Page 172 and 173:
Ri-uuallon; Riguallon 1040, Riuallo
- Page 174 and 175:
Roderch (1) 4051-1080. Rodoed (2) g
- Page 176 and 177:
Santan (1) : Ran Santan. — 164
- Page 178 and 179:
— 166 — Tal (1) payement, valeu
- Page 180 and 181:
— 168 - To (1) préfixe : To-rilh
- Page 182 and 183:
— 170 - Tutamau. Tut-uualart, app
- Page 184 and 185:
— 172 - Hird-uuallon. March-uuall
- Page 186 and 187:
Uueten-bidoe. -cain. Guethen-car. U
- Page 188 and 189:
— 176 — Uuen-tamau (1), femme.
- Page 190 and 191:
— 178 - Uuoletec (i) prince, chef
- Page 193 and 194:
— 181 — Uurm brun (Voir ael) :
- Page 195 and 196:
- 183 — 8° Le Dictionnaire topog
- Page 197 and 198:
— 185 — &, d, g; h, cl, g deven
- Page 199 and 200:
- 187 — cf. Carahais en Pleucadeu
- Page 201 and 202:
— 189 - Armor qui est sur les bor
- Page 203 and 204:
— 191 — Trinité de Bezver, XVI
- Page 205 and 206:
— 493 — 1448, auj. Bermagouet e
- Page 207 and 208:
— 195 — Cam courbe : mais cam,
- Page 209 and 210:
- 197 — ihid., fol. 3 r", 1384
- Page 211 and 212:
— 199 — auj. Clohars-Carnoet pr
- Page 213 and 214:
— 201 — Croeshent carrefour, in
- Page 215 and 216:
— ^203 — Droniou (1), Cart. Cor
- Page 217 and 218:
- 205 — Frot-questell rivulum , C
- Page 219 and 220:
— ^207 — Golohet couvert : Quen
- Page 221 and 222:
— 209 — Guellozae, ihid., fol.
- Page 223 and 224:
— 211 — guand, ibid., p. 70; Gu
- Page 225 and 226:
Harn (Voir houavn). — 2V3 — He,
- Page 227 and 228:
— 215 — Inisian, Cart. Kemperel
- Page 229 and 230:
— 1\1 — (Rosenzw., Dict. top.)
- Page 231 and 232:
— 219 — Tremeoc, arrondissement
- Page 233 and 234:
O'il Meur (1), muer, mer grand (Voi
- Page 235 and 236:
— 'lis — Bonnezgat (J.), chart.
- Page 237 and 238:
— 225 — Pinuizic riche : Cart.
- Page 239 and 240:
— 227 — Posteuc(l), Cart. Coris
- Page 241 and 242:
- 229 — Roez (1) : Roezfau 1296,
- Page 243 and 244:
— '231 — zulair (prononcez Rosu
- Page 245 and 246:
— 233 - de Quimper (Voir Cemper),
- Page 247 and 248:
Trestan (1) — 235 — : insula Tr
- Page 249 and 250:
— 237 - chère aux habitants de R
- Page 251 and 252:
— 239 — français-breton du mê
- Page 253 and 254:
— t>41 — de localiser par quelq
- Page 255 and 256:
243 PATRICIUS. (P. 10). [Me] so non
- Page 257 and 258:
— 245 — Prêt eo vn lest e ampr
- Page 259 and 260:
- 247 - Brases aessaff a 'n guellaf
- Page 261 and 262:
249 Adieu, tut mat a pep statur, Me
- Page 263 and 264:
- 251 - A neuez savet, credet sur.
- Page 265 and 266:
— 253 — (xvi^ siècle). Middle
- Page 267 and 268:
— 255 — Et dimiite nobis débit
- Page 269 and 270:
- '257 — An trede. An goelyou sta
- Page 271 and 272:
- 259 - IIwj M. ha huy N. a diogan
- Page 273 and 274:
— '261 — A zo pignel en nefuou
- Page 275 and 276:
(1) Édition de Morlaix : q2) Origi
- Page 277 and 278:
- 265 — An quentaff guer corff ha
- Page 279 and 280:
— 267 Hennez a graf an quentaf pr
- Page 281 and 282:
— 269 — breton a eu sous les ys
- Page 283 and 284:
- ^J71 — Ma 'z deux ahane piz tiz
- Page 285 and 286:
— 273 — Pemzec leuenez Maria (P
- Page 287 and 288:
— 275 — Buhez mabden (P. 88). G
- Page 289 and 290:
— 277 — Ez vihet égal havalet
- Page 291 and 292:
- 279 - 4. Hac y en dyen En desroua
- Page 293 and 294:
— 281 — Pe ban deue, hoaz na ma
- Page 295 and 296:
— 283 — RIUALLEN. A ny ya, Gueg
- Page 297 and 298:
- 285 - RIUALLEN. Me en goar breflf
- Page 299 and 300:
— 287 — Dre da sotis ouz ma dis
- Page 301 and 302:
- 289 — Hac an peder degrez man
- Page 303 and 304:
- 291 — gualle quet respond dezi
- Page 305 and 306:
- 293 — contrainy da sacrifie. Eu
- Page 307 and 308:
— 295 — de la mort, du dernier
- Page 309 and 310:
Titre : An - 297 — mirouer a conf
- Page 311 and 312:
299 Stabat mater tramlatet à, lati
- Page 313 and 314:
— 301 — Mary, maestres an guerc
- Page 315 and 316:
LA TABLE DE CE LIVRE Ce Hure est tr
- Page 317 and 318:
S. Nous auons assez de logis pour t
- Page 319 and 320:
du Trésorier, ou bien dites-leur q
- Page 321 and 322:
S. Monsieur, vous plaist-il me donn
- Page 323 and 324:
S. Monsieur, si vous vous Irouuez m
- Page 325 and 326:
313 LES NOMBRES (P. 226) AN XOMBROU
- Page 327 and 328:
— 315 — 18. III. Eux ar feiz ne
- Page 329 and 330:
- 317 — 119. XXXII. Oraeson ail d
- Page 331 and 332:
— 319 — ARMORICAIN MODERNE (1)
- Page 333 and 334:
— 321 — le prononcer comme vn e
- Page 335 and 336:
— 323 — Na pa leueromp, voit de
- Page 337 and 338:
— 325 — ur lec'li manivic en il
- Page 339 and 340:
— 327 — le texte suivi le plus
- Page 341 and 342:
— 329 — hac er chapélieu ag er
- Page 343 and 344:
— 331 — offencet, ha na gasset
- Page 345 and 346:
— 333 — vannetaise, mais modifi
- Page 347 and 348:
— 335 — Bezet un den anqueniet,
- Page 349 and 350:
- 337 - Na quémérant quet guhavé
- Page 351 and 352:
— 339 — Pedennou hac Instnictio
- Page 353 and 354:
(1) Original zovc'hu. (2) Orig. e z
- Page 355 and 356:
- 343 - Reitt t'semb-ni ol hou rant
- Page 357 and 358:
— 345 — R. Nousenn, urh ha pri
- Page 359 and 360:
— ;347 — Rac se, me ho suply da
- Page 361 and 362:
— 349 - Iscus en gênerai euil an
- Page 363 and 364:
— 351 — Ma 'mes choant da digue
- Page 365 and 366:
— 353 — un autre manuscrit qui
- Page 367 and 368:
— 355 — LE SERPANT parle. Me la
- Page 369 and 370:
— 357 — Prestet d 'emb, m 'ou s
- Page 371 and 372:
- 359 — Mes red e ou quetan préd
- Page 373 and 374:
— 361 — La langue, en revanche,
- Page 375 and 376:
- 363 - excepté dans le dialecte d
- Page 377 and 378:
dl. Eun dén en dwa daou vàb. —
- Page 379 and 380:
— 367 — 15. Hag a aas kuit, hag
- Page 381 and 382:
— 369 — 22. Hogen en tàil e la
- Page 383 and 384:
— 371 — 20. Hag e sawè hag e l
- Page 385 and 386:
— 373 — 23. Digaset ié ar leû
- Page 387 and 388:
— 375 — 27. A hinan (1) e laras
- Page 389 and 390:
- 377 — 26. Eàn e grias ar uinâ
- Page 391 and 392:
— 379 — dân de gourhemennèw (
- Page 393 and 394:
— 381 VOCABULAIEE- INDEX I. — N
- Page 395 and 396:
Ai'gantphitur, ])p. ]0~ , 156. Arge
- Page 397 and 398:
BoDir.us, pp. 37, 49. BODINCOMAGUS,
- Page 399 and 400:
Buechc (G. an), p. 194. Buhedoc, p.
- Page 401 and 402:
Karui (Ran), p. 114. Karuuan (Tribu
- Page 403 and 404:
Kerdezael, p. "232. Kerdiffez, p. 2
- Page 405 and 406:
Koetlann, pp. 97, 144. Koetleu, p.
- Page 407 and 408:
Kunglas, Cunclas, pp. 120, 132. Kun
- Page 409 and 410:
Duetmat, p. 203. Duil, p. 127. Duiu
- Page 411 and 412:
Freugor, p. 154, n. 5. Fredor, Fred
- Page 413 and 414:
Gouziern (Loo), p. 207. Gouzoguec (
- Page 415 and 416:
Guruili, p. 178. Gurthiern (Loc), p
- Page 417 and 418:
Hinoi (Treb), p. 137. Hinoc, p. 137
- Page 419 and 420:
lodica (villa), p. 143. lohan, p. 1
- Page 421 and 422:
Lazr (Ker eni, p. 216. Lazron (Poul
- Page 423 and 424:
Luethuarn, p. 218. LUGDUNUM, p. 18.
- Page 425 and 426:
Melan (Rani, p. 148. Melchi, p. 148
- Page 427 and 428:
Nevez (vicada), p. 222. Neviodunum,
- Page 429 and 430:
Ploegastell, p. 225. Ploegoff. pp.
- Page 431 and 432:
Rectugenus, p. 29. Redgand, p. 227.
- Page 433 and 434:
Roetanau, p. 162. Roezfau, p. 229.
- Page 435 and 436:
Serho, Serro, p. 165. Sether Seder,
- Page 437 and 438:
Timor (Ran), p. 167. Tinsedio (vill
- Page 439 and 440:
Tudian, p. 169. Tudoc, pp. 169, 235
- Page 441 and 442:
Uuinan, p. 175. Uuinoc, pp. 50, 175
- Page 443 and 444:
— 431 — II — Vocabulaire Pour
- Page 445 and 446:
— 433 — S'agit-il au contraire
- Page 447 and 448:
- 435 — Le pronom possessif et r
- Page 449 and 450:
— 437 — L'origine du ^, ancienn
- Page 451 and 452:
7. a pour ar sur; v. ar. 8. a, haul
- Page 453 and 454:
de prossesse avancée? 2il — for-
- Page 455 and 456:
(pron. féminin de la 3" pers.], le
- Page 457 and 458:
au {deux syllabes) foie, s. masc, 3
- Page 459 and 460:
— 447 — bet beza en bet rien du
- Page 461 and 462:
eza 364, 366; ô véza ilastumet ay
- Page 463 and 464:
274; an pemzec solac afïoe les qui
- Page 465 and 466:
out boutaillat le contenu d'une bou
- Page 467 and 468:
334. calo calonnec qui a du cœur,
- Page 469 and 470:
quel quelenn enseigner, instruire ,
- Page 471 and 472:
quic quic chair, viande, s. masc, 2
- Page 473 and 474:
comp gniinez, 324; compapnones, 346
- Page 475 and 476:
costez côté, s. masc, 310; daoïi
- Page 477 and 478:
chab chabistr chapitre, 303, 310. c
- Page 479 and 480:
darc mains), 288; douzora, 290; dao
- Page 481 and 482:
cleus deus de, i^rép. : cals deus
- Page 483 and 484:
dino dinoas innoconmcnt, adv. et ac
- Page 485 and 486:
doen tat, 269, 274 — Plur., doueo
- Page 487 and 488:
evitan, 366, 369; evit-han, 367; ev
- Page 489 and 490:
ent, préposition qui unie a un adj
- Page 491 and 492:
evez altcniion, 290. evezha veille
- Page 493 and 494:
foll follez folie, 286. foltrin dé
- Page 495 and 496:
guis guis guise, façon, 279, 280,
- Page 497 and 498:
gouz gouffet, 307 : ne gouffet petr
- Page 499 and 500:
guir guirhter dureté, 92. guiryon
- Page 501 and 502:
hile hileis, V. leis. hint chemin,
- Page 503 and 504:
impa impalazr empereur, 289, 290, 2
- Page 505 and 506:
laery voleras, fut. prim. sg. 2" pe
- Page 507 and 508:
limn limncollin tilleul, 93. limnco
- Page 509 and 510:
mauq manquein manquer, inf., 3o9. m
- Page 511 and 512:
meve meves tu es ivre, prés. ind.
- Page 513 and 514:
néan no, 237,271, 347; n"e, 286, 2
- Page 515 and 516:
P«W.pas5.,ofranset,offancet,260,32
- Page 517 and 518:
paed 327, 337, 342, 347, 331, 333,
- Page 519 and 520:
pegii pegueit combien de temps, 321
- Page 521 and 522:
poch Pochaer Poher, 260. pochard po
- Page 523 and 524:
sition : car, à cause de, devant,
- Page 525 and 526:
ausrnsducond. prés. plur. 'S''2)cr
- Page 527 and 528:
scia sclaer clair, clairemoit, adj.
- Page 529 and 530:
sonn 24.J — Fut.prim. srj. o'^per
- Page 531 and 532:
mac'h thad, 379 — Plur., tadeii,
- Page 533 and 534:
tristidic contrislé, triste, 275.
- Page 535 and 536:
ADDENDA ET GORRIGENDA p. 5. — Les
- Page 537 and 538:
— 0-J.0 — suiv. Cf. Windisch, U
- Page 539 and 540:
Avertissement au lecteur TABLE DES
- Page 543 and 544:
Griffitu Robekts. - A Welsh grammar